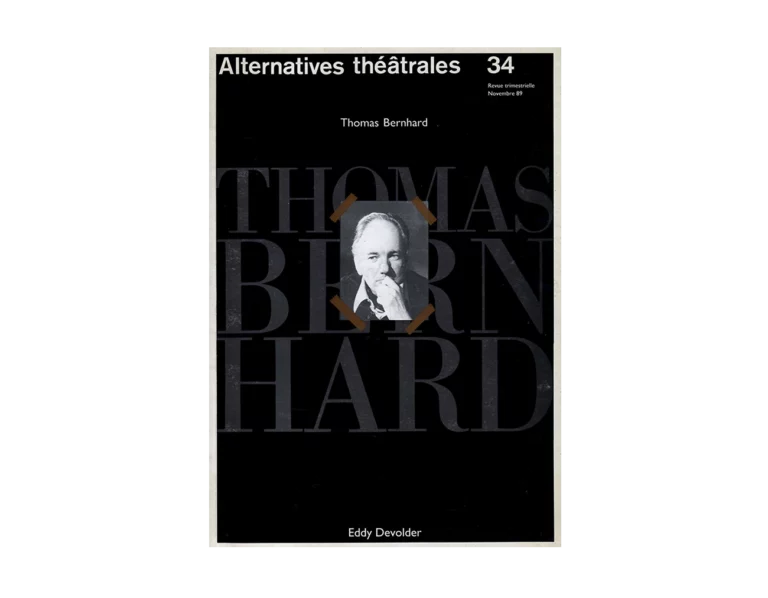FREUD avait remarqué que les enfants en âge de poser le pourquoi des choses précèdent selon une stratégie où la réponse importe moins que la question qu’elle engendre, non pas qu’ils veulent faire le tour de cette question, mais parce qu’il en est une qu’ils ne veulent absolument pas poser : la question de l’origine, la leur, d’où est-ce que je viens, mais aussi à travers celle-là celle de l’humanité toute entière. Quelle est l’origine de l’homme ?
En relation avec cette sourde insistance à poser des questions, Thomas Bernhard ne ménage aucune pose, aucun blanc dans ses textes, comme s’il procédait d’un flux incessant et sans repos, d’une horreur du vide.
Tel un état de siège, une ville encerclée, investie, soumise sans répit aux vagues, aux assauts répétés. L’acharnement à l’œuvre, la pression de toute part.

Pas de rêve, pas de trêve.
Pas de repos, mais l’insistance obsessionnelle.
La répétition comme requête, redoublement de la demande.
Dans le théâtre, la répétition comme préambule à la représentation, comme mise au point de l’interprétation ; prémice chez Bernhard d’une pièce qui ne sera jamais finie.
Tout ce qui anime le théâtre se joue en coulisses, en marge.
Théâtre du théâtre décalé, de l’intrigue légèrement déplacée, hors du cadre de la représentation traditionnelle classique, tel un photographe qui viserait à côté de l’image principale s’acharnant sur des détails apparemment sans importance ; des détails qu’il prend comme point d’appui dans le but de distiller, de renverser le système de la représentation.
Pour en revenir au cercle, métaphore de la cavité, du creux, de l’ouverture sur le monde invisible, souterrain.
D’une certaine façon, tout commence en Hollande, littéralement le pays creux, caverneux ; se poursuit avec la tuberculose dite à caverne.
Le monde de la cave engendre aussi celui de la tour (cylindre) où deux frères se retrouvent mis en quarantaine suite à une catastrophe.
Le cercle après la catastrophe, le zéro ou le manque du néant dont elle frappe les êtres.
Plutôt le signe ou l’empreinte de la catastrophe à laquelle ils ne peuvent échapper.
L’attente lourde, chargée à laquelle elle donnait lieu.
Le dérisoire discours à la limite de la déraison que cette attente provoque et qui accule les êtres à dire le contraire de ce qu’ils disent initialement.
Dans cette situation, le discours n’est que le remplissage d’un silence obligé où parlant, les êtres se condamnent eux-mêmes au silence. La parole ne peut rien sinon précipiter les événements.
Souvent dans le théâtre plus un être parle, plus il précipite sa fin. L’être condamné à mort parle le plus.
Peu de dialogue dans ce théâtre, mais un monologue à haute voix qui empiète sur l’existence des autres comme s’il s’agissait d’un jeu d’échecs où le mouvement d’une pièce entraîne avec elle toutes les autres pièces jusqu’au match final.
Dans le théâtre, la parole emplit la scène, non pas le jeu des acteurs mais cet emballement de la parole qui se met en échéc, qui se piège, cette parole qui condamne, dévastatrice. Si les acteurs en sont les interprètes, ils en sont surtout les jouets, des marionnettes, des pantins, non pas des ombres chinoises mais des êtres habités par une multitude d’êtres qui n’ont que le vide pour âme.
Toute l’écriture de Bernhard vise bien à épuiser dans tous les sens du terme le sujet, à camper la limite, à l’asseoir, à la fixer d’abord dans le but de la démolir, de la crever ensuite.
La question finalement n’est-elle pas la question de toute poésie : comment sortir du langage sans perdre pied, sortir de la représentation sans précipiter sa chute ?
Et toujours, cette impression que laisse chaque livre, celle que Bernhard à joué un bon tour.