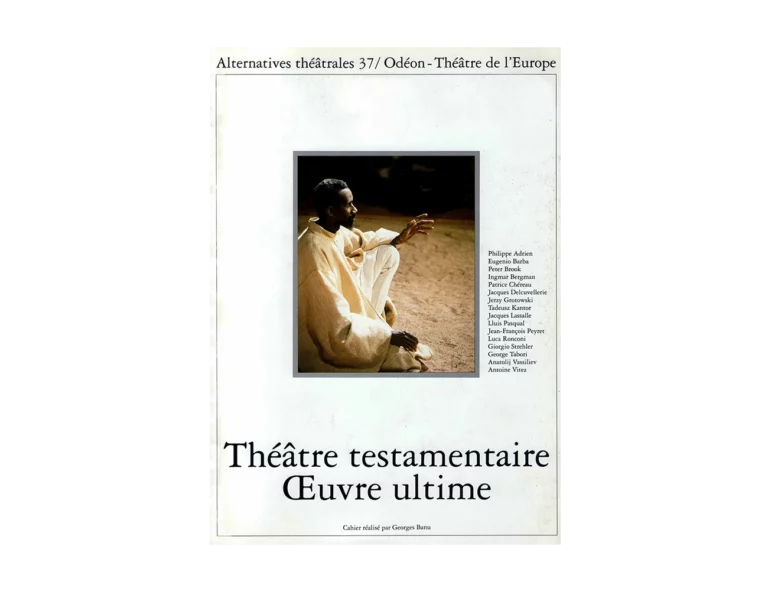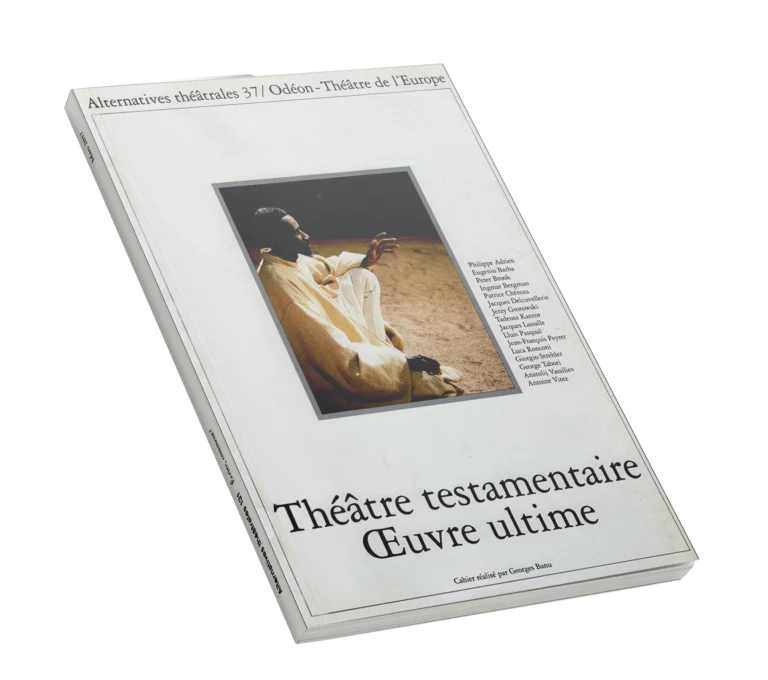GEORGES BANU : Vous avez programmé QUAND NOUS NOUS RÉVEILLERONS D’ENTRE LES MORTS d’Ibsen, vous avez mis en scène LES ACTEURS DE BONNE FOI de Marivaux, WOYZECK de Büchner, LA CLEF de Labiche, qui, elles aussi, sont des « dernières œuvres » et parfois vous avez parlé de votre intérêt pour ces œuvres ultimes. Pourquoi ? Trouvez-vous un coefficient existentiel différent par rapport à d’autres œuvres, percevez vous des mutations esthétiques significatives ?
Jacque Lassalle : Je suis né à la réflexion critique avec davantage Les cahiers du cinéma que toute autre revue spécialisée de théâtre et aux Cahiers du cinéma régnait à l’époque le parti déclaré de la politique des auteurs. Donc un auteur était toujours supérieur par définition à un faiseur de films et, par définition aussi, l’auteur ne cessait de se bonifier au point que, logiquement, la dernière œuvre ne pouvait être que la plus grande car elle bénéficiait de l’expérience accumulée à travers le temps. Ce qui fait, par exemple, que chez Renoir, l’on considérait LE DÉJEUNER SUR L’HERBE comme supérieur à LA RÈGLE DU JEU et que chez Chaplin l’on préférait UN ROI À NEW YORK à LA RUÉE VERS L’OR. J’ai bien sûr relativisé depuis ce que cette affirmation avait de très excessif, mais en même temps, je dois l’admettre, elle m’a beaucoup troublé. Il m’arrive encore d’en être influencé.
Les dernières œuvres en fait varient considérablement quant à la signification qu’il est possible de leur trouver par rapport à l’œuvre entier. C’est vrai que QAND NOUS NOUS RÉVEILLERONS D’ENTRE LES MORTS peut passer pour l’œuvre à la fois dernière et testamentaire. C’est l’œuvre de quelqu’un qui peut-être ne sait pas encore qu’il est en train d’écrire sa dernière pièce, mais que l’urgence biographique conduit consciemment à « ramasser son œuvre » en un dernier discours sur les rapports de l’art et de la vie et sur ce que l’art exige de sacrifice à la vie pour s’accomplir.
Il est des œuvres dernières qui sont, pour notre bonheur, des œuvres de toute première jeunesse. L’auteur n’ayant plus rien à prouver, plus rien à perdre, plus rien à gagner, l’auteur souvent bousculé par l’histoire, éprouvant le sentiment d’être repoussé par elle hors du temps, se livre alors à toutes les audaces, les fantaisies, les impunités du très jeune homme. Pour évoquer de nouveau Renoir ou Chaplin c’est tout à fait leur cas …
G.B. : Et celui de Picasso aussi …
J.L. : Oui, bien sûr, l’auteur signe alors des œuvres libres, partielles, pressées, bâclées quelquefois, mais qui réjouissent par l’abandon de toute pause, de toute certitude acquise … c’est pourquoi il arrive que la dernière œuvre dépasse la première, en insolence, en gaucherie, en naïveté consentie, en risque pris. Il est aussi des œuvres dernières qui sont des œuvres polémiques, de souffrance, d’amertume, œuvre où l’auteur fait appel à l’injustice du temps, où il se retourne sur le parcours accompli et l’interroge. C’est par exemple le cas de LA CLEF que vous citiez au début de notre entretien. C’est une œuvre dernière où l’on retrouve d’un côté l’interrogation anxieuse de l’homme Labiche, perturbé dans ses convictions, dans ses valeurs par la chute du Second Empire, effrayé par la Commune, et de l’autre, de l’auteur Labiche que le public abandonne au profit des formes musicales plus séduisantes : Offenbach est déjà là. Labiche se sent écarté. Il interroge alors rageusement Rinçonnet, son double de LA CLEF, pour lui faire dire vraiment, totalement, absolument ce que jusque-là il s’était évertué à maquiller. On pourrait dire la même chose de Marivaux et de ses ACTEURS DE BONNE FOI.
Le dogme des Cahiers du cinéma — plus un auteur vieillit, plus il est grand et donc, par définition, la dernière œuvre ne peut être que la meilleure- est, comme tous les dogmes, discutable, mais le fait de dire que la dernière œuvre est souvent imprévisible, qu’elle se présente souvent comme la mise en scène de tout ce qui la précède, me semble par contre, tout à fait vérifiable.
Pour la dernière fois, un auteur revisite, sans le savoir, la totalité de son parcours et de son œuvre. Qu’il se situe dans un projet déclaré de synthèse testamentaire ou qu’il affiche l’impunité d’une adolescence retrouvée, toutes les latences, toutes les potentialités, toutes les virtualités, tous les refoulés de l’œuvre, de l’œuvre adulte, de l’œuvre maîtrisée, de l’œuvre qui a inscrit incontestablement le regard de la postérité dans sa propre construction, dans sa propre mise en perspective, tout cela est abandonné et reste, seul, absolument, violemment, sans retour : le créateur sans précautions. Il a la verdeur, l’impudeur, le goût de provoquer voire de déplaire du vieil homme sans illusions.
Une dernière œuvre est toujours intéressante à questionner et du point de vue de la totalité de l’œuvre qui la précède et du point de vue de sa subversion radicale quant aux structures, aux mécanismes qui la commandent. J’aime bien les dernières œuvres comme j’aime bien les premières, parce que naître et mourir sont les deux moments essentiels et finalement identiques : naître à l’œuvre, mourir au monde. Par contre, les œuvres de la maturité, parfois, sont empesées, « amidonnées », trop conscientes d’une image de soi pour les autres, d’une volonté de postérité.
La dernière œuvre témoigne presque toujours d’une impatience malicieuse de n’être plus là où l’on attend son auteur.
G.B. : LA CHAMBRE CLAIRE de Barthes procure tout à la fois cette sensation de liberté extrême et celle de la fin, du délassement … l’artiste est libre mais épuisé.