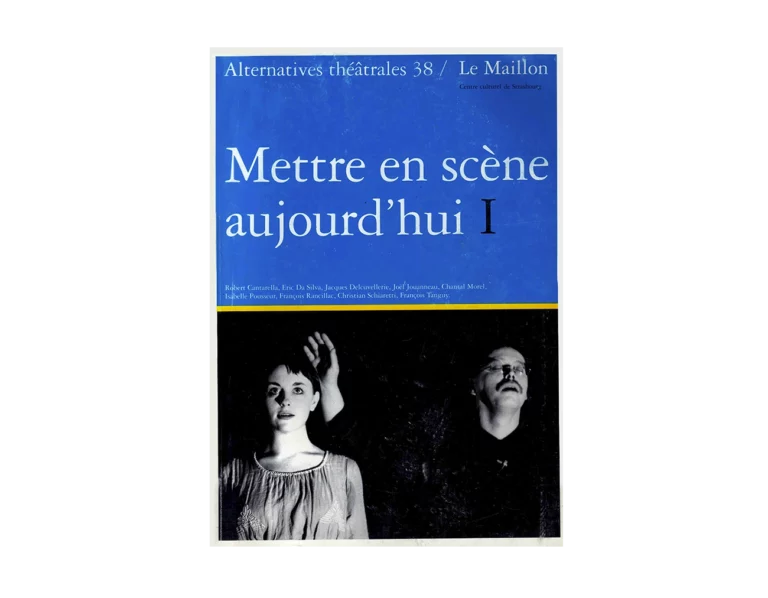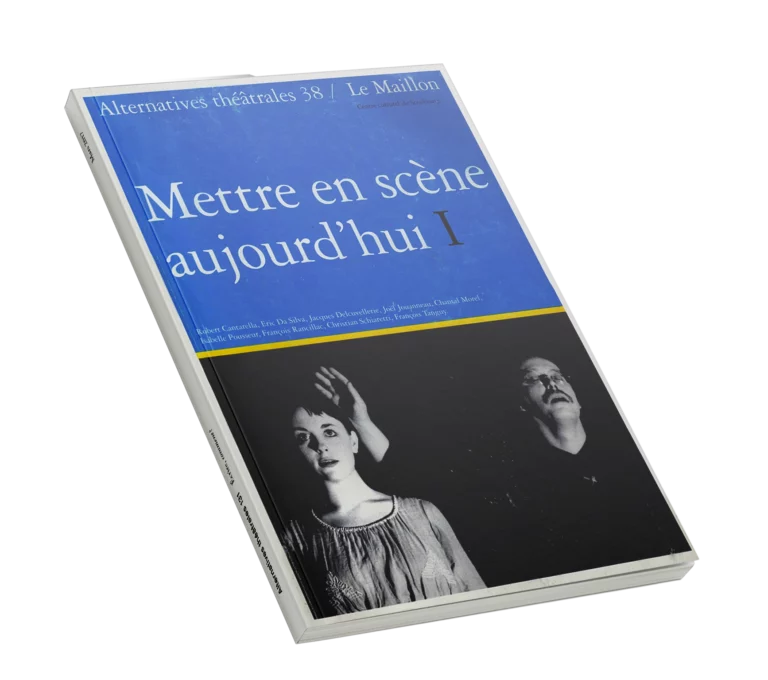Serge Saada : En tant que programmateur, conseiller artistique, administrateur, à quel théâtre vous intéressez-vous, et qu’est-ce qui vous conduit à vous attacher à un itinéraire artistique ?
François Le Piflouër : Ce qui me guide, c’est évidemment un goût personnel. Je me rangerais sous la bannière du théâtre d’art, un théâtre de sens d’où ne sont exclues ni l’esthétique, ni la jubilation. Il est toujours important de le préciser, car on pourrait croire que le théâtre d’art est le temple de l’ennui, alors que son intérêt, c’est de donner à ressentir au spectateur l’ivresse de la découverte d’autres mondes.
Je crois encore à la fonction oraculaire des artistes. Comme ce sont des personnes d’une extrême sensibilité, ils peuvent convoquer les gens de la cité, leur parler, faire que chacun soit plus à même de vivre humainement.
Le théâtre qui me séduit, c’est celui qui ne fait pas de cinéma. Certains metteurs en scène considèrent que l’art majeur est le cinéma, et s’occupent bon an mal an à faire du théâtre. Je suis attiré par un théâtre qui tente de tout inventer à partir de rien. Le plus souvent, je préfère un théâtre que je ne comprends pas tout de suite, qui me demande de venir à lui. Par exemple, dans la démarche de François Tanguy et du Radeau, il y a toujours un travail fabuleux de création, si bien qu’à certains moments, j’ai l’impression d’avoir sous les yeux l’univers d’un peintre qui aurait fait de ses toiles toute une exposition, un monde étrange, déroutant et fascinant à la fois.
Pour certains metteurs en scène avec lesquels j’ai travaillé, il y a tout un cérémonial qui commence un peu avant, qui crée un appel. Quand François Tanguy commence à me parler de son prochain spectacle, je suis déjà intéressé. Le spectacle vit en dehors du segment de trois heures auquel je vais être convié. Les artistes que j’apprécie ont une présence de grande qualité. Ils ne font pas des spectacles, mais des moments de théâtre.
Je crois que je cherche des artistes qui portent en eux un spectacle bien avant la mise en chantier. Des artistes qui réfléchissent en permanence et qui, un jour, arrivent avec une caravane d’idées. C’est leur présence constante et indéfectible qui me fascine.
S. Sa. : Même si le théâtre n’est pas forcément porteur de proposition sociale, pensez-vous que les metteurs en scène des années quatre-vingt ont trouvé des enjeux assez forts pour faire du théâtre ? On parle souvent de dépolitisation, pourtant la réalité est suffisamment sérieuse et grave pour constituer le point d’ancrage d’un imaginaire collectif.
F. L. P. : Oui, c’est indéniable, il y a des événements graves dans le monde, et certains metteurs en scène ont travaillé d’une façon ou d’une autre sur cette réalité. Par exemple, Stéphane Braunschweig, dans l’étude de sa trilogie imaginaire, fait entendre les mots de soldats revenant de guerre, avant que nous y retournions. Dominique Pitoiset traite du féodalisme et de l’absolutisme.
Cela dit, même si le théâtre a une fonction sociale, politique et philosophique, sans poésie, il devient asséchant. Quand je m’intéresse à des artistes, j’essaie toujours de voir s’il y a cette possibilité de mise en forme aiguë de la réalité. Certains poètes maîtrisent cet arc qui consiste à s’emparer de notions pour nous les donner à goûter et à ressentir. Quand je suis face à un spectacle de Chantal Morel, il me semble qu’elle trouve la plus belle manière d’évoquer et de rendre conscient : atteindre des coins de notre cerveau qui n’ont pas encore été visités.
S. Sa. : Au début des années quatre-vingt, a eu lieu l’éclosion de nouveaux univers artistiques. Ces multiples naissances se sont déroulées de façon anarchique et en formes généreuses. Quel regard portez-vous sur ces dix dernières années ?
F. L. P. : Le théâtre de recherche s’est nourri de Tadeusz Kantor, Claude Régy, Bob Wilson, Roger Planchon et Pina Bausch, mais il n’y a pas eu de véritable explosion de la création. Je pense qu’il y a eu des efforts de la part du Ministère, mais comme ces efforts ont été globaux… Ce constat est lié au fait que, parmi les auteurs, il est difficile de dégager un mouvement unificateur. Ce sont plutôt des qualités individuelles qui se sont exprimées. Il me semble que les metteurs en scène occupent le terrain quand l’auteur fait défaut ; il y a un lien entre auteur contemporain et metteur en scène, qu’il faut absolument retrouver et défendre.
S. Sa. : Selon vous, le statut du metteur en scène a‑t-il changé au sein d’une compagnie ? Pensez-vous que l’on vit sa vie d’artiste différemment ?
F. L. P. : Je ne peux pas dire si ça a vraiment changé. Mais je crois que beaucoup de metteurs en scène sont restés plus longtemps avec les membres de leur compagnie. En fait, ils ont plutôt des familles, et travaillent à l’intérieur de ces familles. Aussi, comme cette génération n’a pas été propulsée d’un seul coup aux manettes des institutions, ils n’ont pas connu trop rapidement une pression médiatique et politique, ils ne sont pas rentrés dans un cynisme qui consiste à dire : « Enfin, j’ai un théâtre national ». Même si, à titre individuel, l’expérience peut leur sembler intéressante, il n’y a pas un désir forcené d’affirmer sa place en détenant une structure. La plupart — même si l’on arrive vite dans n’importe quel groupe — ne sont pas forcément attirés par le pouvoir. Ils essaient plutôt de trouver les structures qui leur permettraient de réaliser leur théâtre donc ils rêvent. Pendant les années quatre-vingt, on aurait pu assister à des réunions d’artistes disant : « Nous voulons les théâtres nationaux, les C. D. N. », mais leurs préoccupations étaient alors autres.
S. Sa. : Vous avez décidé de travailler avec des metteurs en scène nés artistiquement dans les années quatre-vingt. Après coup, comment expliquez-vous ce positionnement, les avantages et les difficultés qu’il implique ?
F. L. P. : J’ai décidé de travailler avec eux parce qu’ils sont encore capables de faire des folies, d’écrire des spectacles ou des aventures qui ne sont pas encore réalisées. Comme des capitaines qui prennent la mer, ils sont prêts à partir vers des endroits qu’on ne connaît pas, pour rencontrer l’autre, comme l’ont fait les grands découvreurs qui voyageaient et misaient des parties importantes de leur vie. C’est sans doute ce qui m’a amené à me tourner vers une génération plutôt jeune. J’avais l’impression qu’ils étaient au début d’une œuvre : quand on mise encore sa vie, quand on mise des parties de son corps.
Si je travaille avec ces artistes, c’est qu’en art, j’ai toujours recherché le geste inaugural, le point de départ. C’est un enchaînement de pourquoi qui m’a toujours passionné. Je m’intéresse à celui qui est à la source d’un mouvement ou d’une école.