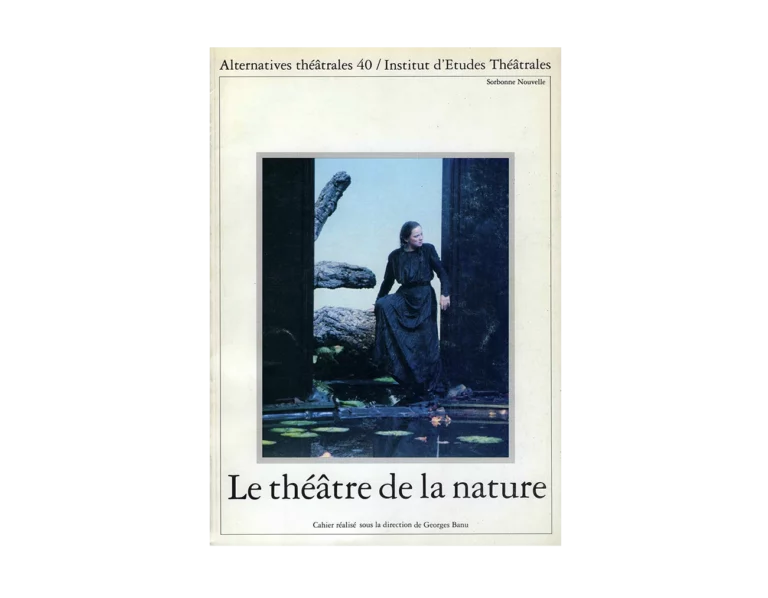EST-CE vraiment parce que les machinistes se recrutaient jadis parmi les anciens marins que le mot corde est prohibé sur les scènes comme il l’est sur les bateaux ? Poulies, treuils et manœuvres délicates apparentent certainement machinerie et navigation. Mais c’est plus intimement qu’un théâtre, toujours, ressemble à un navire. Petit esquif ou grand paquebot dont la sonnerie est la sirène, où l’on s’embarque pour un voyage hors du temps, hors du réel. Huis-clos dérivant dans un espace-temps indéfini, régi uniquement, mais impérieusement, par ses règles et ses hiérarchies propres. Les planches, à quoi ressemblent-elles plus qu’au pont d’un bateau ? Ce que savait bien Claudel en écrivant le premier acte de PARTAGE DE MIDI et tant d’autres avant lui. Toute pièce mettant en scène une île ou un bateau est, selon François Regnault, une inconsciente métaphore du théâtre1.
Du théâtre ou d’une de ses parties, la scène ? Il est vrai que les spectateurs sont, chacun individuellement, des « embarqués » (« vous êtes embarqués, il faut parier », il y a quelque chose de pascalien dans ce pari pour l’existence de la fiction que chacun doit faire, inéluctablement, quand le lustre s’éteint); mais le public, cette masse obscure, bruissante et mouvante, imprévisible et dangereuse, n’a-t-il pas quelque chose, plutôt, du gouffre marin ? Si la scène est ce radeau, émergeant dans la lumière, où les corps se détachent, se dressent, dans la salle, au contraire, c’est bien souvent aux délices nocturnes d’une dissolution qu’aspire le corps du spectateur. Vagues de rires, salle houleuse, déferlement d’applaudissements, tout cela renvoie à un univers liquide d’apesanteur, tel ce monde décrit par Proust, des baignoires de l’Opéra, « sombre et transparent royaume auquel çà et là servaient de frontière, dans leur surface liquide et plane, les yeux limpides et réfléchissants des déesses des eaux (…). Les radieuses filles de la mer se retournaient à tout moment en souriant vers des tritons barbus pendus aux anfractuosités de l’abîme, ou vers quelque demi-dieu aquatique ayant pour crâne un galet poli sur lequel le flot avait amené une algue lisse (…) parfois le flot s’ouvrait devant une nouvelle néréïde qui, tardive, souriante et confuse, venait de s’épanouir du fond de l’ombre ; puis, l’acte fini, n’espérant plus entendre les rumeurs mélodieuses de la terre qui les avaient attirées à la surface, plongeant toutes à la fois, les diverses sœurs disparaissaient dans la nuit »2.
Ainsi, lorsque l’eau envahit le plateau, c’est le vertige d’un renversement imaginaire qui nous saisit. Les scènes noyées, comme celle, restée célèbre, de MASSACRE À PARIS dans la mise en scène de Chéreau3, ou plus récemment, celle de DISPARITIONS de Richard Demarcy, d’ARIEN de Pina Bausch, témoignent d’un naufrage consenti par lequel le théâtre s’approche du happening, le jeu de la performance. Le risque de chute ou de glissade est évident ; plus qu’aucun autre élément naturel peutêtre, l’eau introduit une dimension de danger. (Seuls, dans certains cas, les animaux peuvent créer un tel risque : le cheval au galop de HAMLET, les chiens loups de NELKEN, sont peut-être, chez Chéreau et chez Pina Bausch, une autre façon de repousser jusqu’à la limite la sécurité de l’acteur ou du danseur). Du feu, on sait bien que les acteurs sont protégés, ne serait-ce que parce que le préfet de police veille à ce que les spectateurs ne courent aucun risque, et le feu est contagieux. Mais l’eau, dans ces cas extrêmes, manifeste avant tout la différence de ce monde où on se mouille, la scène, et du rivage sec où, anxieux de la moindre éclaboussure, les spectateurs assistent, mi-fascinés, mi-horrifiés (quoique délicieusement), aux tempêtes dans lesquelles les acteurs se débattent, instables et souillés : suave mari magno…
C’est aussi parce qu’elle rend les corps à leur nudité que l’eau impose sa violence. Et pour cela, point n’est besoin que la scène soit devenue piscine. Il suffit d’un bassin — comme celui des PARISIENS de Pascal Rambert, de BÉRÉNICE mise en scène par Lassalle — pour que l’acteur, s’y jetant ou y tombant, s’en relève comme déshabillé par le ruissellement. La nudité est alors d’autant plus troublante qu’elle est à la fois voilée et soulignée par le tissu mouillé qui se plaque à elle : fragilité encore augmentée de Dominique Frot, frissonnant sur la scène en plein air des PARISIENS en Avignon ; sensualité ambiguë, exhibée et maîtrisée, de la Bérénice de Nathalie Nell. L’eau abolit l’apprêt du costume, l’annule. Elle invite à traverser Les apparences, à découvrir le corps réel sous le masque du vêtement, et par là même, encore une fois, met l’acteur en danger.
Le parcours du combattant qui est celui du comédien sur les scènes bourbeuses (LA DISPUTE mise en scène par Chéreau, la scène de catch dans LA MISSION mise en scène par Michel Dezoteux) ou liquéfiées fascine et effraie. Quelque chose d’un mythe sacrificiel s’y devine. Et c’est sans doute à travers la dégradation du costume que nous ressentons le plus fortement ce qu’a de tragique l’épreuve imposée à l’acteur. Dans ARIEN, les danseurs de Pina Bausch sortaient de scène trempés, dégoulinants, hirsutes, et rentraient quelques instants après à nouveau impeccables, élégants, secs, vêtus et chaussés, pour se replonger aussitôt dans cette arène d’eau et y détruire une fois de plus leur image. Tout au long du spectacle, selon un principe répétitif cher à la chorégraphe, se renouvelait le sacrifice du costume, métonymie à peine ironique de la violence faite aux corps.
Aucune nudité n’est sur scène innocente, dès lors qu’elle s’expose, fût-ce à travers un linge mouillé, aux mille regards tapis dans l’ombre. L’eau entretient des rapports si intimes avec les corps qu’elle en devient indiscrète. Non seulement parce qu’elle déshabille, mais aussi parce qu’elle a toujours à voir, plus ou moins secrètement, avec celles des humeurs du corps, larmes et sueur, dont la scène est familière. Un acteur qui pleure — Christine Boisson dans PAR LES VILLAGES : je cite cet exemple parce que dans un spectacle de Régy il est évident que c’est l’actrice qui pleure, et non le personnage — plus encore un acteur qui transpire imposent brutalement cette part d’organique qui faisait tant horreur à Craig, part physiologique qu’évoque aussi, de façon plus spectaculaire et plus métaphoriqué, l’acteur souillé et mouillé des spectacles dont nous parlions. Ici et là, l’élément liquide renvoie à la vérité du corps, à l’authenticité de l’expérience de l’acteur, à l’intériorité — dans tous les sens du mot. Ce n’est pas par hasard que Chéreau décrit la quête de l’émotion comme un travail de sourcier, en célébrant ces chanteurs qui « vont chercher en eux les blessures et les failles et y retrouvent la jouissance secrète des larmes et du bouleversement »4. Toute mise en scène des larmes (tout imaginaire des larmes au théâtre) est une méditation sur la part de la nature dans l’artifice, de la réalité dans l’illusion.
Proust, si proche de Craig à bien des égards dans son refus d’un art attaché à la réalité, à la matérialité, oppose ainsi la Brema et ses partenaires : sa « Voix, en laquelle ne subsistait plus un seul déchet de matière inerte et réfractaire à l’esprit, ne laissait pas discerner autour d’elle cet excédent de larmes qu’on voyait couler, parce qu’elles n’avaient pu s’y imbiber, sur les voix de marbre d’Aricie ou d’Ismène »5. Ces larmes absorbées dans l’art, arrachées à leur liquidité, dénaturalisées et spiritualisées, on pourrait en trouver l’équivalent dans le maquillage de Georges Bigot, l’Orsino de LA NUIT DES ROIS mise en scène par Ariane Mnouchkine : deux coulées brillantes, pailletées indiquaient en un masque saisissant la mélancolie du Duc. Mise à distance plus équivoque, celle qu’imagina Vitez pour PHÈDRE avec cette « bassine de larmes » où les personnages venaient tour à tour puiser quelques gouttes qu’ils déposaient sur leur visage6. L’eau est sur scène, mais prisonnière de la logique de l’artifice. Tout l’art de Vitez, d’ailleurs, vise à ce détournement du naturel. Et le plateau de bois bleu du SOULIER DE SATIN — radeau marin oxymorique posé sur la grande scène sombre du Palais des Papes — est peut-être la plus belle conjuration de l’élément liquide qui soit. Il s’oppose à la scène marécageuse de LA DISPUTE comme l’acteur vitézien, ludique et jubilant, libéré de l’intériorité, de ses drames et de ses larmes s’oppose à l’acteur de Chéreau, au jeu jailli de quelque sanglot enfoui.
Seules des esthétiques pacifiées — ce que ne sont ni celle de Vitez, ni celle de Chéreau, l’une et l’autre valorisant la contradiction — font intervenir l’eau sans qu’elle joue comme rupture ou comme provocation dans l’univers de la représentation. C’est le cas du « théâtre des éléments » de Brook si bien décrit par Georges Banu, notamment à travers une rêverie sur la flaque du MAHABHARATA, ludique et poétique à la fois : « De (la) succession du retrait et de la mise en avant de la flaque (dans le déroulement de la représentation) découle l’originalité de son fonctionnement, dépourvu (…) de toute systématisation significative de même que de toute gratuité ludique. L’eau change de statut sans être traitée pour autant comme élément théâtralisable. Elle préserve une matérialité intrinsèque, dévorée par le vertige des métamorphoses. À l’abri de l’abus des transformations, elle sait parfois rester une flaque. Rien de plus. De même qu’elle peut participer à l’action dans la scène qui suit. Il y a donc un incessant mouvement alternatif entre le silence de l’eau et l’activité de l’eau »7.