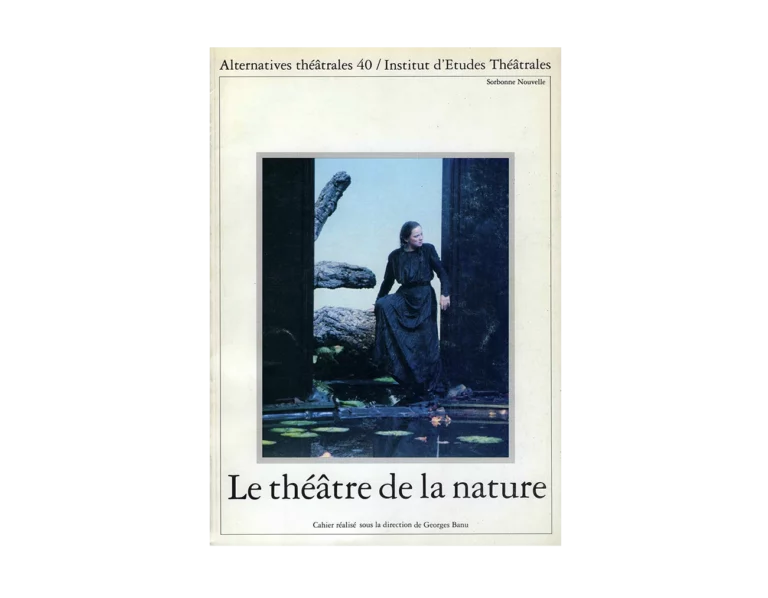Les feux du dedans
DES éléments, le feu appartient le plus au théâtre. Au Moyen Âge, on l’érige en principal terme pour désigner l’enfer et des maîtres-essecrets se disputaient les techniques des flammes à but spectaculaire et, explicitement, pédagogique. Plus tard, bien que pour des raisons autres, sa présence sera constante sur le plateau de même que dans la salle : il éclaire les visages et les décors. Les torches absentes chez Shakespeare font leur apparition dès qu’il y a abandon du plein air et enfermement dans les palais jacobéens. Le feu est le propre du théâtre d’intérieur.
On le sait, sur la scène classique, la durée des bougies détermine la durée des actes car leur remplacement impératif exige l’interruption. Bien que ce feu-là, le reproche semble légitime, ne soit pas perçu comme directement impliqué dans la représentation car seulement source d’éclairage, il se rattache à l’acte théâtral comme phénomène d’intérieur. Ensuite avec l’apparition de la rampe, les bougies qui y sont dissimulées projettent des reflets étranges sut les physionomies des protagonistes, êtres blafards surgis de « l’autre côté »… Le feu cesse dès lors d’éclairer uniformément salle et scène pour désigner des frontières, focaliser des regards, exalter des visages. Sa théâtralisation commence.
Mais le feu ne se laisse pas aisément maîtriser. Il préserve dans la clôture de la salle toute son imprévisibilité. Il se dérobe au contrôle et engendre des catastrophes. Deux siècles durant l’incendie ponctue avec obstination la destinée du théâtre comme édifice. Malgré des précautions et des consignes de prudence, le feu semble être inévitable comme s’il rappelait ainsi la fragilité de ses bâtiments qui l’ont accueilli dans leur sein pour éclairer les jeux des êtres imaginaires. Avec des structures en bois et des décors en toile, les théâtres à l’italienne seront une proie facile au point que les statistiques au XIXè siècle dénombrent en Europe tous les deux ans un théâtre calciné. Le feu qui les embrase explique l’importance que les traités d’architecture accordent aux prescriptions techniques concernant aussi bien la prévention que les solutions nécessaires pour assurer l’échappée rapide du public : on exige que les portes de la salle s’ouvrent toujours vers l’extérieur, on calcule la résistance des marches en fonction de l’encombrement que la panique du feu peut produire, on réclame le dégagement de larges couloirs, progressivement on imagine un système d’isolement de la scène qui s’avère être toujours le foyer premier de l’incendie. La scène c’est Le lieu des passions où les êtres, littéralement, jouent avec le feu. feu qui se propage ! D’abord on dresse un réseau métallique à mailles qui se révèle vite trop large pour éviter la traversée des flammes, ensuite, après d’autres essais sans succès, le rideau de fer s’impose. Désormais le feu peut être localisé : que la scène brûle pourvu que la salle soit sauve ! Le public sera rassuré et, à l’abri, il pourra jouir de la représentation sur laquelle le rideau métallique peut tomber à tout instant. Aujourd’hui encore chaque théâtre doit tester le bon fonctionnement du rideau de fer en début du spectacle car, on le sait, le feu ne sera jamais assagi. C’est aussi la raison pour laquelle le pompier de service a fini par appartenir à l’univers théâtral de même que le rideau métallique est devenu un accessoire indispensable, au point même de passer dans le vocabulaire de l’histoire contemporaine. Avec la découverte du gaz, et de l’électricité ensuite, le théâtre découvre la modulation des intensités, la possibilité de séparer la salle et la scène et en même temps de bénéficier de plus de sécurité car le feu réel, vivant, imprévisible sera expulsé. Plusieurs décennies durant, la scène se contentera de le représenter et le chef électricien va déployer, comme jadis les maîtresès-secrets, de véritables trésors d’imagination pour suggérer le feu. Il n’a plus droit de cité dans ce théâtre qu’il a si souvent consumé. Encore maintenant, en Angleterre, on ne déroge sous aucun prétexte à cette conduite précautionneuse.
Les feux du dehors
Banni de l’intérieur, chassé, traqué, le feu n’aura droit de retour que lorsque le théâtre redécouvre le plein air. Si à la Renaissance il a partie liée avec le dedans, au XXè siècle la réconciliation passe par la reconquête de l’extérieur. Dans les spectacles de Max Reinhardt et Jacques Copeau, dans les jardins et sur les places on observe ici et là la bougie des fellinares et la flamme des torches car le plein air, pareil aux salles, sera lui aussi nocturne. Le théâtre regagne l’extérieur, mais point le jour : il s’accomplit dans la nuit. Avec Vilar à Avignon le retour du feu sera pleinement consacré et alors, à la liberté du ciel étoilé s’ajoute la lumière vacillante des torches. Le feu appartient au projet visuel du spectacle — il est programmé — mais en même temps on fait tout pour dire qu’il s’en échappe. Et ainsi le feu, de même que jadis il fut synonyme d’expérience intérieure du théâtre, il consacre maintenant les retrouvailles avec le dehors. Ces feux qui illuminèrent le plateau d’Avignon ont eu une vocation prémonitoire : ils annonçaient ainsi l’‘amorce d’un combat, celui de la réhabilitation des liens directs du théâtre et de la nature. Ils fondent ce que Roland Barthes appelait « un imaginaire de participation » , celui que depuis les Grecs l’extérieur suscite.
Le feu archaïque
Chez Brecht, toute référence au feu s’absente, tandis que chez Artaud il y en a à foison. Ce contraste ne pouvait passer inaperçu aux metteurs en scène qui dans les années 60 se réclament de l’un ou de l’autre au point que les spectacles de filiation brechtienne l’interdisent de plateau tandis que les autres, de filiation artaudienne, en abondent, au point même de galvauder son usage : le feu échoue presque toujours en code de bonne conduite artaudienne. Sauf pour Grotowski, qui sait que l’incandescence doit surgir d’ailleurs, qu’elle est d’abord le fait du jeu. Il l’emploiera tout de même dans son dernier spectacle théâtral, APOCALYPSIS CUM FIGURIS.
Peut-être que nul usage des torches ne fut plus pertinent que celui adopté par Brook à Persepolis pour ORGHAST. Alors, dans ce spectacle des origines ayant Prométhée comme héros, dans ce spectacle qui débute au coucher du soleil pour traverser ensuite la nuit, le feu avait un double rôle. Il désignait la rébellion mythique du personnage et évoquait le contexte primordial des commencements. C’était le feu archaïque1. Nous allons le retrouver naturellement dans la TRILOGIE ANTIQUE réalisée par Andrei Serban de même que dans d’autres spectacles engagés dans la quête du corps comme expression primordiale de l’être originaire.
L’ensemble polonais Gardzienice dirigé par Wodek Staniewski érigea en partenaire privilégié le feu qui devait témoigner de la quête éperdue d’une relation originaire où la nuit, la forêt et la caverne apparaissent comme les foyers premiers de l’homme. Ce feu que l’on retrouve dans le spectacle sur Rabelais de même que dans LES AÏEUX intervenait aussi comme élément actif, à même de soutenir l’énergie du groupe, de lui répondre et de l’exalter. Dans ces spectacles on n’employait pas la terre ou l’eau et le feu apparaissait comme le seul élément apte à entretenir une relation noble, intense et dévastatrice entre l’homme et le cosmos. Le feu, intermédiaire privilégié ! Toujours, à l’extérieur ou dans des lieux non théâtraux, le feu s’érige en emblème d’un manque et en expression d’un vœu : le vœu du théâtre comme art où le corps nu d’un côté et le feu initial de l’autre furent les deux symptômes de l’excès cherché avec obstination dans les années 60.
Le feu domestique
Presque pour tempérer l’extension du feu archaïque, feu à l’écart du théâtre comme édifice, feu incendiaire, un autre feu, quotidien, familial, feu d’intérieur intervint sur les scènes des années 70. Alors des feux de cheminée commencent à se multiplier, des bougies et des lampes de nuit scintillent dans l’obscurité. On les retrouve dans les spectacles avec des textes du XIXè siècle, du CANARD SAUVAGE d’Ibsen mis en scène par Lucian Pintilié jusqu’aux TROIS SŒURS de Stein. Dans Strindberg ou Ostrovski, d’Oslo à Moscou et de Prague à Bucarest, le feu vient accomplir l’intérieur bourgeois, le parfaire, car ces feux sont le plus souvent les feux de l’intimité. Feux bachelardiens du repli sur l’enfer casanier, simulacre d’un bonheur toujours dénoncé. À ces feux fin de siècle, à ces feux des bâtisses nobles s’ajoutent plus tard les feux des cuisines, des réchauds, du butagaz de l’univers de Krœtz et Tilly. Les feux de l’hyperréalisme contemporain. Feux médiocres, feux de l’amertume assumée et de la solitude banalisée. Du feu de bois au feu à gaz la mise en scène développe la variation d’un même motif : le feu domestique. Il apparaît comme un élément vivant dans un intérieur livré au mensonge ou au silence car s’il accomplit la vérité globale de l’image scénique, il apparaît aussi, à l’œil du public, comme une preuve de vérité, un refus du faux semblant, un déni d’illusion. Dans l’univers familial le feu domestique conteste l’irréalité des mots et dénonce leurs jeux. Quand les gens se trompent les flammes seules ne mentent pas. C’est pourquoi l’intuition de Jacques Lassalle au Vè acte de TARTUFFE fut merveilleuse : apeurée, la famille d’Orgon se réunit autour d’un brasero. Là elle se ressoude ; le feu guérit du froid de l’intérieur. Dans LE RETOUR DE LA VILLÉGIATURE de Goldoni, mis en scène par Strehler, le froid et l’obscurité viennent s’ajouter à l’échec des passions sur fond de feux faibles, impuissants, inaptes à maintenir en vie un amour défunt. C’est l’ultime combat avant que la nuit tombe et la douleur l’emporte. Le feu domestique, irrémédiablement, sera lié à la psychologie. Entre eux il y a échange, dialogue, accompagnement constant.
Le feu politique
Outre les feux des origines et les feux de l’intimité un autre terme se fait jour : c’est le feu politique. Feu provocateur. Le feu qui ne renvoie pas aux commencements et qui abhorre les intérieurs. Ce sont les feux de la théâtralité exacerbée, assumée, clamée, feux allumés contre un monde réduit aux clichés, un monde détruit par la consommation et endormi par le confort. À Nancy, lieu de nos nostalgies soixante-huitardes, il y avait surenchère du feu. Dans la rue, de même que dans les salles, le feu devenait de plus en plus métaphore du refus et d’un inextinguible besoin d’authenticité. Il y eut même des manifestations mémorables comme dans ce spectacle du Théâtre Stu où une femme nue traversait l’écran des journaux enflammés. La presse peut brûler si le sexe reste sauf. Alors l’effervescence politique de l’époque se retrouvait dans l’incandescence, littérale, de la scène. Et quand Brook dans US brûlait des papillons comme substituts des autos-incendies auxquelles se livraient, à l’époque, les partisans du Vietnam il rattachait lui aussi le feu à un combat politique. Le théâtre échappait ainsi au règne des simples mots dénonciateurs pour affirmer ses choix politiques grâce à des solutions qui parvenaient à sauvegarder un plaisir sensuel fondé sur l’étonnement et l’excitation. Le feu, sous le signe de Jan Pallach qui s’était immolé au cœur de Prague, fut intégré par le théâtre dans son exercice politique le plus direct. Il apparaissait comme un appel à la consommation de soi. Mais assez rapidement l’esthétique l’emporta et le feu échoua en un cliché. Du feu comme résistance on passait au feu comme complaisance.
Le feu philosophique