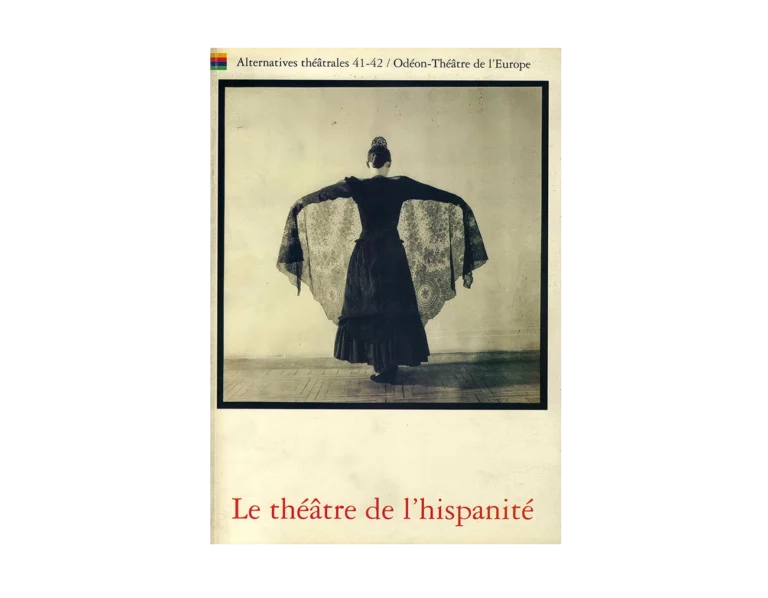BUENOS AIRES a toujours été une scène. Deux mille Indiens maniant la lance y ont d’abord joué comme figurants dans un premier spectacle qui eut deux fondations, chacune avec ses incendies, son cannibalisme espagnol, son encyclopédisme clandestin, ses guerres de libération, ses guerres fratricides. L’ouverture de la scène s’élargit démesurément lorsque des réfugiés économiques et, ensuite, des figurants créoles prirent la place des Indiens. Les Espagnols importèrent l’épopée, la zarzuela, l’extravagance. Les Italiens apportèrent la commedia dell’arte et la voix de baryton de certains immigrants qui, à défaut d’opéra, chantèrent le tango. (L’opéra a cependant eu son propre théâtre, le Colо́n.) Les juifs ashkenazes fermèrent la boucle du mélodrame. Tous ces éléments furent assaisonnés à la sauce anglaise, avec des troupes françaises. En 1939, le polonais Gombrowicz débarqua à Buenos Aires au moment où Jorge Luis Borges — qui n’était pas encore aveugle — était critique de cinéma. À cette époque, Margarita Xirgu avait réuni en catalan les deux rives opposées, celles de Buenos Aires et de Montevideo, à l’endroit où del Cioppo créerait au Galpо́n une école de théâtre parallèle. Les exilés de la guerre civile espagnole, « la dernière guerre romantique » selon Marcusse, et d’autres acteurs se joignirent à un casting déjà constitué de chanteurs, de danseurs, de comédiens naturalistes, d’interprètes de Shakespeare, et aussi de groupes folkloriques, confessionnels (deux théâtres juifs), idéologiques (le Teatro del Pueblo, de Leonidas Barletta, en quelque sorte berceau du mouvement du théâtre indépendant) ou linguistiques — le Théâtre de l’Alliance Française, plateforme de lancement à Paris de Jorge Lavelli, dans les années soixante.
L’immigration de la fin du XIXè et du début du XXè siècle, les anarchistes italiens des années vingt, le génocide perpétré par les Turcs sur les Arméniens ou les pogroms russes, la diaspora des Syriens et des Libanais, la misère européenne et ses trois grands conflits — la grande guerre, la guerre civile espagnole et la deuxième guerre mondiale — ont fourni les thèmes, les individus, les personnages et même la langue — l’espagnol particulier de tant d’émigrants — à un théâtre populaire qui, à son tour, donnerait naissance à une industrie cinématographique qui fut puissante en son temps et qui colonisa l’Amérique du Sud et l’Espagne dans les années quarante.
Dans les faits, le théâtre, avec une moyenne de quarante salles en activité tout au long du siècle, est une caractéristique fondamentale de la culture non pas argentine mais de Buenos Aires.
De quel théâtre s’agit-il ? Il est difficile de le définir pour de multiples raisons. En premier lieu, parce que toutes les écoles théâtrales ont trouvé des disciples et des adeptes à Buenos Aires : celle de l’acteur marionnette de Craig, de la distanciation de Brecht, du psychologisme promu par l’exilée Heddy Crilla, des dérivations de l’Actor’s Studio, raffermies par Augusto Fernändez. Ensuite parce que toutes les possibilités du théâtre y devenaient viables, depuis les sainetes (le théâtre populaire, quasi journalistique des premières décennies du siècle) jusqu’à l’éclosion d’un naturalisme de la classe moyenne, dans les années 60 – 70, qui alternait avec les happenings de l’Instituto Di Tella, dont les créateurs ont fait plus tard carrière aux EtatsUnis et en Europe ; mais viables aussi les premiers Beckett, Ionesco et cie d’Amérique latine. Toutes les possibilités théâtrales. Les années soixante-dix ont vu ressurgir les saisons de zarzuela tandis que Genet partageait la scène avec Barillet et Grédy, et tous deux ont su trouver des acteurs, des salles, des directeurs et un public.
Renée Falconetti, la Jeanne d’Arc de Dreyer, est morte à Buenos Aires en 1946. Son décès eut lieu quatre ans après l’incendie — le 24 septembre 1942 — d’un théâtre prestigieux, l’Ateneo, qui fut probablement victime d’un attentat contre Louis Jouvet. Cet instable — si on lui demandait son avis sur De Gaulle, il disait préférer Pétain et si vice-versa, il répondait versa-vice — y triomphait dans L’ÉCOLE DES FEMMES. Le feu sacré exagéra également la dose dans les années soixante-dix, au détriment, cette fois, de Madeleine Renaud et de qui perdirent de l’argent et des décors dans l’incendie du Théâtre Cervantes. (Ces tournées constantes de troupes françaises étaient tout un événement social : les dames faisaient des vocalises devant leur miroir, la bouche en cul-de-poule, pour retrouver le français rouillé de leur baccalauréat parisien, car savoir rire à la plus petite allusion humoristique était le signe d’une bonne connaissance de la langue.)
À l’Alvear Palace Hotel, Louis Jouvet en smoking donna une conférence devant une salle pleine : « Molière, homme de métier ». Il l’illustra avec le premier acte du MISANTHROPE. Mise en troupe et mise en trop * : toujours en 1942, aux antipodes de la société qui se retrouvait à l’Alvear, certainement dans un de ces bars portuaires qu’il fréquentait après son travail dans une banque, Gombrowicz griffonnait LA NOCE. Tout aussi éloigné du quartier résidentiel de l’avenue Alvear, dans la populeuse avenue de Mayo, le public de ces compagnies de zarzuela qui échangeaient l’été madrilène contre l’hiver austral, était formé d’un conglomérat d’émigrants nostalgiques et hispanophiles, qui comprenaient, sans s’en rendre compte, que la zarzuela espagnole lui était plus proche que l’opérette viennoise.
Pour ne pas sombrer dans la préhistoire, prenons comme point de départ le début des années soixante, celles de la guerre froide dans le monde et d’une répression sournoise en Argentine. Toute cette décennie est le théâtre d’une explosion culturelle qui réveille encore des échos en Europe. À partir de l’amateurisme, en effet, des théories opposées (telles que la méthode des « si » de Stanislavky prônée par Alejandra Boero et Héctor Alterio, le spontanéisme du happening du Teatro Di Tella, le classicisme rigoureux d’Alfredo Alcón et d’Osvaldo Bonet, la superficialité bien rythmée de l’Instituto de Arte Moderno, l’école naturaliste d’auteurs tels que Roberto Cossa et Osvaldo Dragün) se rejoignent en une révolution identique qui finit par transformer les assises d’un théâtre que l’on disait commercial. Les amateurs * étaient devenus des professionnels et leur production théâtrale avait trouvé un vrai public. Il y eut même un off du off avec une grande figure de la scène tragique, Hugo Marin (qui montait et démontait du Racine, qui savait brasser des intrigues capables de dynamiter à l’avance son spectacle, pour qu’il puisse le recommencer à zéro), ou avec un grand acteur du théâtre européen des années soixantedix, Victor Garcia, qui dans le Buenos Aires de l’époque n’était qu’un spectateur parmi d’autres ; ou encore avec des personnalités comme Carlos Trafic — depuis une décennie en tournée constante en Hollande et en Allemagne. Tous ces chanceux surent saisir la perche du Festival de Nancy, de Jack Lang, pour passer en Europe.
De quoi ce théâtre est-il indépendant ? De tout. Le mouvement que l’on appelle indépendant le fut aussi vis-à-vis de lui-même, du moins entre 1930 et 1960. IL y avait, d’une part, la rue Corrientes (avenue et archétype de Buenos Aires, axe central de restaurants fréquentés par les noctambules, de cafétérias, de dancings, de librairies ouvertes toute la nuit et évidemment refuge au petit matin du monde du théâtre), où Le théâtre dit commercial reproduisait avec plus ou moins de bonheur ce qu’à Paris on appelle le théâtre de boulevard *, pendant que les enseignes lumineuses trouaient la nuit avec des noms tels que celui de l’exilé catalan Alberto Closas, de la tragédienne espagnole Lola Membrives, de Miguel Ligero, le républicain en exil, de la française Tilda Thamar. Et il y avait, d’autre part, les nombreux quartiers de la ville et les rues avoisinantes du centre, qui abritaient des théâtres dans des salles grandes ou petites, les unes placées sous l’invocation soviétique, les autres vaguement catholiques, d’autres encore naturalistes, la plupart le souffle coupé par l’écho de l’avant-garde parisienne, étoile du nord immanente de ce Sud.
Tour à tour, les acteurs et les directeurs de théâtre étaient Dr. Jekyll et Mr. Hyde : ils travaillaient dans des banques — il faudra qu’un jour quelqu’un se donne la peine d’expliquer le rôle social de ces temples de l’argent, creuset pourtant de poètes, de chanteurs de tangos, de comédiens, grâce à leur horaire de rentiers : de midi à 18 heures, du lundi au vendredi — ou ils exerçaient des métiers tautologiques comme celui d’user ses chaussures à en vendre de porte en porte, comme ce fut le cas pendant vingt ans, pour Héctor Alterio, aujourd’hui acteur de réputation internationale. Tout comme les autres comédiens et metteurs en scène de théâtre indépendant, Alterio cachait ses souliers de survie vers sept heures du soir et retrouvait sa véritable famille, sa vraie vie. Au théâtre il n’y avait pas seulement des textes et des gestes, il y avait aussi des marteaux et des clous, un travail de technicien, de personnel d’entretien, d’administrateur. Vers huit heures du soir, les sous-sols des bars, les caves d’édifices vétustes, les salles paroissiales, les locaux d’écoles, les clubs sociaux répercutaient l’écho, avec plus ou moins de bonheur, avec ou sans talent, des mots couchés sur papier un jour, fort éloigné dans le temps et dans l’espace, par Sophocle, O’Neill, Tolstoï, Salacrou, Calderón, Brecht, Edward Albee, Ibsen, Shakespeare, Tennessee Williams. Grâce à ces agitateurs de catacombes, le public de Buenos Aires n’eut pas à se languir de Godot car EN ATTENDANT GODOT, par exemple, fut porté à la scène en 1956.
(La schizophrénie a parfois été plus forte que la dualité de courtieracteur : un auteur qui a renouvelé le théâtre dans les années 50 – 60, Carlos Gorostiza, était le frère de Analfa Gadé, vedette du boulevard * et qui en outre remportait un franc succès dans le théâtre commercial espagnol. Le mythique Teatro del Pueblo disposait d’une salle municipale et d’une subvention même s’il prônait le communisme pur et dur de Staline, le petit père des peuples).
Flashback
Le couple Renaud-Barrault est venu pour la première fois à Buenos Aires en 1950. Il se produisit évidemment à l’Odeén, réplique de l’‘Odéon parisien et construit à la fin du XIXè siècle au carrefour Le plus couru de la capitale, formé par les rues Corrientes et Esmeralda, celui où « n’importe quelle femme laide et prétentieuse/ rêve de l’allure/ de Carlos Gardel ». Sur sa marquise ont brillé en lettres de feu les noms d’Eleonora Duse, d’Ana Pavlova et son ballet, du Piccolo Teatro de Milano, de la Compania dei Giovanni, de Maria Guerrero et Fernando Diaz de Mendoza, de Vera Vergain, d’Elvire Popesco.
Du point de vue institutionnel, en 1936, un événement marquant fut la création d’un théâtre national sur le modèle de la Comédie Française, au Théâtre Cervantes. Celui-ci avait été offert à la ville par Maria Guerrero et Fernando Diaz de Mendoza. La salle, classique, en rouge et or, détruite par l’incendie qui devait interrompre la dernière saison du couple RenaudBarrault, fut reconstruite avec une fidélité scrupuleuse.
Enfin, conséquence directe de l’officialisation et du triomphe du modèle indépendant, il faut mentionner le Théâtre municipal General San Martin, au cœur de la rue Corrientes. Il fut inauguré vers les années soixante-quinze. Ses nombreuses salles donnent sur un hall central où, en soirée, sont offerts des spectacles gratuits réunissant quotidiennement deux à trois mille personnes. Cette foule envahit Les trottoirs de la rue Corrientes et arrête parfois le trafic. Selon Ernesto Schéo, « le San Martin est sans aucun doute l’unique institution officielle où le peuple argentin se sent vraiment chez lui ».
La dernière manifestation énergique et originale du théâtre argentin fut la création du Teatro Abierto, en 1981, lorsque la dictature militaire (1976 – 1983) frétillait encore de la queue. Son répertoire de courtes pièces insolentes montées au Teatro del Picadero, victime d’un incendie suspect qui ne parvint cependant pas à interrompre le cycle des représentations, fut le symbole d’une culture qui palpitait encore, une culture dont de telles œuvres étaient l’expression. En 1982, l’enzyme qui faisait fermenter la polémique s’épuisa presqu’en même temps que la dictature. Depuis lors, selon la critique de Buenos Aires, seuls quelques cas isolés, par exemple le travail de comédien et de metteur en scène d’Alfredo Alcón, rappellent la vivacité du théâtre argentin. L’offre insolite de cours d’interprétation s’inscrit non seulement dans la continuité logique du virus pédagogique qui a atteint le secteur en 1960, mais est aussi une source de travail dans une profession qui compte cinq mille interprètes (inscrits à l’Association argentine des acteurs) et dont seulement quelque deux cents peuvent se prévaloir d’un emploi régulier. Ceux qui se sont fait un nom en Europe — Alterio, Alcón, Lautaro Murúa, Walter Vidarte ou Norma Aleandro — imitent les hirondelles en profitant du décalage * de l’hémisphère. Quand l’été de Buenos Aires rend le chômage plus évident, les étoiles de la scène traversent la mer pour honorer leurs contrats européens ou américains.
Un théâtre national
La Duse, Jouvet, Barrault, Vittorio Gassmann.. tous les grands noms de la scène ont présenté quelque chose — au sens le plus littéral — à Buenos Aires. Du théâtre grec aux irascibles anglais, des naturalistes ‘américains aux élisabéthains, tout le répertoire de l’Orient et de l’Occident a été porté au moins une fois sur les planches. Les mesures d’un théâtre résolument argentin obéissent d’abord à un rythme de mazurka et, finalement, à celui d’un tango, au moment de l’apogée insensée d’une ville qui chaque soirée remplissait les salles, entre 1890 et 1930, et quand, d’autre part, l’Argentine se hissait au troisième rang des pays les plus riches du monde. Ou encore, quand les statistiques de 1895 signalaient que Buenos Aires était le premier importateur de champagne *. Ceux qui n’étaient pas au rendez-vous théâtral se retrouvaient au cinéma, dans un cabaret comme voyeurs ou applaudissaient en direct un orchestre typique. Entre 1945 et 1955 on ne compte pas moins de 500 théâtres en activité.
En 1804, six ans avant la déclaration de l’indépendance, fut commencée la construction du Théâtre Coliseo. Comme une prémonition de ce qu’allait être le rythme de croisière de la Nation, il y eut un demi-siècle de bâillement : le théâtre fut inauguré en 1856, sous le nom de Teatro Colо́n, et eut des représentations jusqu’à sa démolition en 1888. Les chroniques mentionnent qu’il pouvait contenir 2500 spectateurs et qu’il était toujours plein. Toujours en 1804 mais à deux pâtés de maisons de là, José Olaguer i Feliú, fils d’un vice-roi qui fut le page de Charles IIT, édifia le Teatro Provisional de Comedia ou Coliseo Provisorio, ouvert jusqu’en 1878 et qui logea les premières figures vraiment nationales, telles Trinidad Guevara ou José Aurelio Casacuberta. Au cours d’un de ces baptêmes que favorisent les changements de régime, le dictateur Rosas lui donna le nom de Teatro Argentino.
Il est évident qu’aucune histoire du théâtre universel ne mentionne des titres comme celui de EL DETALLE DE LA ACCION DE MAIPU [Le détail de l’action de Maipú] (1818) ou celui de LAS BODAS DE CHIVICO Y PANCHA [Les noces de Chivico et de Pancha] (826). Ces pièces furent néanmoins les grands succès du premier théâtre réellement argentin. Le cirque créole, où débutèrent les frères Podestá fit partie de la genèse du mouvement théâtral. En 1884, le Gran Circo Internacional de los Hermanos Carlo qui se présentait au centre de Buenos Aires avec sa vedette étoile, le clown anglais Franck Brown, décida de récompenser la faveur du public avec une première locale. Le directeur du cirque avait lu JUAN MOREIRA, le feuilleton d’Eduardo Gutiérrez qui avait passionné les lecteurs deux ans auparavant. Il demanda l’autorisation à l’auteur de monter une pantomime. Celle-ci lui fut accordée avec la condition expresse qu’aucun acteur étranger ne puisse jouer le rôle-titre. Comme à ce moment le cirque créole des Podestá se produisait dans le sud de la ville et que sa tête d’affiche, Pepe Podestá, était chanteur et bon cavalier, les Carlo fusionnèrent les deux troupes et obtinrent un éclatant succès avec leur gaucho chéri. Le 10 avril 1886, dans un village de la province de Buenos Aires, les Podestá, qui avaient recueilli les dialogues du feuilleton, présentèrent pour la première fois la version complète. Quatre ans plus tard, elle devait leur assurer leur premier vrai triomphe et leur permettre de s’installer, pour la première fois sans partenaires, au Théâtre Politeama, le temple de la renommée. Tout comme SOLANÉ, œuvre dramatique de Francisco F. Fernández écrite en 1872 (année de la publication de MARTIN FIERRO, poème de José Hernández qui deviendra bientôt l’étendard du créole), JUAN MOREIRA est le premier fait marquant d’un genre unique et triomphant, Le théâtre gauchesco, qui traite de la pampa et des gauchos et qui introduit même un langage particulier, stylisation de celui qui se parlait dans la province de Buenos Aires. Certains critiques vont même plus loin en affirmant que JUAN MOREIRA est le premier témoignage d’un théâtre national.
Dans son INTRODUCCION A SIETE SAINETES PORTENOS [Introduction à sept saynètes de Buenos Aires] (Losange, Buenos Aires, 1958), le spécialiste Luis Ordaz affirme que « notre théâtre n’a pas, en guise de crèche magique de Bethléem, le chapiteau d’un cirque ambulant ». Martin Coronado, par exemple, écrit des œuvres théâtrales à partir de 1869 et monte deux pièces avec la compagnie espagnole d’Hernán Cortés, LA ROSA BLANCA [La rose blanche], en 1877, et LUZ DE LUNA Y LUZ DE INCENDIO {Clarté de lune et lueur d’incendie}, en 1878. Avec la même distribution, en 1885, il présente sa pièce SALVADOR. Avec une autre troupe espagnole, celle de Mariano Galé, il porte à la scène CORTAR POR LO MAS DELGADO [Couper par la partie la plus mince] (1893), UN SONADOR [Un rêveur] (1896), JUSTICIA DE ANTANO {Justice de jadis} (1897). En 1902, la troupe la plus célèbre de l’époque, José J. et Jerònimo Podestá, donne la première de LA PIEDRA DEL ESCANDALO {La pierre du scandale} au Théâtre Apolo, pièce qui lui vaut d’être reconnu du public. Son cas est semblable à celui de Enrique Garcia Velloso dont les pièces —- GABINO EL MAYORAL [Gabino le majordome], entre autres — sont montées indistinctement par des troupes de zatzuela ou de théâtre créole. Dans un travail sans maîtres ni disciples, l’essayiste Ordaz relie le théâtre à l’actualité argentine. Par exemple, il affirme qu’«avec la chute de Rosas le nationaliste, arrivent les capitaux anglais qui changent les structures sociales et économiques de Buenos Aires et isolent la ville du reste du pays. L’écho d’un tel changement, continue-t-il, se répercute dans les pièces de théâtre burlesques de l’époque ». Le besoin d’importer une force de travail est satirisé dans la petite pièce DON QUIJOTE EN BUENOS AIRES [Don Quichotte à Buenos Aires], d’Eduardo Sojo, écrite en 1895. Il en résulte que le flot de voyageurs de troisième classe « à qui l’on avait fait croire que non seulement il y avait du travail — ce qui était vrai puisque tout était à faire — mais aussi que s’ils sortaient dans la rue, les livres sterling leur pleuvraient sur la tête » alimenta le matériau qui, du point de vue théâtral, devait déboucher sur trois genres originaux et novateurs : le zarzuélisme créole , la « sainete » de Buenos Aires et, finalement, le grotesque créole, genre d’une force énorme et qui eut ses auteurs aujourd’hui considérés comme classiques, tels qu’Armando Discépolo. Un théâtre rural auquel s’ajoutait une vaste culture de théâtre radiophonique — des troupes conjuguaient d’éternelles tournées provinciales à l’indispensable et quotidienne présence dans les stations de radio de la capitale et de portée nationale — était l’unique écho de la prédominance de la scène de Buenos Aires. En 1905, EN FAMILIA [En famille], de Florencio Sánchez, un futur classique, montre l’émergence d’une autre caractéristique de la capitale argentine : une classe moyenne en ascension théorique.
Pendant ces années, charnière entre deux siècles, les salles poussent comme des champignons, du moins à Buenos Aires. Les plus grands noms de la scène mondiale se reflètent dans ce miroir européen du bout du monde. L’historien Ricardo Rojas a pu critiquer « la bourgeoisie de Buenos Aires [qui] en applaudissant et en payant grassement les spectacles étrangers, faisait preuve d’un louable raffinement esthétique mais dédaignait injustement les expériences locales. Une minorité cultivée pouvait jouir d’un théâtre inactuel et exotique, mais la majorité sensible avait besoin d’un théâtre qui lui fût propre, qui représenterait le drame de sa propre existence ».
En 1897, la zarzuela hispanique engendra ses premiers métis : LOS POLITICOS [Les politiciens], de Nemesio Trejo, et JUSTICIA CRIOLLA [Justice créole], d’Ezequiel Soria, sur une musique d’Antonio Reynoso. Ainsi naissait la zarzuela créole qui, l’année suivante, devait inspirer aux Podesté leur ENSALADA CRIOLLA [Salade créole], première comédie musicale nationale qui introduisait une nouveauté : trois ferrailleurs qui chantaient et dansaient le tango.
Il est évident que la réalité n’est pas aussi linéaire que ce récit voudrait le faire croire : entre deux créations, les comédiens avaient les ennuis que des mélodrames raconteront par la suite. Même les Podestä durent se faire engager par une compagnie de zarzuela espagnole et participèrent (« le côté comique du spectacle ») à des corridas de taureaux aux cornes boulées. C’est au moment de leur séparation — en 1901 — que les frères Podesté décident de troquer l’arène pour la scène. Chacun réussit de son côté avec de nouveaux auteurs comme Sánchez, Gregorio de Laferrère ou Roberto J. Payrо́. Par ailleurs, le zarzuelisme créole, qui atteindra son point culminant avec la sainete, est totalement tributaire de certains acteurs espagnols qui, selon Enrique Garcia Velloso, dans ses MEMORIAS DE UN HOMBRE DE TEATRO [Mémoires d’un homme de théâtre], surent se transformer en « parfaits interprètes des types argentins de la campagne et de la banlieue ». Velloso créa aussi un archétype, le Gabino de GABINO EL MAYORAL, pour la soprano madrilène Irene Alba. Dans ce cas, il n’y avait pas seulement un changement de nationalité mais aussi de sexe. (Ce jeu théâtral de va-etvient se manifeste aussi lorsque la plus grande chanteuse du siècle, Raquel Meller, introduit dans son répertoire le tango « Milonguita », composé pour le Delikatessen Hause, de Lining et Weisbach, présenté pour la première fois au Teatro Opera le 12 mai 1920 et enregistré peu de temps après par l’espagnole Lola Membrives.) Il est intéressant de rappeler que l’indivision des genres et des sexes a caractérisé le théâtre universel, jusqu’à ce que la pudibonderie de ce siècle ne vienne y réintroduire des séparations. Il faut aussi noter qu’une scène de la zarzuela LA GRAN VIA, le tableau des « trois chapardeurs », a su arracher des mots admiratifs à Frédéric Nietzsche qui l’avait vu représenter en Italie. « De toute ma vie, disait-il, c’est la chose la plus forte que j’ai vue et entendue, même au point de vue musical ; quelque chose de génial, d’impossible à qualifier ».
À quinze mille kilomètres de Zarathustra, un acteur, metteur en scène et noctambule mythique de Buenos Aires, Elias Alippi, écoute Carlos Gardel, en 1917, dans le tango « Mi noche triste ». Immédiatement il décide d’ajouter ce rythme encore jeune dans LOS DIENTES DEL PERRO [Les dents du chien], pièce en un acte et deux tableaux de José González Castillo. Pour la première partie, l’auteur demandait « un intérieur de cabaret » et plaçait « un orchestre typique, à gauche, sur une estrade ». L’orchestre était important : celui de Roberto Firpo qui, selon le connaisseur Blas Matamoros, représentait « la première génération de musiciens de cabaret ». Le premier rôle, l’actrice Manolita Poli, débutait comme chanteuse avec « Mi noche triste ». Le succès qui s’ensuivit donna naissance à ce qu’Ordaz devait appeler « notre authentique commedia dell’arte » et « la sainete à deux temps (2/4)»: paroles de tango théâtralisées, spectacles concentrés dans un tango qui préfiguraient les clips d’aujourd’hui. « Les vingt ou vingt-cinq lignes de texte de chaque partie chantée d’une zarzuela, écrivait Horacio Ferrer, parolier du tango * et auteur avec Astor Piazzolla de la célèbre « Balada para un loco », vont résumer la situation entière, Les créatures, le climat et le ton d’une sainete en trois tableaux, d’une durée d’une heure ». Si le tango et la sainete ont brillé et se sont éclipsés mutuellement « comme des frères siamois », dit José Barcia dans TANGOS, TANGUEROS Y TANGOCOSAS [Tangos, amateurs de tango et choses concernant le tango], c’est sans doute pour la même raison : dans les deux cas, il s’agissait d’une chronique de l’actualité, avec l’étiquette « époque actuelle », selon les indications de l’auteur, qui a fini par se convertir en pastiche passéiste. La revue de musichall s’est également appuyée sur le tango mais l’influence française y était prédominante. Dans les années 20, le Bataclan de Paris, avec une Mistinguett déjà mûre mais encore efficace, étonna Buenos Aires. Dans les années 50, ce fut au tour du Lido et des Folies-Bergères et, curieusement, son théâtre le plus emblématique, le Nacional, finit par accueillir des comédiens-auteurs tels que Norman Brisky. Si dans les années 60 ceux-ci eurent leur public dans le théâtre intellectuel, vingt ans plus tard, ils s’imposaient dans lessalles de la rue Corrientes, antichambre ou conséquence de la télévision. Une diva du théâtre, du cinéma et du tango argentins, Tita Merello, qui sur scène montrait encore ses jambes au milieu des années 80, débuta en 1927, comme « vedette putain », au Théâtre Maipo, avec le tango spirituel « Pedime lo que querés » [Demande-moi ce que tu veux]. Par ailleurs, celle qu’on devait appeler « la grande dame de la scène », Iris Marga, théâtralisa le tango « Juliän », toujours au Maipo, considéré comme « le Bataclan créole ». La comédie musicale typique de Buenos Aires trouva son meilleur représentant dans le compositeur de tangos par excellence, Enrique Santos Discépolo. Il faut mentionner aussi que lors de la renaissance théâtrale de Buenos Aires au cours des années 60, un cabaret de style allemand, le Gotan, présentait en alternance les premières pièces naturalistes de Roberto Cossa et les tangos du trio — qui se convertit en quartette — Cedrén, dont les membres allaient s’exiler longtemps à Paris. Des auteurs cultivés de la décennie 50 — Juan Carlos Ghiano, Leopoldo Marechal et surtout Alberto Rodriguez Muñoz, dont une des œuvres permit à Piazzolla de lancer son « Tango del Angel » — eurent encore recours à une musique populaire qui vivait son propre regain, au début de la dernière décennie du siècle.
Épilogue d’un présent au futur indéfini