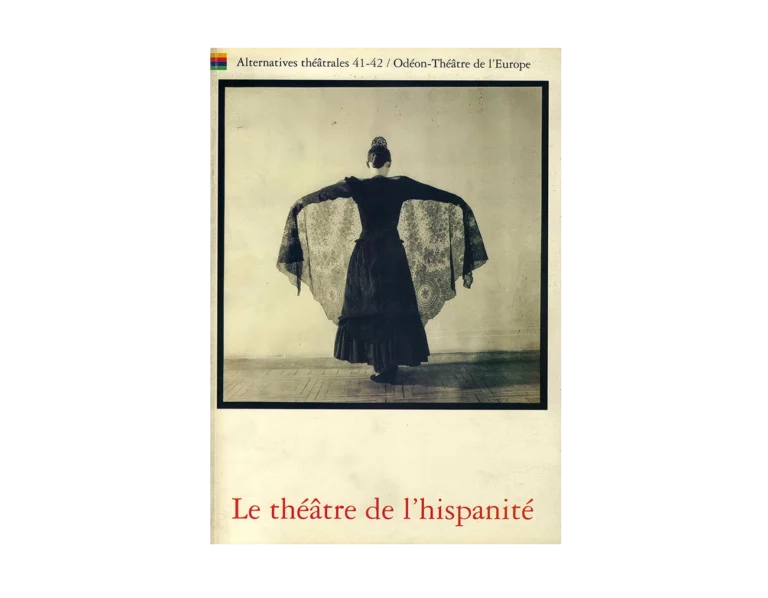À AUCUN moment les contacts entre la littérature française et la littérature espagnole ne semblent avoir été aussi favorisés qu’au XVII siècle. Alors que le goût de la cour était de mieux en mieux pris en compte par les lettrés, cette cour se trouvait justement presque obligée de s’intéresser aux choses de l’Espagne puisque de 1612 (date des fiançailles de Louis XIII avec Anne d’Autriche) à 1683 (date de la mort de MarieThérèse, épouse de Louis XIV), sa plus grande dame appartint à la famille royale d’Espagne. On but le chocolat comme les Espagnols, on apprécia, avec les oreillers, leur goût du confort, on apprit leur langue : les professeurs et les méthodes se multiplièrent et il fut mal porté, jusqu’en 1683, bien que l’italien restât le véhicule incontesté de la culture, de ne pas savoir s’exprimer dans l’idiome de la reine ou de la régente. Mais l’on aurait tort de croire, malgré la renommée dont bénéficient aujourd’hui les productions artistiques et littéraires du Siècle d’or, que la pratique de la langue ou l’activité de traduction impliquaient attachement ou admiration à l’égard de la culture hispanique. Chapelain, donnant en 1620 une traduction du roman picaresque de Mateo Alemán, GUZMAN D’ÂLFARACHE, exposait complaisamment dans une préface tous les défauts de l’ouvrage qu’il avait traduit, comme l’avait fait Vital d’Audiguier en mettant en français, quelques années plus tôt, le texte de DON QUICHOTTE. On ne reprochera ni à l’un ni à l’autre de n’avoir pas cherché à traduire fidèlement — on n’était alors guère fidèle non plus aux textes latins ou italiens — mais l’on s’étonnera qu’ils aient estimé avoir amélioré les œuvres originales ! En fait, l’œuvre espagnole était a priori suspecte, comme la nation espagnole elle-même. Beaucoup pensaient alors, comme La Mothe Le Vayer, auteur d’un ouvrage sur la question, qu’il existait une contrariété d’humeurs entre les deux plus grandes puissances d’Europe, les deux luminaires du monde. Évidemment la rivalité politique expliquait cette résignation : le premier mariage franco-espagnol n’y avait pas mis fin ; quand Gaston d’Orléans voulait comploter contre son royal frère, c’était en Espagne qu’il cherchait ses appuis ; la guerre reprit en 1635, la disparition de Richelieu et la régence d’Anne d’Autriche ne l’empêchèrent pas de continuer ; il fallut attendre le traité des Pyrénées et le déclin de la puissance espagnole pour que l’hispanophobie refluât. De la même manière qu’on caricaturait les mœurs d’Outre-Pyrénées (notamment dans des ballets grotesques), on caricaturait les productions de l’esprit espagnol. Parmi elles, les œuvres dramatiques étaient les plus décriées.
Il faut dire que l’ambition des poètes dramatiques espagnols n’avait rien à voir avec celle des gens de lettres français. Alors que les auteurs dramatiques, de ce côté des Pyrénées, à l’instar des écrivains pratiquant d’autres genres, montrèrent un intérêt de plus en plus vif pour la publication de leurs œuvres, gage de la durée d’une réputation, signe lancé vers les siècles futurs, espoir d’être considéré un jour comme Sophocle ou Sénèque, ceux de l’autre côté semblèrent toujours se préoccuper davantage de leurs contemporains que de la postérité et se réjouissaient surtout que le public vint voir leurs pièces. Et il venait, serré, mêlé, ravi, dans toutes les grandes villes, où l’on avait construit des théâtres, Les corrales ! Ce n’était que plusieurs années, voire plusieurs décennies, après sa première représentation qu’une comedia (ainsi désignait-on, le plus souvent, n’importe quel type de pièce) était publiée, souvent dans une édition collective d’une dizaine d’œuvres du même auteur, parfois dans une anthologie des « meilleurs esprits du siècle », les éditeurs, peu soigneux, commettant fréquemment des erreurs d’attribution ! Ce goût du succès immédiat paraissait aux lettrés français de mauvais aloi, le grand public ne pouvant, selon eux, applaudir qu’aux farces ou aux œuvres hétéroclites comme les Mystères dont certaines représentations données dans le Théâtre de Bourgogne gardaient la nostalgie malgré leur interdiction au milieu du XVIè siècle. Il ne leur venait pas à l’idée que des œuvres de qualité pussent être appréciées pourvu qu’elles fissent, dans des intermèdes joués ou dansés, quelques concessions à la fête. En France, c’était aux lettrés bien plus qu’au grand public qu’il fallait plaire pour être considéré. Corneille ayant argué du succès public du CID pour le défendre en 1637 contre ses détracteurs se vit justement reprocher par Scudéry d’utiliser le même honteux argument qui fut celui de Lope de Vega pour justifier, auprès de doctes et peut-être fictifs membres d’une académie littéraire, sa façon de composer ses pièces de théâtre. Scudéry cita, en les lançant comme une injure à la tête de Corneille, une quinzaine de vers du très désinvolte ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS que Lope avait publié en 1609.
Ainsi, les récits que les voyageurs pouvaient rapporter de la vogue extraordinaire du théâtre en Espagne n’étaient-ils pas de bonnes ambassades pour s’intéresser aux œuvres écrites tra los montes. Les quelques représentations de comedias qu’on put voir à la cour ou au Bourgogne étaient également de nature à occasionner la migraine à Malherbe, qui les trouvait trop remuantes : sans doute les danses populaires, les chansons ou simplement la musique qui se trouvaient incorporées au texte même d’une comedia, gaie ou triste, Les intermèdes hilarants ou les ballets qu’on donnait dans les entr’actes, paraissaient-ils exhiber la personnalité de la nation ennemie tandis que le moindre morceau d’éloquence était perçu comme une preuve de l’inguérissable morgue espagnole, que les comédiens italiens raillaient dans leurs improvisations en la personne du Matamore à l’énorme fraise et aux moustaches recourbées, pour le plus grand plaisir du public français.
Comme, à partir de 1630, les partisans de la liberté dans la composition dramatique perdirent beaucoup de terrain dans la lutte qui les opposait aux défenseurs zélés de la manière antique, les hispanophobes trouvèrent un prétexte supplémentaire pour se déchaîner contre le théâtre d’outre-Pyrénées dont les auteurs n’avaient cure ni de l’unité de temps recommandée par Aristote ni de l’unité de lieu recommandée par ses exégètes de la Renaissance et, de surcroît, associaient le comique et le grave dans une même pièce. Lope de Vega disait que le public espagnol aimait qu’on lui racontât tout, depuis la Genèse jusqu’au Jugement dernier : comment une telle fringale d’événements aurait-elle pu s’accompagner de règles ? Cependant Lope recommandait aux auteurs de placer entre les actes (journées) Les temps morts, qui pouvaient être longs. Corneille, ou plutôt Alcandre, le magicien-homme de théâtre de L’ILLUSION COMIQUE, ne fait pas autre chose pour évoquer l’existence tumultueuse de Clindor, mais peu de Français voulurent bien prêter attention à cette sagesse de Lope.

En fait, l’anarchie ne régnait nullement dans les comedias et Marc Vitse a bien montré que les auteurs espagnols pratiquaient une sorte d’aristotélisme d’instinct, qu’ils étaient capables, au fond, comme Dorante le recommande dans LA CRITIQUE DE L’ÉCOLE DES FEMMES, de ces « quelques observations aisées » du bon sens que Molière voit à l’origine des « règles ». Au reste, les auteurs espagnols ne sortaient pas de la lie du peuple et avaient presque tous reçu une excellente culture ancienne à l’égard de laquelle ils se montraient libres mais non pas hostiles. Il arriva à Lope de respecter la règle des vingtquatre heures parce qu’elles convenaient à son sujet : il s’en amusa beaucoup. En France, les auteurs de tragi-comédies continuèrent au moins jusqu’en 1640 de mêler à la gravité des éléments plaisants et Corneille affirme tranquillement en 1648 qu’il refuserait de perdre un « beau sujet » s’il était impossible de le réduire à vingt-quatre heures. Or, les auteurs français les moins sectaires admiraient justement chez les Espagnols leurs « belles inventions », c’est-à-dire les sujets étonnants ou charmants ou subtils qu’ils se plaisaient à imaginer. Boisrobert le dit et imita certaines comedias des plus plaisantes, Corneille le dit, à propos de LA VERDAD SOSPECHOSA d’Alarcón, et imita cette comédie mais aussi des pièces plus graves. Alors qu’au XVIè siècle, les Italiens avaient surtout modernisé les intrigues imaginées par les poètes dramatiques latins Plaute et Térence, réussissant moins bien dans leurs tentatives de restauration de la tragédie, les Espagnols apportaient au XVIIÈ siècle des thèmes nouveaux, une construction nouvelle qui leur était liée, et cet apport était perceptible par delà les détails du style, par delà le mélange du grave et du gai, par delà la diversité des lieux dans lesquels l’action se déroulait. Les véritables dramaturges français ne s’y trompèrent pas et refusèrent de frapper d’ostracisme les comedias qui avaient pu se frayer un chemin jusqu’en France, quelques autres suivirent un peu par opportunisme la mode ainsi créée.
Jean Rotrou (1609 – 1650) futun des premiers à se laisser séduire par l’imagination des Espagnols et par les imiter aussi bien qu’il imitait les Italiens. Il reprit dans des comédies ou tragi-comédies la fable de plusieurs comedias de Lope de Vega, flattant le goût d’un certain romanesque, dans LA BAGUE DE L’OUBLI (représentée en 1629), LES OCCASIONS PERDUES (1633), LA BELLE ALPHRÈDE (1636), LAURE PERSÉCUTÉE (1637), il sut aussi à l’occasion, dans une œuvre originale, emprunter une scène réussie à telle comedia. Rotrou ne traduisait pas, il modifiait lieux et circonstances, moralisait les attitudes et paroles des personnages, oubliait même son modèle pour écrire la fin de la pièce.
C’est moins aux aventures qu’à un goût de l’intrigue subtile et plaisante que sacrifièrent, principalement entre 1640 et 1660 Le Métel de Boisrobert, son frère, D’Ouville, Thomas Corneille et Philippe Quinault en imitant à leur tour non pas Lope mais ses épigones, Calderón surtout, mais aussi Tirso de Molina, Moreto, Antonio de Solis, Rojas Zorrilla. Les personnages voyagent moins mais se déguisent, mentent, se trompent, doivent continuer de mentir pour soutenir un premier mensonge ; ils ont deux identités, se volatilisent. La légèreté règne en maîtresse. Ce n’est pas ce qu’on peut dire des comédies de Paul Scarron, inspirées également d’auteurs espagnols divers — notamment Rojas Zorrilla — mais centrées sur le personnage du valet qui ravit la vedette à son maître en se faisant passer pour lui ou en prenant (croyant prendre) ses attitudes et en se ridiculisant à qui mieux mieux, lourd, grossier. Le valet devient ainsi un personnage de farce : Scarron en était conscient puisque plusieurs de ses comédies portent le nom, augmenté d’une épithète descriptive, du farceur Jodelet, au visage enfariné et à la voix nasillarde, qui incarnait ce valet, et ces titres indiquent bien que l’ambition de l’auteur se limitait à provoquer le rire.
Or, la fonction de loin la plus fréquente du gracioso, dans la comedia,consistait à la fois à faire prendre de la distance par rapport à son maître et à mettre celui-ci en valeur en faisant rire de lui-même. Le gracioso peut être spirituel et c’est ce qu’ont très bien perçu Rotrou, en créant le personnage de Darinel dans AGÉSILAN DE COLCHOS et Corneille en créant, dans LA SUITE DU MENTEUR (1643) et d’après un gracioso de Lope, celui de Cliton, qui prouve de la part du grand poète une approche beaucoup plus compréhensive de l’esprit général du théâtre espagnol que celle de ses contemporains.
Au reste, Rotrou et Corneille, non contents d’imiter des comedias gaies (bien que Corneille ait poussé la sagacité jusqu’à trouver chez Alarcо́n la matière mi-romanesque mipsychologique de son MENTEUR), imitèrent aussi, c’était beaucoup plus courageux dans une ambiance hispanophobe, des comedias à sujet grave. L’imitation des MOCEDADES DEL CID de Guillén de Castro, au demeurant auteur fort peu connu en France, ne manquait pas d’audace même sous l’appellation de tragicomédie car le sujet, ouvertement historique, ne pouvait avoir été assez dignement traité par les Espagnols ! De plus, Corneille ne se contenta pas de régulariser et de simplifier le modèle, il chercha à restituer toute la foisonnante richesse d’une sorte de Geste dramatique. L’exemple venait de haut et autorisa sans doute Rotrou à tirer de Lope de Vega le beau sujet d’une tragédie sacrée, LE VÉRITABLE SAINT-GENEST (1645) dans laquelle un comédien se convertit en jouant le rôle d’un chrétien, et de Rojas Zorrilla celui d’une tragédie, VENCESLAS (1647), dans laquelle s’opposent devoir de justice et amour paternel.