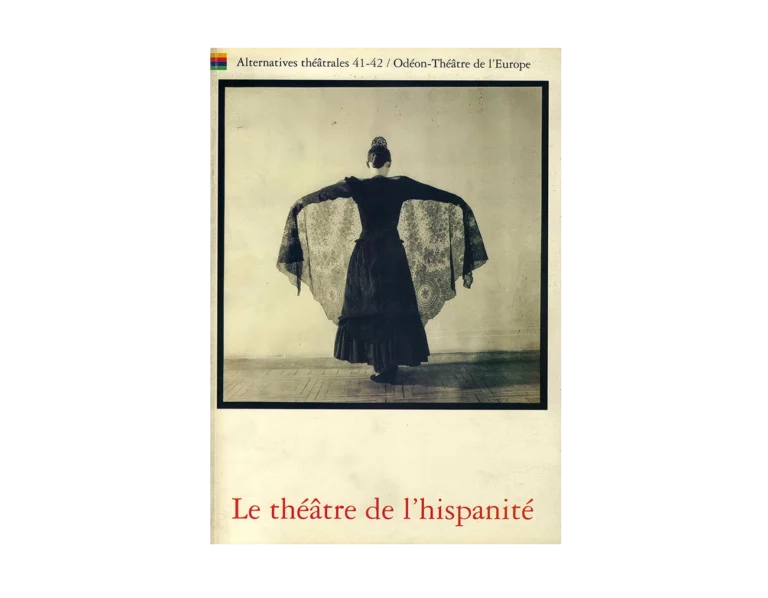JEAN TORRENT : Vous avez reçu votre formation d’acteur à Bochum, en Allemagne. Vous travaillez même quelques années dans les principaux théâtres de R.F.A. (Münich, Francfort, Düsseldorf). Puis, c’est le retour en Espagne. Pourquoi ce retour ? Comment s’est-il passé ?
José Luis Gómez : En 1970, toutes les portes m’étaient ouvertes en Allemagne. Mais j’ai pris conscience de l’attirance que j’éprouvais envers l’Espagne, c’est-à-dire vers certaines sources. Sans être nationaliste, j’éprouve un sentiment de patrie, au sens où la définit Le président de la République et grand écrivain Azaña, « la patrie pour un homme ne peut être que le paysage d’où il vient, La langue qu’il parle, la tradition historique dont il est issu, et l’art où il se reflète ». Durant les premières années de mon retour en Espagne, il n’y avait pas de subventions. J’ai monté exclusivement de la littérature allemande, parce que j’obtenais ainsi l’aide du Gœthe Institut. C’était pour moi le moyen de faire le théâtre que j’avais appris, non pas le théâtre léger auquel on était contraint en Espagne, mais un théâtre qui se confronte avec cet autre théâtre qu’est la société : die Bübne als moralische Anstalt, la scène comme institution morale.
Par la suite, dès que l’occasion m’en a été donnée, je n’ai plus monté que des textes espagnols, avec une préférence pour certaines choses qui n’avaient jamais été faites, ou qui avaient été méprisées. Azaña, par exemple. Azaña est un politicien, le faire au théâtre, c’était quelque chose d’inouï, on ne croyait pas que cela était possible. Quand j’ai monté LA VIE EST UN SONGE en 1981, ce fut un peu une redécouverte de cette pièce que les grands vieux metteurs en scène avaient montée, mais dont tout le monde se désintéressait alors.
Je suis convaincu que les Espagnols, comme manifestation de l’humain, sont des gens assez doués pour l’expression, c’est un peuple naturellement expressif. C’est pour cela que je me suis penché sur la Le théâtre des songes littérature espagnole. Calderén d’abord , Garcia Lorca ensuite, très intensément, et deux ou trois auteurs contemporains, comme José Sanchis Sinisterra. Ce ne sont pas des raisons très explicables, plutôt des succions qui vous tirent la peau et vous forcent à faire quelque chose. La mise en scène n’est pas pour MOI un gagnepain (on gagne beaucoup plus d’argent en faisant du cinéma), c’est une chance que j’ai. La mise en scène est toujours liée chez moi à la passion d’une rencontre avec certains textes qui aident dans l’ufficio di vivere.
J.T. : Qu’‘avez-vous ramené d’Allemagne que vous ne trouviez pas en Espagne ?
J.L.G. : En Espagne, les Allemands passent pour être des têtes carrées. Je ne trouvais pas cela tout à fait juste. J’ai assez bien connu l’Allemagne, j’ai été plongé dans sa culture. Beaucoup de choses nécessaires pour vivre et pour comprendre m’ont été données avec beaucoup de générosité par ce pays et par ses hommes. J’ai monté des textes allemands parce qu’une partie de ma formation et de ma culture est certainement allemande. J’ai trouvé en Allemagne une large information très formalisée, très concrète, que je ne trouvais pas en Espagne. Il y avait là une tradition qui n’existait pas chez moi, une tradition de mise en scène par exemple, avec des exploits et des trouvailles historiques. Il y avait Brecht, qui pour moi signifie toujours beaucoup, au-delà des changements politiques. Les Russes m’ont aussi beaucoup touché. Et puis il y avait la philosophie, la dramaturgie, beaucoup de choses qui n’étaient pas accessibles en Espagne. Tout cela était un choc pour un jeune garçon qui arrivait du Sud. Il existait également une belle rigueur de travail, qui n’est peut-être pas toujours aussi fameuse qu’on le prétend, mais qui existe néanmoins. J’ai vécu et bu tout cela, cela m’a semblé éloquent, j’y croyais. J’avais failli rester en France, où j’avais vu LE PIÉTON DE L’AIR de Ionesco et TÊTE D’OR de Claudel, deux mises en scène de Jean-Louis Barrault que j’admirais beaucoup à l’époque et que je continue à considérer comme un homme de théâtre extraordinaire. Mais j’ai eu la chance de voir à Francfort les mises en scène par Piscator du BALCON de Genet et de WoyzzEcK de Büchner. Ces deux spectacles m’ont véritablement bouleversé, ils n’avaient rien à voir avec ce que j’avais connu jusque-là. Bien que les difficultés de langue étaient extrêmes, j’ai pensé que l’Allemagne était peutêtre l’endroit où essayer d’apprendre le théâtre.
Aujourd’hui, je crois qu’il ya deux côtés dans le théâtre. Le travail effectué en Allemagne est certes remarquable, surtout dans la mise en scène, le questionnement entêté du texte et du jeu, la présence et l’utilisation des arts plastiques sur la scène, cet enrichissement réciproque dont les Allemands ont été à l’origine. Quand je suis retourné en Espagne et que j’ai commencé à travailler sur LA VIE EST UN SONGE, j’ai bien vu toutes les limites de ma formation allemande. C’est pour cela que je suis parti aux États-Unis, chez Lee Strasberg. Il y avait quelque chose qui manquait à ma formation, quelque chose qui était trop rigide et qu’il fallait assouplir. Je ne crois pas que Strasberg ait été la rencontre la plus remarquable que j’aie faite, mais c’était extraordinaire de voir un homme capable, en regardant un acteur, de savoir ce qui se passait dans son organisme actoral. Il y avait aussi la vieille Kim Stanley, une grande actrice issue du Group Theater fondé en 1931 par Harold Clurman, Lee Strasberg et Cheryl Crawford. Elle fut mon professeur durant plusieurs mois et nous avons beaucoup parlé de LA VIE EST UN SONGE. Un problème me hantait déjà : comment rendre les classiques, comment faire passer les actions physiques, émotionnelles, situationnelles, en dépit de ce langage qui semble rendre la tâche impossible. Par la suite, j’ai invité Strasberg à Madrid pour un laboratoire consacré uniquement aux classiques espagnols. Ce travail a été la semence d’une approche des classiques qui n’était pas, déclamatoire, mais qui allait au cœur des conflits. Pour trouver Le jeu des acteurs, il a fallu faire l’amalgame entre deux choses qui semblaient inconciliables, la procédure de Strasberg et ce qui venait d’Allemagne, l’approche du langage par les Sinnträger, les porteurs de sens. Cette démarche a permis de comprendre, par exemple, quel était le processus en action dans le monologue de Sigismond : « Plus je te vois, / et plus je m’émerveille ; / plus je te regarde, / plus je désire te regarder. / Mes yeux, je crois bien, / sont devenus hydropiques : / alors que boire sigrufie la mort, / ils boivent davantage ; ainsi les miens, / voyant que le voir me fait mourir, / meurent d’envie de voir encore. / Mais qu’ils voient et que j’en meure ; / car si te voir me fait mourir, / j’ignore, vaincu déjà, / ce que ne plus te voir me ferait ». Sigismond utilise une image pour dire que ses yeux brûlent, il se réfère à l’hydropisie et associe l’action de boire à celle de voir. Il y a là, au fin fond, un processus presque orgasmique, au moment où Sigismond voit pour la première fois une femme devant lui. Ce qui préserve ce monologue de l’emphase (et l’emphase, c’est le succédané du réel), c’est d’être cloué au processus physique qui surgit. On ne peut pas dire « Le poisson vient au monde, / sans souffle, avorton d’ulves et de limon » sans imaginer que l’on est soimême avorton, poisson sans écailles, quelque chose de lisse. Il y a toute une sensorialité qui ne se situe pas dans la bouche, mais qui est d’abord, dit Bachelard, dans la tête.
Je crois absolument à la nécessité d’une analyse très serrée du texte. L’improvisation est une technique, rien d’autre. La forme la plus haute d’improvisation se rencontre dans les arts martiaux : se mettre devant l’imprévu, ne pas savoir d’où l’attaque viendra, être prêt à réagir. Mais pour en être capable, il faut un entraînement inouï. Dans une conférence, Brook disait : « Improviser, oui, mais avec un entraînement formidable, sinon il est impossible de faire face à l’inconnu ». Bien sûr, l’improvisation comme recherche de matériau, le point situé au-delà de la fatigue, ce sont des choses fondamentales. Mais pour un metteur en scène, la connotation historique, philosophique du texte est déterminante. C’est de là qu’il extrait ce qui le touche le plus. Ensuite, il : faut oublier ce qu’on a dans la tête pour l’appréhender et le rendre de façon souple et simple avec les moyens du théâtre, les corps et l’espace. De plus en plus me hante l’espace vide, la conviction de l’espace vide. On modèle véritablement l’air et l’énergie coule d’une façon extraordinaire quand on n’a rien que des corps. Au point actuel de développement des médias, le théâtre est devenu, et je reviens à Bachelard, le dernier refuge de la poésie, le lieu où l’imaginaire individuel peut se projeter, faire des sauts qu’on ne fait pas au cinéma parce qu’il est trop concret, un espace où le courant cordial, chaleureux et spirituel du symbole s’établit le mieux. On parle peu de cela, mais si le théâtre n’est pas ce lieu de la poésie, il n’en vaut plus la peine. C’est pour cela qu’il est très important que chaque spectacle de théâtre soit parfait, dans ce qu’il veut dire et transmettre. Un spectacle doit mettre en mouvement les clés de l’imaginaire de chaque individu. Je trouve cela essentiel. Dans le spectacle LOPE DE AGUIRRE, TRAIDOR, il n’y a rien qu’un espace vide, quelques hamacs, des lanternes, une corde, un radeau et quelques objets de naufrage. C’est là que l’imaginaire et son parfum s’installent. Dans ce spectacle, il y a dix fois plus d’Amazonie que dans le film de Saura. Parce que nous travaillons avec des images poétiques, ce sont les images les plus efficaces. Je suis passionné par Jung, il y a là un dynamisme et un matériel sans limites pour le théâtre. Je ne crois pas au théâtre intellectuel. Il y a bien quelques personnes qui créent des métaphores si géniales et si puissantes Ge pense à LA MISSION de Heiner Müller), qu’elles sont comme de la poésie, de la méta-poésie sociale. Mais je crains toujours que le théâtre ne s’intellectualise trop, qu’il ne devienne trop sec. Je n’exclus pas le traitement de la parole, les préoccupations sociales ou éthiques. Mais la poésie demeure, je crois, la grande ressource du théâtre. Et son véhicule.
J.T. : Vous avez également assisté quelque temps au travail de Grotowski en Pologne. Dans votre mise en scène de LA VIE EST UN SONGE à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, on trouve comme une référence esthétique chez Sigismond, on pense à ces photographies de Riszard Cieslak dans LE PRINCE CONSTANT.
J.L.G. : Je n’ai pas vu LE PRINCE CONSTANT. Je me suis trouvé chez Grotowski au temps d’APOCALYPSIS CUM FIGURIS. J’admire le sens déontologique profond de cet homme. Il a découvert des choses absolument essentielles sur l’acteur. Dans son livre LE THÉÂTRE PAUVRE, Grotowski oppose l’acteur prostitué à l’acteur saint. Je crois qu’il a raison. Être acteur est un métier qui peut se prostituer très vite, un métier dans lequel on perd l’innocence sitôt qu’on reçoit Le reste. De ma propre expérience, j’ai acquis la conviction que le théâtre n’a survécu que dans la mesure où il est resté, dans l’essentiel, eine moralische Anstalt, une institution morale. Si la tragédie naît de rites qui touchent à la conservation de la vie, le théâtre établit dès son origine une relation avec la vie et, plus tard, avec la vie sociale, avec la polis. J’ai toujours une pensée radicale vis-à-vis de la déontologie de l’acteur, je lui fais faire des entraînements parce que je crois profondément au nettoyage de l’acteur avant de jouer, à un certain vide. On n’ignore pas les phénomènes énergétiques qui prennent place dans une salle où il y a sept cents personnes, qui reçoivent l’énergie de l’acteur, mais en même temps la sucent. Il est prouvé que l’acteur reçoit moins d’énergie des spectateurs qu’il ne leur en donne. Ce rapport énergétique, la question de l’énergie chez un acteur est une questionessentielle. L’énergie n’est pas une question musculaire, ou elle est musculaire au second degré. L’énergie est de qualité spirituelle, vibratoire. Il est nécessaire de la soigner si l’on veut obtenir des performances singulières, dans lesquelles le flux soit de qualité spirituelle. Je pense que le théâtre doit posséder comme un parfum, quelque chose qui puisse se sentir. C’est ce que j’aime dans le théâtre
J.T.: Avez-vous en Espagne une troupe constituée ou un groupe avec lequel vous poursuivez un travail sur un long terme ?

J.L.G. : J’ai une structure professionnelle et commerciale qui possède son équipement technique propre, un magasin de décor et, bientôt, sa propre salle. Mais je n’ai pas un groupe constitué de comédiens comme Brook par exemple, on ne pourrait pas les payer. Peut-être cela se fera-t-il un jour. J’ai refusé toutes les propositions qui m’ont été faites de reprendre un théâtre national1. Je crois à un petit groupe, d’où puissent sortir chaque année dix comédiens bien nettoyés. Une dizaine de personnes, deux ou trois très bons assistants metteurs en scène, qui Ont tout fait, patticipé à tout. En Espagne, trois ou quatre metteurs en scène seraient capables de réaliser un tel projet. Mais Miguel Narros ne s’y intéresse pas, Plaza à peine plus et Lluís Pasqual est à Paris. Quant à moi, je travaille relativement peu, un spectacle par an, pas plus.
J.T. : Les choix esthétiques de votre mise en scène font de LA VIE EST UN SONGE une sorte de conte moral transhistorique.
J.L.G.: En travaillant sur la pièce, une question se posait : comment représenter le baroque sans faire du baroque. J’ai demandé à mon scénographe Christoph Schubiger de chercher la systématique du baroque. Disons que si une œuvre d’art se compose de principes et d’éléments, nous irions vers les principes en oubliant les éléments. S’il y a, dans le baroque, des symétries et des asymétries, des équilibres précaires, des jeux récurrents de correspondances, des effets de miroirs, comment rendre tout cela sans utiliser le langage immédiat de l’iconographie baroque ? Il importait, par exemple, de déshispaniser le texte et le spectacle. Je ne crois pas que l’on puisse éviter tout ce qui vient de la mémoire secrète d’un texte. Le traitement du corps par exemple : le corps de Sigismond rappelle ici Ribera ou Velasquez, là Murillo ou Jean de la Tour. Mais il fallait veiller à ne pas mettre en scène des tableaux, à utiliser, par des moyens contemporains, la systématique baroque, et non son iconographie, afin de ne pas rejeter le public dans l’historicisme de la pièce. L’histoire, on le sait, ne recouvre qu’un moment donné. Il fallait atteindre un niveau qui puisse concerner le spectateur de façon plus vaste.
J.T. : Vous avez vous-même joué Sigismond.