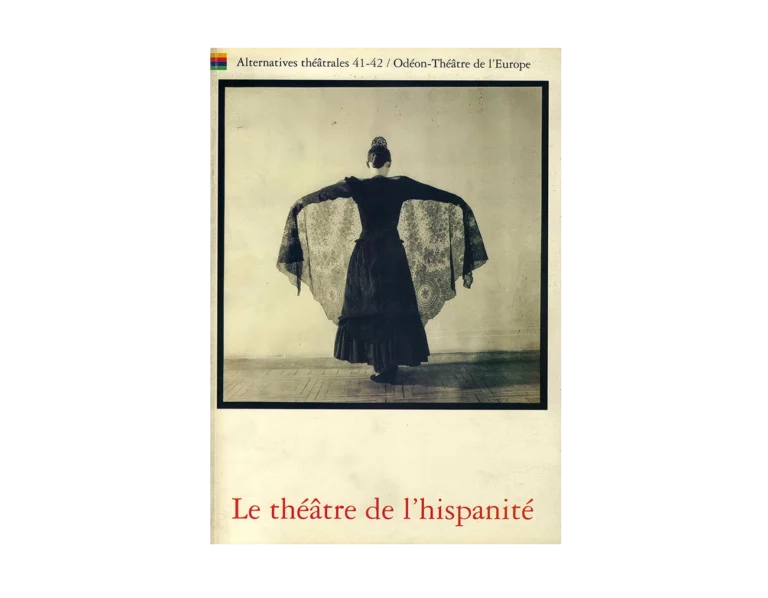L’étonnement d’un angelot
DIEU montre du doigt notre continent à un ange du ciel et Le charge de rédiger un rapport sur l’Amérique latine. Il ne le fait pas par curiosité ou par désœuvrement. Dieu est préoccupé : on lui a dit que là-bas, des hommes meurent par milliers, de faim ou des balles et on affirme qu’Il en a donné l’ordre. On lui dit qu’il se murmure que tel est son bon plaisir.
L’angelot, fonctionnaire de l’Au-Delà, commence par consulter une carte de l’En Deçà. Sur la carte, l’Amérique latine occupe moins d’espace que l’Europe et encore moins que les États-Unis et le Canada. Le fonctionnaire ailé découvre que la carte ne coïncide en rien avec ce qu’il voit dans l’espace, et lorsqu’il consulte l’histoire officielle, il découvre qu’elle ne coïncide en rien avec ce qu’il voit dans le temps. L’Amérique latine est humiliée dans l’histoire comme sur la carte.
L’étonnement d’un écrivain
Voilà une région du monde malade de sottise et de plagiat. Depuis cinq siècles elle est entraînée à cracher dans le miroir : pour ignorer et mépriser le meilleur d’elle-même.
L’histoire réelle de l’Amérique latine, et de toute l’Amérique, est une étonnante source de dignité et de beauté : mais la dignité et la beauté, sœurs siamoises de l’humiliation et de l’horreur, n’apparaissent que très rarement dans l’histoire officielle.
Les vainqueurs qui justifient leurs privilèges par leurs droits d’héritiers, imposent leur propre mémoire comme mémoire unique et obligatoire. L’histoire officielle, vitrine où le système expose ses vieux habits, ment dans ses paroles, et plus encore, dans ses silences. Ce défilé de héros masqués réduit notre fascinante réalité au spectacle nain de la victoire des riches, des blancs, des machos et des militaires.
Un chasseur de voix
Moi, blanc, macho, mais ni riche ni militaire, j’ai écrit MÉMOIRE DU FEU pour lutter contre l’oubli des choses qui méritent le souvenir.
Je ne suis pas un historien. Je suis un écrivain qui se sent défié par l’énigme et le mensonge, qui souhaite que le présent ne soit pas une douloureuse expiation du passé et qui aimerait imaginer le futur au lieu de le subir : un chasseur de voix perdues, mais de voix véritables, dispersées au hasard.
Car la mémoire qui mérite d’être sauvée est pulvérisée. Elle a volé en éclats.
L’éléphant
Lorsque j’étais enfant, ma grand-mère m’a raconté la fable de l’éléphant et des aveugles.
Ils étaient trois aveugles devant un éléphant. L’un d’entre eux lui palpa la queue et dit :
— C’est une corde.
Un autre aveugle caressa une patte de l’éléphant et assura :
— C’est une colonne.
Et le troisième aveugle appuya sa main sur le corps de l’éléphant et devina :
— C’est un mur.
Nous sommes ainsi : incapables de nous voir nous-mêmes et le monde. Dès notre naissance, on nous apprend à ne voir que des morceaux.
La culture dominante, culture de la dislocation, brise l’histoire passée comme elle brise la réalité présente.
Fenêtres
Les chapitres de MÉMOIRE DU FEU sont des fenêtres pour la maison que chaque lecteur bâtit à partir de sa lecture ; et il y a autant de maisons possibles que de lecteurs. Les fenêtres, espaces ouverts sur le temps, aident à regarder. C’est cela, du moins, que l’auteur souhaite : aider à regarder. Que le lecteur voie et découvre Le temps qui fut, comme si ce temps était toujours, passé qui se fait présent à travers Les histoires-fenêtres que raconte la trilogie.
« La branche a ses oiseaux fidèles », écrivit le poète Salinas, « car elle n’attache pas, elle offre ». Cette œuvre est née pour se réaliser dans le lecteur, pas pour l’enchaîner. Le lecteur entre et sort de cette maison de paroles comme il veut, quand il veut et par où il veut, en la lisant du début à la fin, ou de la fin au début, vite, par morceaux ou au hasard, à son idée. Cette liberté montre que la maison est sienne : dans le lecteur, pour le lecteur elle existe et se développe.
Hier et aujourd’hui
MÉMOIRE DU FEU est écrite au présent, comme si le passé était en train de survenir. Car le passé est vivant, bien qu’il ait été enterré par erreur ou infamie, et parce que le divorce du passé et du présent est aussi absurde que le divorce de l’âme et du corps, de la conscience et de l’acte, de la raison et du cœur.
Le tourment et la fête
J’y ai passé huit longues années de travail. MÉMOIRE DU FEU fut un tourment pour mon cul et une fête pour ma main. J’ai souffert huit longues années, cloué sur une chaise dans plusieurs bibliothèques du monde, et j’ai joui de huit longues années de création en griffonnant du papier.
La trilogie provient de plus de mille sources documentaires. Elle s’appuie sur elles et prend son envol à partir d’elles, librement, à sa façon. Les histoires de MÉMOIRE DU FEU se sont produites dans la réalité, pas dans mon imagination ; mais je sais bien que celui qui copie la réalité trahit ses mystères. La langue, qui a voulu être dépouillée mais électrisante, naquit de la nécessité de raconter l’histoire de l’Amérique et de la restituer vivante à ses enfants d’aujourd’hui.
C’est pour cela que cette œuvre n’appartient à aucun genre littéraire, bien qu’elle souhaite appartenir à tous, et viole allègrement les frontières entre l’essai et le récit, le document et la poésie. Pourquoi le besoin de savoir doit-il être ennemi du plaisir de lire ? Pourquoi la voix humaine doit-elle être classifiée comme si elle était un insecte ?
L’incessante métaphore
Je l’ai découvert dans un livre : quand les esclaves noirs fuyaient les plantations du Surinam, ils remplissaient de semences leurs abondantes chevelures. Arrivés à leur refuge dans la forêt, ils secouaient la tête et fécondaient ainsi la terre libre.
MÉMOIRE DU FEU raconte mille instants de l’histoire. De brefs récits comme celui-ci, révélateurs de la merveilleuse et épouvantable aventure humaine en Amérique. Car toute situation est Le symbole de beaucoup d’autres, l’important parle à travers l’insignifiant et l’univers se voit par le trou de la serrure. La réalité, insurpassable poète d’elle-même, parle un langage de symboles.
J’ai commencé d’écrire la trilogie le jour où j’ai pris conscience de ce qui m’apparaît maintenant parfaitement évident : l’histoire est une métaphore incessante.
Va-et-vient des mythes

Les mythes, métaphores collectives, actes collectifs de création, offrent une réponse aux défis . de la nature et aux mystères de l’expérience humaine. À travers eux, la mémoire demeure, se reconnaît et agit.
Tout au long de la trilogie, l’expérience historique s’entrecroise avec les mythes, dans une même trame, comme dans la réalité ; mais la première partie de MÉMOIRE DU FEU est construite exclusivement sur la base de mythes indigènes transmis de pères en fils par la tradition orale. Je n’ai pas trouvé une meilleure manière de m’introduire dans l’Amérique d’avant Colomb. Car, enfin, presque tous les documents de l’époque finirent sur les bûchers des conquistadors.
Les mythes indigènes, clefs de l’identité de la plus antique mémoire américaine, perpétuent les rêves des vaincus, rêves perdus, rêves méprisés, et Les restituent à la mémoire vivante : ils viennent de l’histoire et à l’histoire retournent.
En 1572, lorsque les Espagnols coupèrent la tête de Tupac Amaru, dernier roi de la dynastie inca, un mythe naquit parmi les Indiens du Pérou. Ce mythe annonçait que la tête se recollerait au corps. Deux siècles plus tard, le mythe rejoignit la réalité qui l’avait engendré, la prophétie se fit histoire : José Gabriel Condorcanqui prit le nom de Tupac Amaru et conduisit le plus important soulèvement indigène de tous les temps. La tête coupée retrouvait le corps.
Voix ou échos ?
On célèbre le cinq centième anniversaire de l’arrivée de Colomb. Il est grand temps que l’Amérique commence à se découvrir elle-même.
Le sauvetage du passé fait partie de cette urgente nécessité de révélation. Et où résonnent-elles les voix obstinément vivantes qui nous aident à vivre ? En haut et au-dehors ou en bas et au-dedans ? Dans la « civilisation » ou dans la « barbarie » ?
En 1867, l’Equateur envoya un choix de tableaux de ses meilleurs peintres à l’Exposition Universelle de Paris. Ces tableaux étaient des copies de quelques tableaux de maîtres européens. Le catalogue officiel vantait le talent des artistes équatoriens dans l’art de la reproduction.
Le chœur
Ceux d’en haut, plagiaires de ceux du dehors, méprisent ceux d’en bas et du dedans : le peuple est le chœur du héros. Les « ignorants » ne font pas l’histoire, ils la reçoivent toute faite.
Dans les textes qui nous enseignent le passé américain, les rébellions indigènes, incessantes après 1493, occupent peu de place ou ne sont pas mentionnées, tout comme les révoltes des noirs, elles aussi incessantes, après que l’Europe eut réalisé la prouesse d’instaurer l’esclavage héréditaire en Amérique.
Pour les usurpateurs de la mémoire, pour les voleurs de la parole, cette longue histoire de la dignité n’est pas autre chose qu’une succession d’actes de mauvaise conduite. La lutte pour la liberté commença le jour où les champions de l’indépendance dégainèrent leur épée, et cette lutte trouva sa conclusion lorsque les juristes rédigèrent, dans chacun des pays récemment mis au monde, une belle constitution qui niait tous les droits au peuple qui avait semé ses morts sur les champs de bataille.
Elles
« Derrière chaque grand homme il y a une femme ». Hommage fréquent, douteux éloge : il ramène la femme à la condition de dossier de fauteuil.
Rôle traditionnel : la femme est fille dévouée, épouse pleine d’abnégation, mère sacrifiée, veuve exemplaire. Elle obéit, fait régner la beauté, console et se tait. Pour l’histoire officielle, cette ombre fidèle ne mérite que le silence. Au plus permet-on de citer les épouses des grands hommes. Mais au cœur de la vraie histoire, c’est une autre femme qui passe sa tête entre les barreaux de la prison. Parfois il n’y a pas d’autre solution que de reconnaître son existence. C’est le cas pour Sœur Juana Inès de la Cruz, qui ne parvint pas elle-même à cacher son génie étincelant et dérangeant ou pour Manuela Saenz et sa vie fulgurante. Mais ceci reste vrai : on ne dit jamais rien, même en passant, sur les meneuses noires ou indiennes qui administrèrent de sensationnelles volées aux troupes coloniales avant les guerres d’indépendance. Honorable exception à cette règle du silence : la Jamaïque a reconnu Nanny pour héroïne nationale : Nanny, l’esclave sauvage, moitié femme, moitié déesse, qui, amoureuse de la liberté, prit la tête des esclaves révoltés de Barlovento et humilia l’armée anglaise, il y a deux siècles.
Le dévot et le fou
Écolier, j’appris à vénérer Francisco Antonio Maciel, le « Père des pauvres », fondateur de l’Hôpital de la Charité de Montévidéo. Plus tard, je découvris que ce dévot gagnait sa vie en vendant de la chair humaine : il était trafiquant d’esclaves.
Les statues qui restent dressées sont aussi nombreuses que les statues déboulonnées. J’ai découvert beaucoup d’infamies en travaillant pour MÉMOIRE DU FEU. Mais j’ai découvert des merveilles que je ne connaissais pas où que je connaissais mal.
Simon Rodriguez est une de ces révélations éblouissantes. Très peu connu au Vénézuela où il est né, il est inconnu dans les autres pays d’Amérique latine. On se souvient vaguement qu’il a été Le précepteur de Simon Bolivar. Mais il a été le penseur le plus audacieux de son temps sur notre continent, et, un siècle et demi plus tard, ses paroles et ses actes paraissent dater de la semaine dernière. Don Simon allait à dos de mule, prêchant dans le désert. On le prenait pour un fou, on l’appelait d’ailleurs « le fou ». Il s’en prenait aux maîtres du pouvoir, incapables de création, capables seulement d’importer les idées et les marchandises d’Europe et des États-Unis. « Imitez l’originalité !», exhortait et répétait sans se lasser don Simon. « Imitez l’originalité, puisque vous essayez de tout imiter !». Ce furent ses deux péchés impardonnables : être original et ne pas être militaire.
Le Nobel et l’inconnu
L’histoire passée est jambes en l’air car la réalité présente marche la tête en bas. Et pas seulement dans le sud de l’Amérique ; au nord aussi.
Qui ne connaît pas, aux États-Unis, Teddy Roosevelt ? Ce héros national prêcha la guerre et la fit contre les faibles : la guerre, proclamait-il, purifie l’âme et améliore la race. Il reçut donc le prix Nobel de la Paix.
Par contre, qui connaît, aux États-Unis, Charles Drew ? Ce n’est pas que l’histoire l’ait oublié : elle ne l’a jamais connu, tout simplement. Néanmoins, ce scientifique a sauvé des millions de vies humaines, après que ses recherches eurent permis la conservation et la transfusion du plasma. Drew était directeur de la Croix-Rouge des ÉtatsUnis. En 1942, la Croix-Rouge interdit la transfusion de sang noir. Alors Drew démissionna. Drew était noir.
Le monde comme un plateau
L’amnésie n’est pas le triste privilège des pays pauvres. Les pays riches apprennent à oublier. L’histoire officielle ne leur raconte pas, entre autres choses qu’elle leur tait, l’origine de leur richesse. Cette richesse, qui n’est pas innocente, provient en grande partie de la pauvreté des autres, et elle s’alimente toujours à cette source. Impunément, sans que sa conscience n’en souffre, ni que s’enflamme sa mémoire, l’Europe peut confirmer chaque jour que la terre n’est par ronde. Ils avaient raison, les anciens : le monde est un plateau, et au-delà s’ouvre l’abîme. Au fond gfît l’Amérique latine et tout le reste du Tiers Monde.
Herbe sèche et herbe humide
Un proverbe africain ouvre MÉMOIRE DU FEU et explique le titre. Les esclaves introduisirent en Amérique ces mots qui prophétisent : « l’herbe sèche enflammera l’herbe mouillée ».
Les esclaves amenèrent aussi d’Afrique l’antique certitude que nous avons deux mémoires. Une mémoire individuelle, vulnérable au temps et à la passion, condamnée comme nous à mourir, une mémoire collective, destinée, comme nous, à survivre.
Le dos à la vie
Les maîtres du pouvoir se réfugient dans le passé qu’ils croient tranquille, mort, pour nier le présent qui bouge et change, pour conjurer aussi le futur. L’histoire officielle nous invite à visiter un musée de momies. Là, pas de danger : on peut étudier les Indiens morts depuis des siècles et on peut en même temps mépriser ou ignorer les Indiens qui vivent aujourd’hui. On peut admirer les ruines prodigieuses des temples antiques tandis que l’on assiste, bras croisés, à l’empoisonnement des rivières et à l’arasement des forêts où ces Indiens ont leur demeure.
La conquête continue, dans toute l’Amérique, du nord au sud, on continue de déloger les Indiens qui y vivent, à les piller et les tuer : les moyens modernes de communication, qui diffusent le mépris, enseignent aux vaincus l’auto-dénigrement : sous le règne de la télévision, les enfants indiens jouent aux cow-boys, et rares sont ceux qui acceptent le rôle d’‘Indien.
Voix d’hier et de demain
Le passé muet m’ennuie. MÉMOIRE DU FEU voudrait aider la multiplication des voix ailées qui viennent du passé mais résonnent comme des voix actuelles et parlent aux temps à venir.
Et il se trouve que les antiques cultures indiennes sont les plus porteuses d’avenir. En définitive, elles ont été capables, miraculeusement capables, de perpétuer l’intégration de l’homme dans la nature, alors que le monde entier persiste dans le suicide. Ces cultures, que la culture dominante considère incultes, refusent de violer la terre ; elles ne la réduisent pas en objet de consommation et de surconsommation : la terre sacrée n’est pas une chose.
Et finalement aussi, la communauté, le mode communautaire de production et de vie, est la voix qui annonce le plus obstinément une autre Amérique possible. Cette voix qui vient des temps les plus reculés et résonne encore. Voilà cinq siècles que les maîtres du pouvoir veulent la faire taire par le feu et le sang, mais on l’entend toujours. La communauté est la plus américaine des traditions, la plus ancienne et la plus obstinée des traditions des Amériques. Qu’ils aillent au diable ceux qui disent que le socialisme est une idée.
Traduit par Pierre Guillaumin.
La trilogie MÉMOIRE DU FEU d’Eduardo Galeano (LES NAISSANCES, LES VISAGES ET LES MASQUES ET LE SIÈCLE DU VENT) est l’un des plus grands succès du roman latinoaméricain. La troupe uruguayenne El Galpon en a fait une adaptation scénique, EL VENDEDOR DE RELIQUIAS, qui sera présentée à Paris en octobre 92. Le texte que nous publions ici a été lu par Eduardo Galeano à L’Odéon-Théâtre de l’Europe le 22 janvier 92, lors de la Rencontre parlementaire Europe — Amérique latine organisée par l’Assemblée nationale.