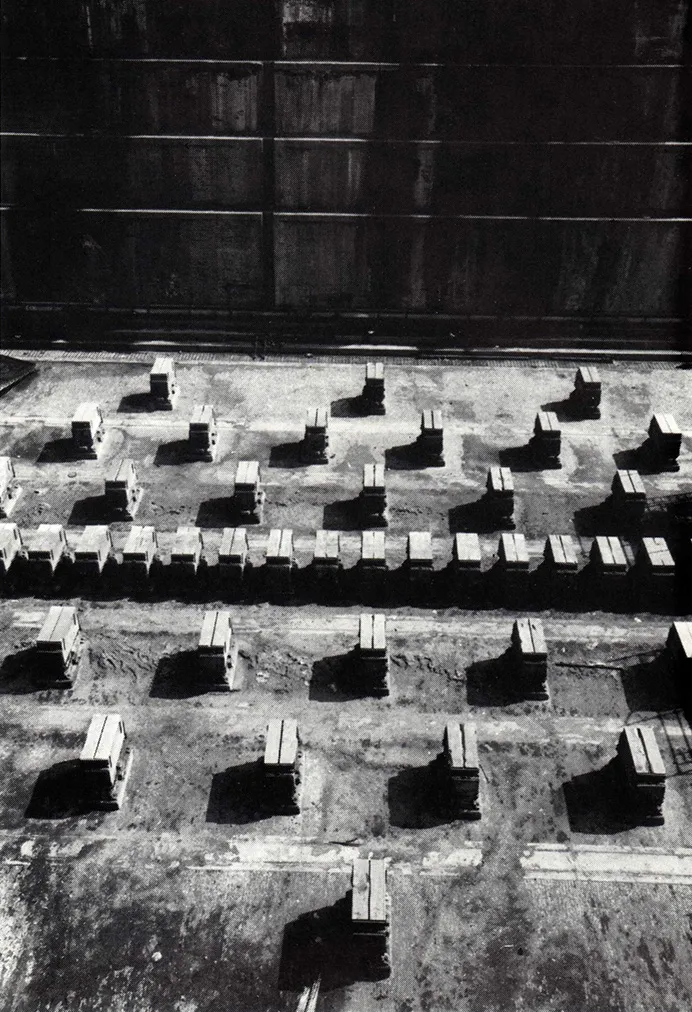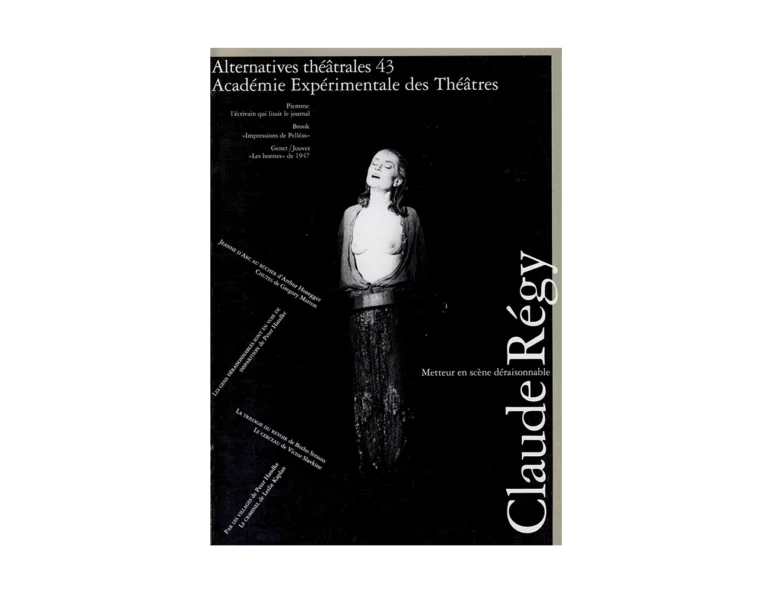SERGE SAADA : Pour cette deuxième partie nous avons pensé à réunir des artistes plus jeunes qui ont accompagné Claude Régy dans le travail. À ses côtés ils ont été (ou sont encore) assistants, décorateurs, acteurs. Ce ne sont pas des disciples, certains sont passés à la mise en scène ou ont collaboré aux projets d’autres metteurs en scène. À travers leur témoignage nous allons essayer de mieux comprendre ce qui se passe quand on travaille avec un tel créateur.
À ma droite il y a Alain Neddam qui, jusqu’à ce jour, fut sur sept spectacles l’assistant de Claude Régy ; Daniel Jeanneteau qui a été le décorateur de Claude Régy sur trois spectacles : L’AMANTE ANGLAISE, LE CERCEAU et CHUTES ; Marc François qui est metteur en scène et qui, à plusieurs reprises, a été acteur dans les spectacles de Claude. Il joue dans CHUTES. Il y a enfin Dominique Frot qui est actrice et qui a joué dans plusieurs spectacles de Claude Régy.
Je vais poser ma première question à Alain Neddam. J’aimerais savoir ce que demande Claude Régy à son assistant. Comment se déroule cette collaboration ?
Alain Neddanr : Quand j’ai commencé pour la première fois à travailler avec lui, j’étais assistant stagiaire, je n’étais pas payé. J’avais le droit d’être là, de travailler mais il ne pouvait rien me demander puisque je n’étais pas engagé par lui.
Ce qu’il demande à un assistant — il faut toujours entendre ce mot « assistant » au participe présent — c’est d’être là. L’assistant est quelqu’un qui est présent et qui essaye de rendre sa présence la moins obstructive possible. Ce n’est pas le rouage d’une machine et il n’est pas l’adjoint en chef du metteur en scène. Ce serait plutôt quelqu’un qui est un peu partout à la fois, qui essaye d’être le plus discret possible, le lubrifiant de la machine plutôt qu’un rouage supplémentaire. Tour dépend de ce qu’on a envie d’apporter et de la manière dont on s’intéresse au spectacle. Moi j’avais envie de m’intéresser au texte. J’ai fait très vite comprendre à Claude que ce dont j’avais envie c’était d’être présent pendant les conversations dès le début du travail, lire, m’intéresser et vivre la période qui est peut-être la plus passionnante dans son travail, celle de la distribution. Découvrir comment peu à peu le spectacle se met en route à partir d’une pièce écrite, à partir du choix des acteurs. On peut toujours être interlocuteur de Régy, mais ce travail préliminaire lui appartient totalement, c’est vraiment son œuvre, son domaine. Quand la distribution se précise (parfois 6 mois avant le spectacle), l’assistant a déjà une idée du spectacle. Mais avant on ne sait rien. Parfois même on ne comprend pas bien les motivations.
En écoutant ce qui s’est dit ce matin, j’ai repensé à Claude Régy par rapport à tout ce qu’on raconte sur l’austérité, sur le refus du superflu, sur l’envie d’être radicalement différent. Je me suis rappelé ce texte de Kafka qui s’intitule UN CHAMPION DE JEONE. En fait, c’est un titre mal traduit. Le titre le plus proche serait UN ARTISTE DE LA FAIM. Le personnage de Kafka est un héros, un être que tout le monde vénère parce qu’il ne mange jamais, parce qu’il refuse de manger. Tout le monde va I’admirer en lui disant : « comment arrivez-vous à tenir aussi longtemps sans rien manger ?» À la fin du livre, peu de temps avant de mourir, il explique que il est ce héros, c’est parce qu’en fait, aucun des aliments qui existent n’est à son goûr. Claude Régy ressemble un peu à ce personnage car dans son travail il n’y a jamais la recherche d’une quelconque originalité, la volonté d’être différent ou de proposer des idées qui seront forcément novatrices. J’ai participé à d’autres travaux, je lis aussi des textes écrits par des metteurs en scène. IIs partent souvent d’une idée ou d’une chose qui les rassure et se disent : « si je le fais comme ça je vais vraiment être différent des autres, je vais être original ». Chez Régy c’est différent. Son travail est de l’ordre d’un refus, presque du dégoût de tout ce qui pourrait ramener à une convention théâtrale ou à quelque chose d’habituel dans l’intonation des acteurs, la manière de faire exister une présence sur le plateau, de faire vivre un espace.
Il disait dans un entretien radiophonique : « quand j’entends des acteurs dans certains spectacles parler « comme ça » avec leur voix de théâtre ça me fait saigner ». Donc on voit bien que chez lui, c’est beaucoup plus qu’une volonté de faire un théâtre différent, c’est une impossibilité de faire autre chose que le théâtre qu’il fait. Les choix qu’il fait ne sont jamais commandés par l’envie de faire du neuf ou d’être plus intéressant que les autres. C’est surtout un empêchement violent qui lui évite de tomber dans du moyen ou du connu.
S. Sa. : Comment la parole circule-t-elle dans le cours des répétitions ? Est-ce que tu interviens au début ? À la fin ?
A. N. : C’est très impressionnant d’apprendre à exister sans parler. Au théâtre, ou dans les restaurants d’après spectacle, on croit toujours que plus on parle, plus on existe. Dans le travail avec Claude, on apprend pendant des heures à exister très fort, à envoyer des ondes, à être dans une grande écoute, une attention d’être, une présence. C’est un très bel apprentissage de l’endurance et de l’écoute. Parler, non. Bien sûr, il faut parler, téléphoner, il faut aussi assurer une communication, mais pas pendant le temps des répétitions. Le temps des répétitions, c’est le temps d’une parole individuelle, une parole singulière entre le metceur en scène et les comédiens. Chaque fois qu’il parle à un acteur en particulier, il parle aussi aux autres, mais l’assistant n’est pas celui qui met son grain de sel.
S. Sa. : Est-ce que l’on discute du travail après les répétitions ? Est-ce que c’est facile d’en parler à Régy et aux comédiens ?
A. N. : Oui, mais très vite on apprend à se méfier de ses impressions. L’impression qu’on a quand on assiste à ces répétitions c’est que les choses vont dans le sens du trop. C’est-à-dire que parfois on est renvoyé à sa propre normalité et on se dit souvent : est-ce que là il n’est pas en train d’exagérer ? On à répété TROIS VOYAGEURS REGARDENT UN LEVER DE SOLEIL dans un espace totalement vide, sans décor, une Viery Larbre était vaguement matérialisé, salle de répétition très belle à mais il n’existait pas. Quand le décor a été monté et que j’ai vu l’arbre que vous connaissez peut-être si vous avez vu le spectacle — ce tronc gigantesque avec des racines partout, ce tronc monumental — je fus pris d’une espèce d’effarement. Je trouvais que là, c’était vraiment fou, impossible, et il m’a fallu plusieurs jours pour accepter l’énormité de ce tronc. Après, j’ai compris que le spectacle n’avait d’intérêt que si le tronc était de cette dimension-là, « monumentale » : c’est un terme qui revient souvent quand il cravaille sur le décor ou sur le jeu de l’acteur ; il y a aussi cette expression de « surdimensionné ». Les choses doivent avoir une dimension supérieure à celle qu’elles ont habituellement. Lacteur aussi doit être plus grand, plus vaste que sa dimension normale d’individu Donc, en travaillant avec lui, on à souvent l’impression qu’il y a quelque chose d’excessif, et notre intervention serait de censurer, parce qu’on trouve que c’est faux. Peu à peu on comprend que ce « trop » ou que cetre chose anormale ou trop particulière, c’est ce qui constitue l’arc du metteur en scène Vous savez qu’on reproche toujours aux gens ce qui fait la caractéristique de leur style ; on trouve toujours que Proust fait des phrases trop longues et que Céline met trop de points de suspension. Confrontés au travail de Claude Régy, les gens trouvent que c’est trop lent ou trop statique. Lui le revendique comme étant absolument constitutif de son art. C’est lent et c’est statique mais à travers cela il se passe quelque chose d’autre.
Je disais qu’être assistant, c’est aussi arriver à le rejoindre et à l’accompa ner dans cette exigence-là arriver à le défendre auprès des acteurs, au besoin auprès d’autres interlocuteurs. Par exemple, essayer de faire comprendre à un accessoiriste de Chaillot que l’on cherche un objet qui ne peut pas être le même objet qui à servi dans un autre spectacle. Faire comprendre qu’il n’y à pas de rôle mineur, de choses négligeables. Ainsi l’assistant passe beaucoup de temps à accorder énormément d’importance à ces choses qu’un autre metteur en scène ou un autre assistant trouverait mineures. Donc, il faut consacrer de I’énergie à ces choses que les gens ne verront pas, mais qui seront la force du spectacle. Je crois que c’est là où est le travail de l’assistant : le défendre dans ce qu’il peut avoir de déraisonnable puisqu’on sait, depuis Handke au moins, que c’est une espèce en voie de disparition. Ce qu’il a de déraisonnable c’est ce qu’il à de plus essentiel.
S. Sa : Est-ce que justement tu peux nous parler de ce côté déraisonnable de l’artiste ? Il à parfois pris des décisions en dépit du bon sens.
A. N. : Oui, sur INTÉRIEUR, pour des rôles sans texte, il a eu l’idée de faire appel à des comédiens du Conservatoire et aussi à deux acteurs sourds-muets dont un joue encore avec lui dans CHUTES. C’était très difficile parce qu’il fallait faire venir un interprète, communiquer avec des gens qui ne parlent pas, qui n’entendent pas. Quand j’expliquais à des gens autour de moi qu’on avait deux sourds-muets dans l’équipe, ils disaient : « Pourquoi ire simple, quand on peur faire compliqué !
Aussi pour CHUTES, il à fait venir un acteur qu’il avait vu dans un film de Tarkowski, Oleg Yankowski. Il I’a fait venir de Moscou avec toutes les difficultés que cela suppose, d’interprète, de logement…
Pour INTÉRIEUR, on se rendait compte qu’une fois à l’épreuve du plateau, les acteurs sourds-muets avaient au moins autant de présence que les acteurs de métier. Probablement plus. Le mystère c’est que personne ne pouvait savoir qu’ils étaient sourds- muets, il émanait quelque chose d’eux qui justifiait cette difficulté supplémentaire.

Pour illustrer encore ce que ses choix et ses préférences peuvent avoir d’excessif, on peut rappeler un autre souvenir. À une époque, INTÉRIEUR et LE PARC se préparaient en même temps. J’avais lu et adoré la pièce de Botho Strauss, je trouvais que c’était un texte très fort. En revanche je ne comprenai pas bien le choix de la pièce de Maeterlinck. Je pense qu’au départ du projet, beaucoup de gens n’ont pas bien compris ce que Régy allait faire avec cette curieuse pièce et son style un peu vieillot, sa poésie symboliste. La pièce repose sur la séparation entre des gens qui sont à l’extérieur e qui sont porteurs de la nouvelle de la mort d’un enfant, et des gens qui sont à l’intérieur dans la tranquillité de leur maison et qui ignorent la mort de cet enfant. On va la leur annoncer. Quand Claude m’a expliqué qu’il n’y aurait pas de décor, c’est-à-dire que la maison ne serait pas représentée, que le cloisonnement entre le dedans et le dehors ne serait pas montré, qu’il n’y aurait ni façade de maison, ni meuble, que l’espace serait vide, qu’il y aurait simplement des gens un peu devant, et les autres qui seraient au bout du plateau, derrière, figurant les personnages dans la maison, j’ai compris jusqu’où ce projet pouvait aller et comment il deviendrait passionnant. Et effectivement c’était peut-être un des spectacles les plus marquants de Claude Régy, ne serait-ce que parce qu’il commençait par vinge minutes totalement silencieuses, vingt minutes de déambulation des com iens. Le début du spectacle fait encore rêver non seulement des gens de théâtre mais aussi des chorégraphes. Cette lente marche silencieuse de ces personnages, dont on ne sait pas qui ils sont et de quoi ils sont porteurs, fait vivre un moment absolument suspendu hors du temps.
À partir de ce choix-là, complètement déraisonnable, cette décision de monter INTÉRIEUR sans maison, sans meubles, sans décor représentant l’intérieur de la maison, on comprend qu’en partant d’un texte dont on ne sait pas voir l’intérêt, Régy à cheminé pour trouver la chose qui le passionne en procédant par élimination
S. Sa. : Comment se déroule le travail à la table ? Tu m’as dit que ce travail est très précis. Est-ce qu’il n’est pas antinomique d’une volonté chez Claude Régy d’évacuer tout déterminisme avant d’aborder un texte.
A. N. : Je crois que Claude Degliame I’a un peu dit ce matin Pendant ce travail, on écoute, on apprend que lire un texte c’est avant cout l’écouter, c’est-à-dire considérer que chaque mor porte une chose inouïe, multiple. Le travail consiste à parler plus lentement que d’habitude et à prendre le remps, à écouter les autres mais aussi à s’écouter soi-même, essayer de ne rien imprimer qui serait de l’ordre d’une interprétation, c’est‑i à‑dire d’un sentiment qu’on superposerait sur le texte Il parle beaucoup aux acteurs pendant les répétitions, mais ce ne sont jamais des indications portant sur un sens ou une chose particulière à joue c’est toujours une ouverture vers la multiplicité des significations. Quand Claude Degliame di qu’un personnage qui à très peu de texte est aussi fort, aussi important que les autres, il faudrait ajouter que pendant le temps des lectures à la table, c’est également vrai. Quand on répétait INTÉRIEUR les acteurs qui avaient des rôles muets étaient vraiment là, impliqués dans la lecture.

Georges Banu : Quel type d’indications donne-t-il concrètement ? Est-ce qu’il est loin dans la salle ou près des acteurs ?
A. N. : Il est toujours prêt à se rapprocher d’eux. Il est souvent debout, il essaye de ne pas être assis, coincé derrière une table. Mais il ne cherche jamais, comme d’autres metreurs en scène, à prendre la place de l’acteur, à lui montrer ce qu’il faut faire. Mais Marc François pourrait mieux en parler.