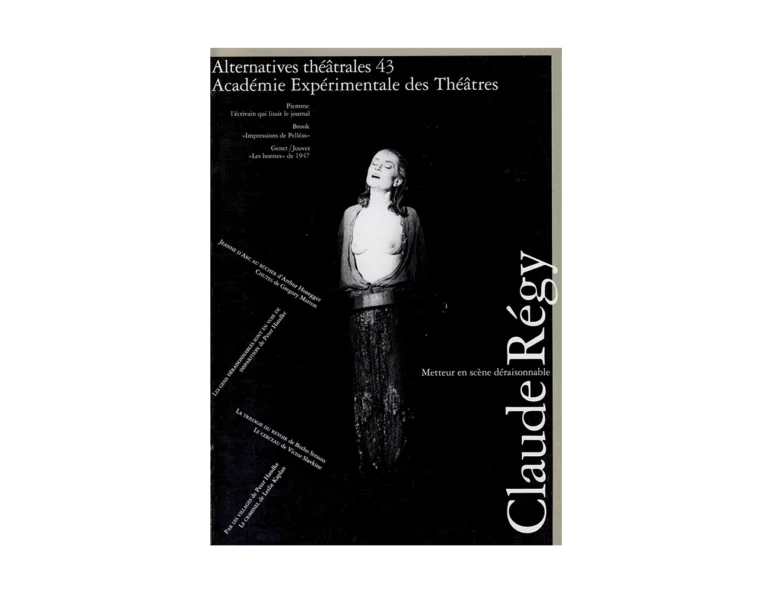JEAN-PIERRE THIBAUDAT : Après le temps des témoignages et des analyses, voici venu le moment des questions. Certains d’entre vous ont travaillé avec Claude Régy, d’autres ont été ses élèves, chacun de vous a une pratique du théâtre et donc c’est de l’intérieur même de cette pratique que nous allons interroger Claude Régy.
Stanislas Nordey : Une des questions qui me préoccupe un peu ‘est le rapport à l’institution parce que je suis confronté à cela tout le temps, en ce moment, comme je suis au départ d’une aventure théâtrale. Vous n’avez jamais pris en charge un lieu, vous ne vous êtes jamais arrêté durablement dans une institution. Aujourd’hui je me pose des questions autour de cela. Est- ce que c’est possible de travailler durablement dans un lieu sans répercussion sur la création ?
Claude Régy : Si j’ai un conseil à te donner c’est de ne jamais prendre aucune maison. C’est un conseil que je me suis donné et que j’ai suivi, et je m’en trouve extrêmement bien. Il est évident que si on fait un travail qui concerne des écritures neuves qui sont au début rejetées (pour être acceptées trois ans ou six ans plus tard), on ne peur pas avoir la charge d’une maison On ne peut pas s’engager à remplir des salles. Si on dirige une salle, on ne peut pas découvrir des écritures et essayer de faire du théâtre hors des schémas habituels, hors de ces recettes de succès qui sont si utiles justement aux directeurs de salles. Je pense qu’il n’y a d’action libre que si on reste un homme libre. Si l’on excepte ces douze ans où je suis resté enfermé au Théâtre de l’Atelier comme assistant, cela fait à peu près trente ans que je fais du théâtre librement et pendant très longtemps je l’ai fait sans l’aide d’aucune subvention. J’ai reçu ma première subvention en 1976, elle était de deux cent mille francs. Je faisais déjà du théâtre depuis plus de quinze ans.
Je pense aussi que l’air du temps, les leçons de gestion que nous donne un ministère si mal géré — puisqu’on reçoit les subventions avec six mois de retard ce qui nous place dans des situations rout à fait ingérables — nous conduisent à penser qu’il ne faudrait pas forcément donner les maisons à ceux qui savent se débrouiller, qui savent où on rencontre les gens, comment on parle dans les ministères, comment on obtient de l’argent, comment on trouve des sponsors, comment on remplit les salles. Je ne pense pas que ce sont ces gens-là qu’il faut le plus aider, car ce ne sont pas ceux qui inventent. Le système de l’institution comporte sa propre mort comme toute institution surtout avec ce vent de « normes de rentabilité ». On ne sait pas pourquoi tout à coup le théâtre devrait être rentable. Je ne pense pas que l’opéra le soit, les compagnies de danse ne le sont pas, la peinture met longtemps à l’être. Pour obtenir des sous il faut avoir une maison. On associe à tort les deux idées, on donne de l’argent à ceux qui ont des maisons. Dès qu’on a une maison on est terrifié de la voir vide, sans public, et d’être viré au bout de son mandat. Donc on monte Molière, on monte Corneille, Musset, Feydeau, on peut aller jusqu’à Breche et Claudel à la limite, et c’est déjà la mort. Le lieu « marche » ; il tourne, on s’échange des spectacles entre maisons, on à beaucoup de spectateurs. Je pense que c’est la mort totale du théâtre. Alors ne prends pas de maison je t’en supplie et en même temps conserve une liberté très importante parce que je crois que l’architecture a une influence énorme sur I’homme, que le lieu où on se trouve n’est pas indifférent au travail qu’on y fait et que c’est très bénéfique d’avoir le choix de placer un spectacle dans un lieu ou dans un autre. Jouer à Nanterre, jouer à Gérard Philipe Saint-Denis, jouer à l’Odéon ou à la Bastille, c’est très différent. C’est très intéressant de choisir son lieu et de ne pas être tenu de travailler tout le temps dans le même endroit. À ce sujet je peux dire que je suis très en colère contre la politique de construction des salles, je suis étonné que personne ne fasse rien, Il y à à Paris quarante-cinq théâtres à l’italienne. Quand on a construit ces théâtres, soit au dix- huitième, soit au dix-neuvième siècle, on ne pensait pas du tour à I’image comme on y pense maintenant après la photographie, le cinéma, la sophistication de la lumière, du son, du spectacle. Tout cela a conduit les gens de théâtre à suivre les découvertes du cinéma et l’image est devenue primordiale. Alors on travaille des images, on travaille des lumières, des tons, de la vie qui en dépend, mais comment acceptériez-vous d’assister à un film où le quart ou la moitié de I’écran serait occulté ? C’est ce qui se passe dans le théâtre à l’italienne. Quand on est en bas on voit les acteurs à partir du genou, dès qu’on est sur le côté on ne voit que la moitié opposée de la scène. Dès qu’on est en haut on ne voit pas la moitié haute de I’image. Seulement évidemment quand les critiques ou les gens du ministère vont au théâtre, ils sont toujours au sixième rang, au milieu de l’orchestre, ils voient à peu près. De route façon ils ne regardent pas beaucoup. Le théâtre national de la Comédie Française à une des salles les plus inadaptées qui soient. Le plateau est petit, les dégagements inexistants. L’acoustique n’y est pas très privilégiée, quant à la visibilité elle est lamentable, il y à à peu près la moitié des spectateurs qui voit à peine la moitié des images.
On ne construit rien. On à construit en banlieue, dans les banlieues communistes en général, des grandes maisons : Nanterre étant la mieux réussie, Bobigny n’est pas mal, Créteil pèche par vastitude, et c’est déjà loin. Dans ces banlieues on est tombé dans la mégalomanie. Au nom de la grande idée des maisons de la culture on à construit des cadavres de béton géants qui épuisent les subventions en femmes de ménage et en secrétariat. On y change les vitres, les ampoules, les moquettes. On nettoie de la surface. Ce serait quand même plus utile de faire du théâtre avec cet argent-là.
Donc, il n’y a pas de lieu qui soit vraiment adapté. Ou c’est du béton géant à moitié mort ou ce sont ces fameux théâtres à l’italienne où l’on ne voit rien et qui annulent complètement toute recherche de création contemporaine. Par exemple, le théâtre à l’italienne de l’Athénée est consacré à présenter le travail des jeunes compagnies. On les force à faire du vieux théâtre, du dix-neuvième siècle, et personne n’est choqué, personne ne réfléchit. Alors on me dit : « attention on à fait le Théâtre de la Colline » , c’est à dire qu’on a refait le TEP (Théâtre de l’Est Parisien). En quinze ans, ce n’est pas énorme. On à fait aussi cette maison-ci (en montrant le Théâtre Renaud Barrault) qu’il est d’ailleurs urgent de refaire…
J.-P. T. : Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de rentrer dans un lieu et de vous dire « ici pourrait être mon lieu, tout théâtre pourrait se jouer ici » ?
C. R. : Oui, bien sûr, dès qu’on voit des ruines (rire général). C’est sûr que dès qu’on voit une usine avec des vitres cassées on a envie de faire plein de choses. Il y a à côté de Saint-Denis un théâtre absolument en ruine accolé à une salle de bal également en ruine qui est au fond d’un petit bosquet derrière le piétonnier qui mène à la Basilique et où se tient le marché. C’est difficile à visiter parce que d’une part le maraîchers vont chier dans les buissons et d’autre part les pigeons envahissent ce lieu solitaire et vous jettent leur fiente sur la tête ou alors on marche dedans. À part ça c’est un lieu extraordinaire, mais il est très dangereux parce qu’il y a des bouts de plafond qui tombent de temps en temps et c’est évident qu’aucune sécurité au monde ne permettrait de faire quoi que soit là-dedans. Mais si on remettait à neuf tout serait foutu. Dès qu’on reconstruit, dès qu’on repeint, c’est foutu et ça à été l’intelligence de Brook, aux Bouffes du Nord, de ne pas finir le lieu, de ne pas finir les travaux, de laisser ce lieu éventré en état de travaux constant, un lieu qui donne l’impression d’être en perpétuelle attente.
Je n’ai pas non plus envie de me fixer dans une sucrerie à Cambrai ou à Villeneuve-Saint-Georges dans une gare désaffectée, ce serait aussi se fixer. Ce serait d’ailleurs très difficile car ces lieux coûtent extrêmement cher à aménager. Je parle d’argent parce que je pense que nous sommes tout le temps confrontés à cela. Les coûts ont tellement augmenté qu’il est très difficile de faire du théâtre sans argent, très difficile donc d’investir un lieu qui n’est pas du tout équipé… (il faut mettre le chauffage, les toilettes, les sorties de secours, etc …) Aucune compagnie ne peut faire face à ces dépenses. On a déjà du mal à se faire co-produire par des gens qui détiennent quelques maisons de tolérance, s’il fallait investir dans l’équipement d’un hangar on se ruinerait pour quatre ans et en plus on n’a pas le droit. Nos subventions sont uniquement de fonctionnement. Il y a bien sûr la grande expérience de la Cartoucherie de Vincennes qui est très concluante, mais c’est déjà à l’extérieur de Paris. Tous les endroits où I’on pourrait jouer sont en dehors de Paris. À Paris il n’y à rien. Il y à cette maison (en montrant le Théâtre Renaud Barrault) qui n’est pas idéale même si c’est un lieu intéressant justement parce que ce n’est pas un théâtre à l’italienne. Il faudrait construire des lieux similaires à celui-là mais plus ouverts, plus transformables, plus vastes. Quand les grandes mises en
scène étrangères viennent à Paris celles de Peter Stein par exemple — elles vont soit à Nanterre soit à Bobigny ou à la rigueur on peut quelques fois en coupant un tiers du décor rentrer dans l’Odéon qui est le moins catastrophique des théâtres à l’italienne de Paris parce qu’il est assez ouvert, très beau et que l’acoustique y est miraculeuse. C’est un très bel endroit à clientèle d’ailleurs très bourgeoise et si vous êtes à la corbeille de côté ou au deuxième balcon de côté, vous perdez un tiers de l’image.
Comme beaucoup de gens maintenant pensent cinémascope, les théâtres modernes ont des ouvertures très larges. Dans un théâtre à l’italienne il y a une ouverture de 7 à 9 mètres, c’est très très étroit et plus haut que large notre œil ce n’est plus du tout conforme à notre oeil.
C’est quand même incroyable que personne ne prenne conscience de Il n’y faire du théâtre contemporain ou pour cela à aucun lieu à Paris pour recevoir le théâtre contemporain étranger. Pas de lieu où on voit l’image dans son intégralité ! Rien dans la capitale de France à I’heure où l’on fait l’Europe.
Etienne Pommeret : Avec tout ce que vous avez déjà fait, qu’est-ce qui vous fascine chez les hommes, aussi bien chez les auteurs que vous avez découverts, que vous avez montés, que chez les acteurs que vous avez employés, et aussi chez le public que vous avez rencontré ? Je me dis qu’il y quelque chose qui vous travaille, qui vous mène depuis longtemps.
C. R. : C’est difficile à dire. Je pense qu’il s’agit avant tout de se laisser faire, de ne pas être volontariste, de se laisser faire par l’instinct. Dans les années cinquante, j’en avais un peu
assez du théâtre de l’absurde, je sentais que le théâtre dit social ou engagé était dans une fausse voie. (Vous savez il y a toujours des modes, quand on a commencé il y a trois ans à faire un succès avec Thomas Bernhard, on en a vu sortir vingt-cinq en deux ans alors que pendant dix ans personne n’y avait touché). À l’époque il m’a semblé qu’il fallait trouver des auteurs qui parlaient autrement que Beckett et Lonesco, autrement que Brecht, C’est vrai que pendant quinze ans j’ai été considéré comme réactionnaire parce que je ne montais pas Brecht. C’était un terrorisme intellectuel, le terrorisme du théâtre social. Pour trouver de l’argent j’ai dû aller chez Cardin qui à un moment s’était fait mécène. Le tout réuni m’a fait très mal voir de la gauche alors que pour la droite je suis un intellectuel de gauche. Donc je n’ai aucun terrain où m’appuyer. Je me suis habitué à m’avancer seul.
Ce qui m’a attiré dans ces nouvelles écritures, c’est d’entendre des gens qui parlaient une langue neuve, qui ré-inventaient une manière de parler d’eux et de leur rapport avec le monde extérieur, qui se rendaient compte que le monde avait changé Quand j’ai rencontré l’écriture de Gregory Motton cela m’a vraiment confirmé que ces textes ressemblent parfaitement aux années qu’on vit en ce moment.
À part quelques reprises dans certaines institutions qui me l’ont demandé, je me suis attaché — ici et là à ne monter que des écritures contemporaines. À chaque époque on écrit toujours la même chose depuis la Bible et je ne prétends pas qu’on invente quoi que ce soit. Mais à chaque temps, il y à une résonance particulière Il faut que les gens qui entendent certe résonance et qui arrivent à la transmettre en écrivant trouvent audience.
Quant aux acteurs c’est aussi beaucoup de l’instinct et quelquefois on se trompe, Il y à tout un système de jeu que je trouve intolérable, absolument faux, égocentrique, fait pour briller et qui s’isole de l’ensemble de l’œuvre. On continue à enseigner des tons qui sont ceux de la vieille déclamation, du sentiment, de la psychologie. Des tons qui ne font qu’accompagner les mots et qui provoquent en moi une réelle souffrance. Ce qui est aussi une souffrance, outre ce pléonasme insupportable et superficiel, c’est de voir des acteurs parler et s’agiter en donnant l’impression qu’ils n’ont pas du tout trouvé leur centre de gravité, qu’ils n’ont pas crouvé d’où part la parole, ce qu’elle veut dire et ne dit pas, et qu’ils n’ont pas senti que la parole
c’est du corps et qu’on ne peut pas parler d’un côté et bouger d’un autre côté. La parole et le geste c’est évidemment totalement lié. Is ont la même origine. On a l’impression que les acteurs parlent sans être à l’écoute de ce qu’ils disent.
Comme je viens d’éliminer tous les théâtres à l’italienne, c’est-à-dire un grand nombre de salles, j’élimine aussi, en disant ça, énormément de comédiens français. C’est pour cette raison que je fais souvent appel à des étrangers et que je travaille beaucoup avec de jeunes acteurs. Il me semble que monter des écritures contemporaines et les faire jouer comme on joue Racine, Brecht, ou Victor Hugo, c’est très grave. Comme pour une musique neuve il faut trouver les instruments et les instrumentistes pour les jouer, il faut chercher comment les jouer. Il faut
s’entraîner. Et bien sûr, comme le dit Jean-Pierre Thibaudat, ma bête noire c’est le réalisme. Avec tout ce qu’on voit à la télévision, ces dramatiques de très bas niveau où on ne demande aux gens que d’être « naturels » , on s’aperçoit que ce que les gens — public et critiques — ont dans la tête, ce sont des tons du Boulevard ; c’est inscrit dans les gènes et quand ça ne cause pa naturel ça ne va pas. Or si on l’écoute, le naturel est criant de fausseté. Et c’est un mensonge par simplification.
Il me semble qu’il devrait exister tout un travail sur la nature du langage, sur la manière de vivre le secret du texte et à la fois de le proférer. Il y a une autre dimension très importante.
En visant ce réalisme on limite non seulement le texte mais aussi les êtres. Il y à encore des pauvres gens qu’on force à jouer Célimène « la coquette » ou Tartuffe « le dévot hypocrite » ou on les force à incarner le plombier ou le charcutier, du coin. Ils font ça très bien, c’est très facile à faire, je peux vous le faire. Ça n’a aucun intérêt. C’est encore une mort qui est donnée. Pourquoi voit-on tant de morts données autour de nous ?
Il est très important que les acteurs soient des gens transparents, des gens qui sont vraiment là en tant qu’eux-mêmes et pas cachés derrière un rôle, un personnage ou un costume. Dès l’instant qu’il accepte de se montrer lui-même, chacun peur contenir l’univers entier et l’exprimer, chacun retrouve sa dimension d’infini.
Il faut aussi que le matériau de la totalité de l’œuvre passe à tout instant dans tous les acteurs à la fois. C’est un travail d’écoute, de sensibilité à l’espace et aux autres.
Souvent on ne tient pas compte de la densité de l’air, du climat particulier, du sol — si on y pense — qui n’est pas forcément si solide. On ne sait pas exactement de quoi nous sommes faits, par quoi nous sommes reliés aux gens et à l’espace qui nous entoure. C’est pourquoi l’architecture a tellement d’importance. Si nous nous laissons être, nous sommes reliés à I’ensemble du cosmos tout le temps. C’est peut-être pour atteindre cet ordre de choses, cette complexité vivante que j’ai besoin d’une certaine lenteur et d’un certain silence qui sont très mal ressentis par les activistes, mais qui seuls permettent d’atteindre ce qui constitue le tissu vivant d’une œuvre.
On dit parfois que je tue les acteurs, que j’enlève la vie, alors que j’essaye simplement d’enlever
l’activisme, le faux semblant, de retrouver un contact avec une vérité plus proche du réel, une autre vie. Donc je travaille avec des gens qui sont en même temps des musiciens, qui sont des danseurs dans leur corps immobile Ils ne font pas de la danse mais, dans la voix qui naît du silence, dans la manière de bouger à partir de l’immobilité, ils se laissent craverser, inonder par ce qui vient de l’écriture. Cette vie profonde, contradictoire, complexe, ils nous la transmettent. On ne fait pas ce qu’on fait pour ce qu’on fait, on le fait pour rendre compte de tout ce qu’on ne fait pas ; pour rendre compte de toute la matière incréée, de toute forme informulée.
Est-ce que j’ai répondu à ta question ?
E. P. : Oui, mais il manque juste une petite chose. Comment cela fonctionne avec le public après ?
C. R. : Oui, je vois bien ce que tu veux dire… Les gens foutent le camp. D’accord ? (rire général).