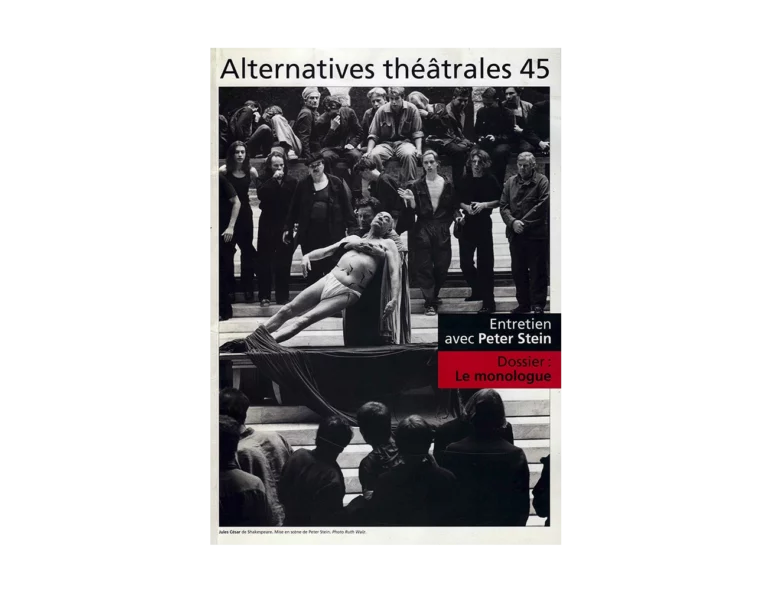L’ACCIDENT déroute et trouble au théâtre. Il procure le plaisir pervers de la panne qui, toujours possible, intervient comme une irruption pour lever le voile sur l’autre vie, la vie des corps jamais entièrement soumis à la fiction. L’accident se place à l’embouchure des deux vies que l’acte théâtral charrie. Il rappelle leur coexistence et séduit tant qu’il reste passager, fissure vite colmatée, et effraie dès qu’il brise l’écoulement de la représentation. Le premier atteste la persistance d’une vie qui sourd sous la vie imaginaire du théâtre, vie que le second annule. Par delà toute distinction, l’accident rend exceptionnelle la représentation car il l’arrache à ce qui est son destin, la répétition, pour l’élever au statut de l’événement qui, lui, est toujours unique.
Ces derniers mois, je fus témoin d’accidents qui ont tous partie liée avec les êtres et nullement avec les décors, les costumes ou les éclairages. Non pas accidents mécaniques, mais accidents humains comme seuls les arts du vivant peuvent en connaître. Le propre de cette fragilité dont on prend physiquement acte consiste dans la solidarité scène salle qu’elle engendre. Si fugitif soit-il, l’effet communautaire est extrême, pour le meilleur ou pour le pire. L’accident supprime les distances et suspend l’éloignement. Il désorganise le jeu et nous nous retrouvons du même bord.
Dans Münich-Athènes de Lars Noren, un élément de décor s’écroule. Comme il s’agissait d’un train express, Aurélien Recoing intègre dans le dialogue une réplique à même de camoufler la situation : « Non seulement on ne s’entend pas, en plus on a un accident ». Phrase tout à fait plausible, mais, surprise, sa partenaire Laurence Roy pouffe de rire et la salle sourit. L’accident mécanique brillamment rattrapé produit une intimité particulière, de même que dans un jeu qui se poursuit malgré la faute. C’est au fond le principe du clown qui introduit l’échec dans sa prestation. Le public s’en réjouit.
Il y a une différence entre l’accident mécanique et l’accident physique. Dans le même spectacle, après la dispute finale des deux personnages, Aurélien Recoing se retourne vers la salle, le visage ensanglanté. D’emblée je déplore cet inutile recours à l’hémoglobine dont le théâtre abuse ces derniers temps. Il se laisse contaminer par un goût de la violence qu’il ne parviendra jamais à tout à fait satisfaire : le sang au théâtre ne peut être que faux ! Le spectacle s’achève, applaudissements… Aurélien Recoing s’avance et demande s’il y a un médecin dans la salle. Les spectateurs s’esclaffent, convaincus qu’il entend mettre ironiquement en abîme l’accident. Mais dans la loge, l’acteur saigne pour de vrai… Et ce sang-là je l’ai pris pour le comble du faux. Conclusion hâtive qui confirme un postulat connu : le vrai, sur la scène, est le fruit d’une élaboration. L’accident en a produit un excès qui s’est converti, étant donné les circonstances, en son contraire.
L’autre accident auquel j’ai eu à me confronter fut un accident mnémonique. Dans Les marchands de gloire de Marcel Pagnol, Charles Berling oublie son texte, le trou noir, le vide, et alors, sans honte ni crainte, il s’avance vers nous pour nous informer de son impossibilité absolue de poursuivre. Le comédien ne se confond pas en excuses et ne vit pas la situation comme une défaite, bien au contraire il la retourne en regrettant publiquement l’abandon du bon vieux souffleur, la désinvolture de l’assistante absente, bref en faisant le constat de la solitude de l’acteur sur scène voué à tous les risques, tel un acrobate sans filet. Ainsi il convertit l’accident en aveu de comédien et le rire obtenu par ce micro-spectacle improvisé ne pourra plus être égalé ensuite par le vrai spectacle. L’accident mécanique ou mnémonique peuvent produire le sentiment d’une victoire partagée due au sentiment de danger surmonté par l’acteur qui sauve la situation.
Enfin, un dernier accident, l’accident psychique. Alors, la vie du comédien l’emporte sur le rôle et être spectateur devient insupportable. Nous sommes plongés au coeur d’une crise qui balaie le jeu et ses règles sans que personne puisse intervenir. Le théâtre se défait et la représentation s’effondre. Dans Salut, Tolstoi, le spectacle de Budapest d’Andres Jeles, repris en version française à Douai, un des interprètes de Nijinski, au lieu de suivre la mise en scène, se lance à un moment donné dans un long discours sur l’état du monde, ses drames et ses malheurs présents. Il parle désormais en hongrois et, tandis que je l’écoute, son ton me révulse et son jeu agace par son excès, par le grossissement et l’abus d’intensité, toujours suspecte au théâtre. Le spectacle devenait rhétorique… Quelqu’un entre alors sur le plateau — l’on nous expliquera ensuite que c’était le metteur en scène — jette un manteau sur le comédien accroupi et demande, en hongrois aussi, que tout s’arrête. La confusion gagne la salle qui ne parvient pas à savoir s’il s’agit de la vraie fin … Ensuite, après des explications, l’on mesure la portée de l’accident psychique qui se mue en traumatisme pour le spectateur : il a assisté en direct à l’obscurcissement d’un esprit.
Il y a enfin l’accident métaphysique, accident qui déborde la scène. On le sait, tout spectacle en plein air fonde son attrait sur la communication avec le ciel et la nuit, mais aussi sur sa précarité car il n’est jamais à l’abri des éléments. Une fois, leur intervention se chargea d’un sens auquel personne ne put rester étranger … ce fut l’été dernier lorsque le ciel orageux se déchaîna à l’instant même où Don Juan lance au Commandeur l’invitation de venir souper avec lui. L’accident météorologique se convertit en accident métaphysique. Quelqu’un de là-haut semblait répondre à ce qui se passait ici-bas, au pied du Palais des Papes. Il y avait un spectateur supérieur…
L’accident trouble encore plus dans les spectacles qui se présentent comme maîtrisés, strictement contrôlés car, dans les autres, où une marge de liberté persiste, il paraît être simplement un avatar épisodique, presque permis par l’esthétique adoptée. Comme chez Brook… L’accident qui vient briser un ordre strict a une valeur thérapeutique pour l’orgueil des metteurs en scène auxquels il rappelle ainsi qu’un désordre reste toujours possible. C’est pourquoi je rêve d’être témoin d’un accident dans un spectacle de Wilson. Un tout petit.