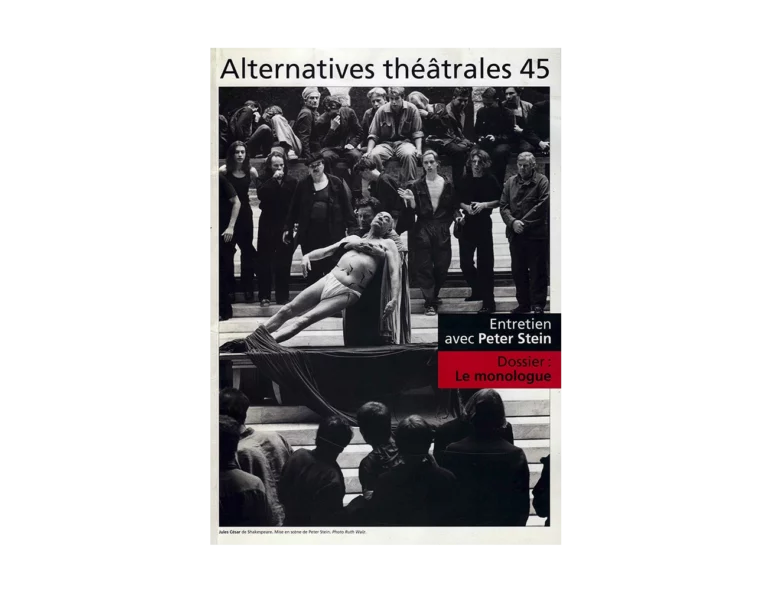J’ai beaucoup étudié la manière
W. Shakespeare, RICHAHD II (V, 3)1
De comparer au monde la prison où je suis,
Mais comme le monde est populeux
Et qu’il y a ici personne d’autre que moi
Je n’y arrive pas. Mais je vais m’entêter.
Je prouverai que mon cerveau est la femelle de mon âme
Et que tous deux ensemble ils engendrent
Une multitude de pensées pullulentes qui peuplent ce petit univers
D’une population au sombre caractère
Semblable en cela à celle de notre terre
Car il n’existe pas de pensée bienheureuse.
SCÈNE : Dans le bus, un homme assis parle. Il ne regarde pas la personne qui est assise en face de lui. Elle, le regarde par intermittence, mais il est clair que l’homme ne s’adresse pas à elle. Elle ne répond jamais. Lui continue de parler. Ses propos sont cohérents, s’adressent même à quelqu’un. Est- il fou ? Il parle seul. Il pense à voix haute, questionne, articule des idées, passant outre le regard des gens. Il accomplit en public ce que l’on est censé faire en privé. Est-il fou pour autant qu’il dérange cette convention, qu’il bouscule cette limite entre un acte solitaire et intime, penser, et un agir commun ? Dialoguer. L’homme se lève maintenant silencieux ; derrière lui une femme se lève, elle était assise clos à dos avec l’homme, ils descendent ensemble sur le trottoir, l’homme l’enlace. Ils reprennent leur échange côte à côte, en marchant. Voilà, scène du monologue amoureux, à trois. Une simple question de regard. De position dans l’espace, de l’homme qui voit la femme en face de lui mais regarde ailleurs, et s’adresse à une autre. Une autre présente, mais absente à son champ de vision. Quelle est cette présence/absence qui lui permet de parler seul ? Qui jette un pont, une connexion entre l’abîme du regard, et la voyance de la parole. Qui lui permet un instant de cesser de voir, pour dire et de rester en suspens, au-dessus du vide que sa parole explore. Mais plus que tout, d’en revenir, de lancer les amarres tout en gardant la possibilité de ce lien au monde, à ses normes. De ne pas être lettre perdue, de garder une adresse qui ferait retour à l’envoyeur.
Nous pourrions poser d’emblée que le monologue n’existe pas, mais ce serait occulter la question déterminante : qu’est-ce que parler ? Parler à l’autre, parler avec ou devant l’autre. L’autre inhérent au langage. Sans autre, rien. Le monologue ne peut pas s’aborder, se circonscrire sans une opposition au dialogue. Ils se définissent et s’excluent tout à la fois. Tout comme pour la définition du mot « même » (qui marque, entre autres, l’identité entre deux ou plusieurs objets comparés), il faut en référer à l’autre. Et pour « autre » il faut l’opposer à « même ». C’est une donnée immédiate de la pensée en français qui ne peut pas aller plus loin, qui ne peut pas dire, concevoir de même sans différent, sans autre. A travers le fait du « monologue » il est question de l’identité, de sa marque. Cela se conjugue à plusieurs et se mesure à… la mesure de l’autre, de son degré de présence ou d’absence.
Le monologue ? Une transgression impossible aux lois du langage dont la pensée même s’inscrit comme un défi aux limites du pensable.
Dans ce que nous pourrions nommer le théâtre classique, le monologue intervient le plus souvent dans une situation qui touche à son point limite et place alors l’être face à un insupportable, à choisir, à faire, face à un trop plein de vie, de mort. Il vient questionner les valeurs d’une société, imaginer d’autres voies, inventer parfois d’autres usages. Le moment du monologue apparaît souvent donc comme la marque d’une infraction aux lois de la cité par un individu. Il s’inscrit comme un défi à l’humain et à sa condition d’existence et devient l’exploration de cet insupportable et des limites repoussées par une parole solitaire. Il existe toujours un autre, présent ou absent, qui permet cet instant de voltige héroïque.
Richard II depuis sa geôle jongle avec son esprit, il invente cet autre qui lui permet de parler, il le forge tentant de diviser son esprit en deux, il procrée maintes et maintes pensées, engendrant la parole prodige qui perce les flancs pierreux de son univers solitaire. « Être plus qu’homme », voilà ce qu’il faudrait pour en finir avec le temps. L’homme qui se parle, se hausse au rang de la divinité ; dans son exploration, il se heurte à la fois aux conditions du temps, de l’espace et au jugement de la communauté. Il transgresse à deux niveaux, celui de la loi commune, et celui de la loi du commun des mortels. Shakespeare nous offre une belle définition de la parole solitaire. Dans la mise en scène d’Ariane Mnouchkine, Georges Bigot arpentait cette prison du langage et de sa destinée. Espace dessiné par de fragiles bambous. L’espace vide devient infini parce que défini, limité. Seul le corps de l’acteur, sa voix pourra en tracer les véritables contours, comme la parole trace les contours de l’être. Jeu d’ombre et de lumière, de visible et d’invisible. Comment le théâtre, l’acte de représentation, va rendre présent ce qui ne peut être vu ? L’abstraction inhérente au langage, la face cachée de tout monologue. L’immersion qui crée le voyage.
Un choix : représenter l’homme en train de penser, ou mettre en acte cette pensée. Ici c’est le voyage qui est joué par le corps de l’acteur et son adresse au public. Dans cette scène, la magnificence des costumes est réduite au corps dénudé de l’acteur, vêtu d’un pagne, et à son visage masqué (par le masque du maquillage). La représentation repose sur un langage du corps, sur une forme imaginaire inspirée du Kabuki et qui sert de fondation à la langue shakespearienne. Dans ce théâtre, le monologue ne se traite pas dans la tentative de montrer l’homme seul pensant, parlant ; l’acteur parle au public, se raconte devant lui. Ce dernier n’assiste pas à l’élaboration d’une pensée ; il est l’autre nécessaire à l’acte de parole. Le comédien lui adresse son récit et passe ouvertement par sa présence. Le pacte du cérémonial est clair.
L’hérésie d’un individu est le prélude à ce type de monologue qui intervient à la frontière avec l’insupportable, toute la tension épique reposait sur ces grandes scènes où la parole dévaste et libère, comme une ivresse, une conscience secrète, une naissance.
La tragédie grecque met tout particulièrement ce paradoxe en relief : la nécessité de la violation de la limite comme fondatrice de l’humain et le fait que la puissance de l’acte passe non tant par l’acte lui-même mais par le récit (le monologue) que le héros peul en faire. L’action ne compte et ne s’inscrit dans la mémoire de la communauté que par rapport au dire et à la manière de dire, qui porte le coup, se fait geste.
Défier. Au sens premier « de renoncer à la foi jurée ». Défier par l’outrage de la parole, c’est en quelque sorte se donner la liberté de renoncer à la foi commune. Une prise de parole, comme une conscience, une solitude qui fait affront, celle d’une individualité qui altère le groupe par sa différence. Le monologue est alors ce temps extraordinaire où la parole aurait pour fonction de permettre à un être d’explorer son identité, de penser sa place dans le monde, avec d’autres repères. Ceux-là qui pourront peut-être naître dans cet instant solitaire.
Le défi moderne
Le théâtre contemporain semble se heurter à une question récurrente, celle de la représentation de l’horreur de l’actualité ; le monologue est à l’honneur. Comment forger une pensée devant l’innommable, une parole qui dit la guerre, les viols, les camps, qui énonce. Le monologue a souvent cette fonction de penser ce qui n’est pas pensable, en tout cas c’est à lui que l’on a recours pour cette tâche. Comme si quelqu’un qui parlait seul renvoyait toujours à un point limite, à un insupportable ; soit qu’il n’y ait plus d’espoir d’être entendu, de pouvoir dialoguer, soit que ce qui se raconte est innommable.