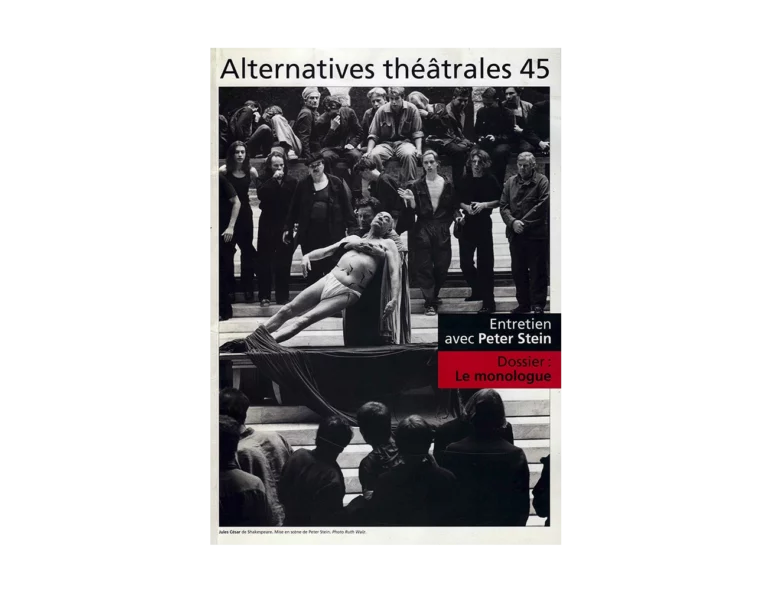-1-
LE MONOLOGUE ne va jamais de soi, pas plus au cinéma qu’au théâtre. Pas plus que ne va de soi le sens qu’on donne à ce terme : s’agit-il d’un personnage seul en scène, et tenant à voix haute l’équivalent d’un discours intérieur ? S’agit-il seulement d’un personnage qui garde trop longtemps la parole pour lui seul, et qui attire de ce fait l’attention ? Ou s’agit-il de cette déshérence du langage, de cette ratiocination autour de la rumeur balbutiante du monde, et qui fait le monologue virer en soliloque, seule puissance dont l’esseulement est encore capable ? Le monologue constitue une manière de pause dans la conduite de l’intrigue, sinon un arrêt — difficulté pour un art du mouvement. Le cinéma peut néanmoins compenser ce ralentissement par le gros plan, lequel met l’accent sur l’intériorité d’un personnage en nous y donnant directement accès. C’est ainsi du reste que l’irréalisme foncier du monologue se trouve justifié dans la dramaturgie classique, c’est ainsi du reste que nous le vivons : le monologue est le comble de l’incarnation, puisque ce qui s’incarne devant nous, c’est le plus immatériel du personnage, — qu’on l’appelle âme, esprit, mais saisi tout entier dans son être-de-langage. Or l’intériorité est problématique au cinéma car avant que d’y être un être-de-langage, le personnage est un corps et une voix, un spectre composé, mais essentiellement agissant. Un monologue en ce sens n’est pas seulement irréaliste. Il est a priori impossible, parce que contradictoire en un sens avec les composantes mêmes de son matériau visuel : plus exacte ment, l’image-mouvement et le privilège de l’image-action font du monologue une forme excessive.
D’ Aubignac faisait de la parole un acte : « parler c’est agir » dit-il en substance. Au cinéma, aussi. Mais différemment. C’est qu’au cinéma, il est toujours possible de montrer directement l’action elle-même : aussi parler empêche-t-il bien souvent d’agir. C’est non seulement la parole qui constitue en soi, un acte, mais bien souvent, entre dire et voir, une opposition s’instaure : entre les deux, il faut choisir. Le verbe n’a pas toujours gagné, l’image non plus. Mais dans ce cas tout bressonnien, la parole n’est pas la seule alternative à l’image : tout ce qui fait sens peut sans doute se retrouver dans la bande-son, mais cela n’implique nullement qu’un personnage y parle, ni qu’il y ait monologue. En un sens, le monologue est non seulement excessif, mais son excès signale un danger, permanent, que le cinéma doit affronter : le pléonasme. On sait comment Bresson le résout : entre une image et un son, il choisit le son. Mais la parole ? N’avait-elle pas déjà cédé devant l’image ?
-2-
Preuve a contrario : Manoel de Oliveira. Il est sans doute le seul à avoir utilisé le monologue de façon aussi radicale puisqu’il n’a jamais essayé de le motiver, que ce soit par rapport au cadre réaliste de l’écran, ou par rapport à l’intrigue. Il est aussi celui qui l’a sans doute exposé le plus directement, en donnant le monologue comme tel, en l’adressant directement au spectateur, sans le secours d’aucune médiation. C’est dans son œuvre qu’on peut en effet trouver un recours au monologue pris dans le sens conventionnel du terme : action de parler seul sur scène. Le recours à des textes d’origine théâtrale (LE SOULIER DE SATIN) ou de nature poétique (l’épopée de Camoens qu’il fait représenter dans le cadre outrageusement irréaliste de NON, OU LA VAINE GLOIRE DE COMMANDER) ne suffit pourtant pas à rendre raison d’un tel choix. De fait, plutôt qu’à un renforcement de l’illusion théâtrale, le monologue chez Oliveira exhibe les conventions et l’artifice, en soulignant l’artificialité de l’entreprise artistique ; ce faisant, en se contentant d’avouer que l’objet proprement cinématographique ne consiste qu’en l’enregistrement le plus plat, parce que le plus fidèle, de ce qui fut, l’artifice se dérobe à l’accusation d’artificialité, et l’authenticité qui entoure certains monologues est étonnante de la part d’un système qui se refuse autant aux moyens habituels de l’identification. Plus exactement, le monologue produit chez Oliveira un effet de vérité, dont bénéficie non pas le cadre narratif de la fiction, mais celui, proprement filmique, de l’image : l’authenticité, la vérité, la réalité qui s’exposent à nu, c’est celles de l’acteur, de la situation, d’un hic et nunc immatériel, dont resplendissent ultérieurement les images qui en ont été conservées.
Avec MON CAS, se précise notre autre hypothèse. Le discours du personnage principal appartient au registre du monologue ; mais les modifications qu’imprime une utilisation malicieuse de la caméra font de ce monologue une variation originale sur la notion de crise. De surcroît, lorsque les divers personnages tentent de prendre la parole, comme on prend le pouvoir, c’est d’abord pour se la prendre. L’impossibilité de parler quand on ne s’écoute pas se traduit par l’interdiction qui est faite d’occuper ensemble le champ circonscrit par la caméra : prendre la parole, c’est d’abord la voler à l’autre en l’empêchant de se tenir dans le cadre. Aussi l’équation gros plan et monologue se vérifie-t-elle ; mais en redoublant le monologue par l’image, Oliveira sature une situation engagée en effet sous le signe de la crise. La crise du personnage ne passe pas seulement par un verbe logorrhéique qu’il serait impossible de canaliser, c’est le corps même de l’acteur qui porte en lui la crise, qui déborde littéralement. Peu importe alors si le texte entendu appartient encore au corps vu à l’écran, ou si dans cette apothéose du soliloque, d’autres textes viennent parasiter cette présence de trop qu’est« un cas ».
Le monologue est donc bien l’analogue du gros plan : gros plan sur la voix, gros plan sur le langage et le verbe qui n’arriverait pas, sinon, à s’incarner réellement. Mais si la voix est toujours dans la bande-son, le monologue filmé donne parfois l’illusion que la voix est filmée, que la parole est dans l’image, est l’image elle même. Ce n’est pas le corps qui s’immatérialise, c’est le souffle qui se fait chair : encore une histoire d’incarnation, en somme.
-3-
De cette équivalence mentale du monologue et du gros plan, j’eus la confirmation en interrogeant le souvenir que nous conservons d’un film ou d’un spectacle. Quand je retiens la prestation d’un acteur, c’est en l’isolant du cadre qu’il partage avec ses camarades de plateau, et je souligne alors un moment, — pour l’accent d’une diction, pour la joie d’un timbre mystérieusement apparié en bouche à une épaisseur de langue, que sais je. Comme un prélèvement opéré sur la continuité de la représentation : même pas un tableau, séparé de la scène jouée dans sa totalité, mais plutôt un encart, qui s’isole en se laissant cerner d’un trait. Quelque chose comme un instant remarquable.