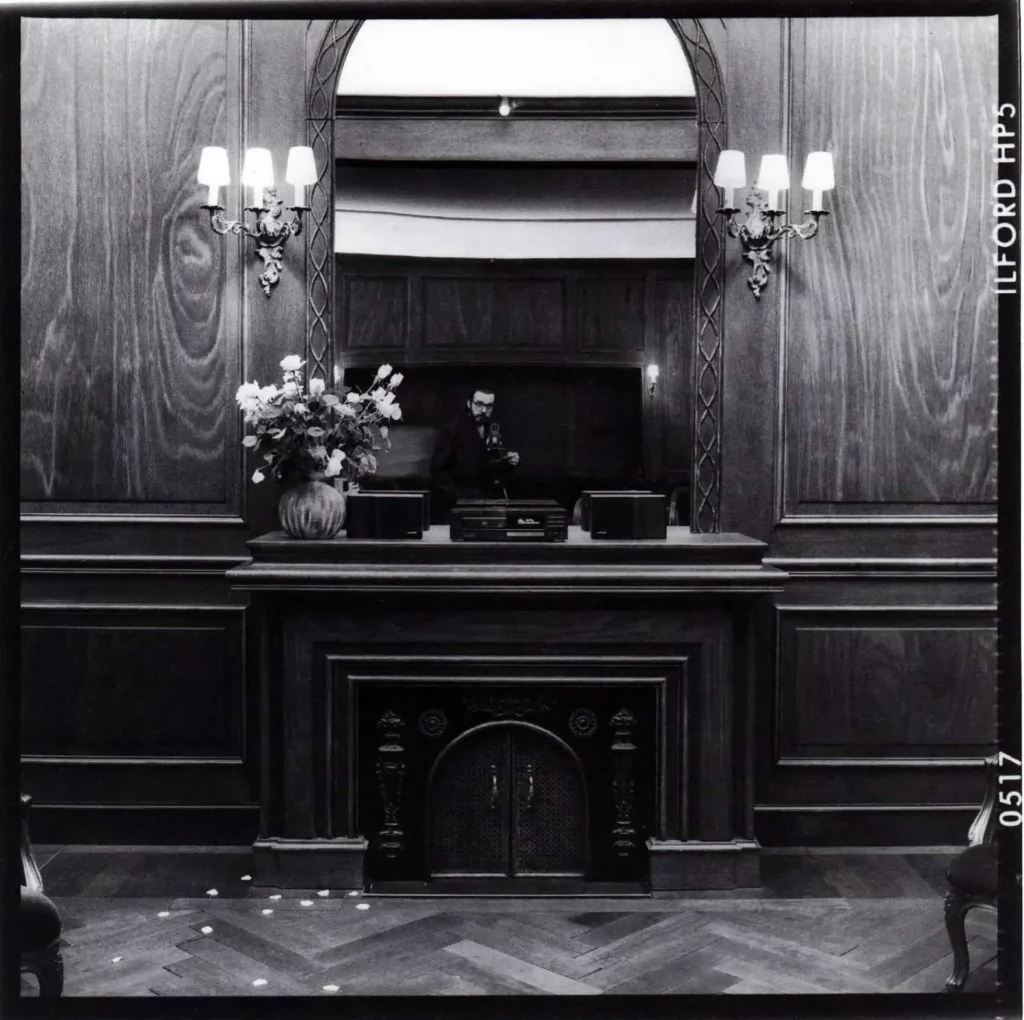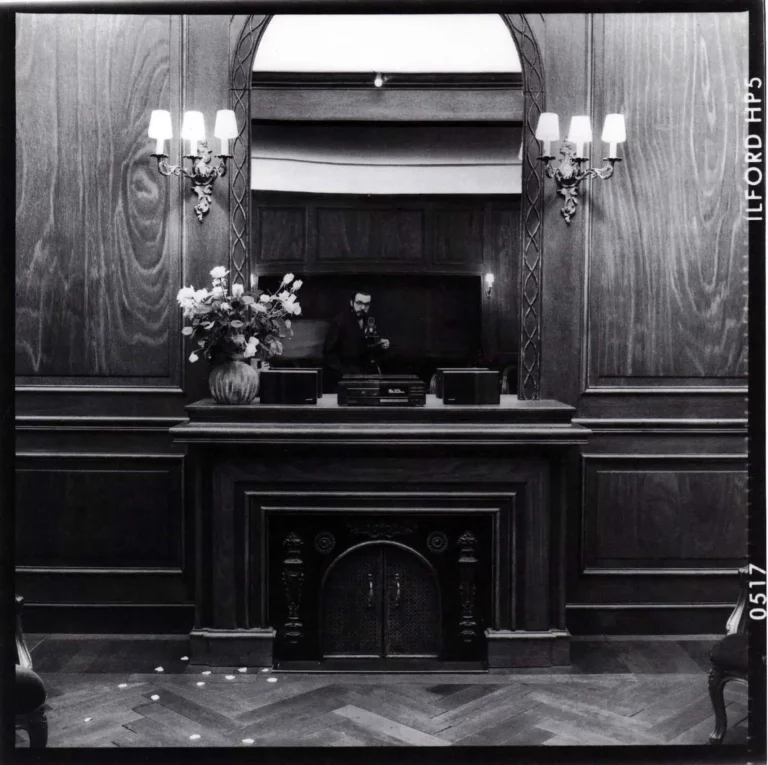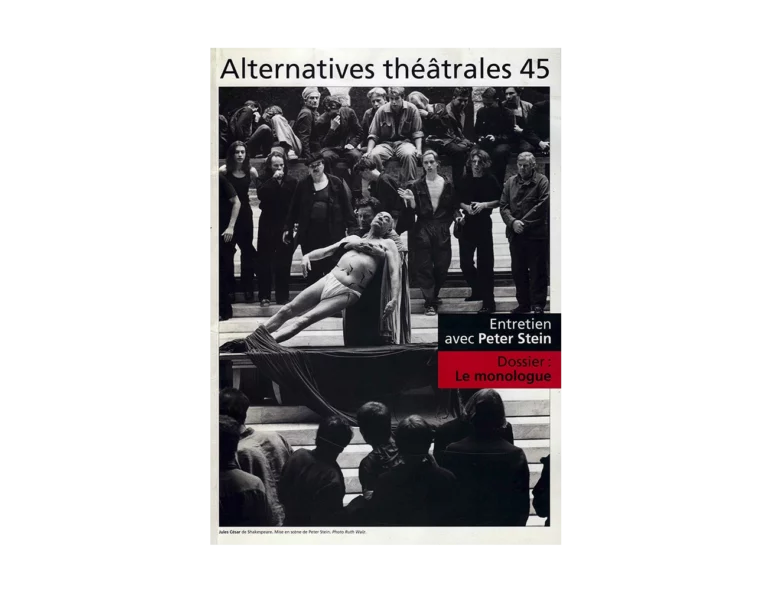NOTRE SADE, ma première pièce, était une dérive à partir des LETTRES DE VINCENNES ET DE LA BASTILLE, et à l’époque, il me paraissait évident que le locuteur fût seul en scène, aussi seul que l’était Sade dans sa prison.
En ce qui concerne Jocaste, je n’ai jamais pu l’imaginer en grande conversation avec qui que ce soit : il me semblait au contraire qu’ayant été lâchée par tout le monde, y compris les auteurs dramatiques qui après Sophocle ont écrit des Œdipe, mais pas des Jocaste, elle ne pouvait être que seule en scène.
Quant à l’adaptation de OUI : le récit de Thomas Bernhard étant celui d’un homme seul, il n’était pas question de toucher à cette forme-là.
C’est dire qu’au moment où nous les produisions (dans l’écriture ou dans la mise en scène), ces monologues, nous n’avons jamais interrogé cette forme, elle nous paraissait évidente, normale, allant de soi, convenant bien au sujet, etc.
Et voilà qu’invitée à réfléchir sur la chose, je commence par consulter des dictionnaires, et je m’aperçois qu’au départ, le concept n’existe qu’au théâtre : c’est seulement en 1811 que « le mot est passé clans l’usage général au sens de long discours d’une personne qui oublie la présence de ses interlocuteurs» ; c’est ce que nous dit le DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE. Je découvre aussi que ce mot a toujours eu un sens quelque peu péjoratif. Dans un vieux dictionnaire de 1884, je ne trouve cet « emploi » — si j’ose dire — qu’au théâtre : « Scène d’une pièce de théâtre où un personnage est seul et se parle à lui-même », et en italique, s’ajoute un triste commentaire : « Les monologues arrêtent l’action et manquent souvent de vraisemblance ». Le monologue n’apparaît donc même pas comme un genre en soi, il s’insère dans une pièce « normale » et il en est comme un défaut, puis qu’il arrête la sacro-sainte action. Pauvre monologue !
Pourtant, une action, il y en avait une dans NOTRE SADE, puisqu’il s’agissait d’amener un personnage à sortir de son enfermement et à s’identifier lui-même en se débarrassant du grand modèle transgressif (Le Marquis) qui lui colle à la peau, l’enveloppant comme une coquille, la noix ou comme la chrysalide, le papillon. Heureux temps, grandiose époque, que celle de la Révolution, de la Transgression, du Matérialisme militant, du Sexe déflagrant !
Que peut le personnage d’aujourd’hui face à une telle référence ? Ce personnage n’a pas d’identité : il n’est pas Sade ; il n’est même pas nécessairement son contemporain — écrit en 1979, il est forcément plus proche de nous que de lui‑, il n’est donc pas son voisin de cellule et il n’a pas vraiment de sexe — la pièce fut écrite au masculin, mais se transposa facilement au féminin quand Sylvie Milhaud la joua‑, mais s’il ne cherche pas, à proprement parler, son identité, il tend vers ce qu’on pourrait appeler une naissance. C’est un véritable combat qu’il mène avec Sade tout au long de la pièce, à travers des embryons de jeux de rôles où il joue Sade, bien sûr, mais aussi la Montreuil, par exemple. Il convoque donc des interlocuteurs dont il est à la fois le partenaire et la conséquence : sans Donatien de Sade, pas de « Notre Sade»… Et ce combat qu’il mène avec une histoire qui l’encombre et ne sera jamais la sienne, se termine, on peul le dire, par une victoire, modeste et plus programmatique qu’accomplie, mais victoire quand même.
Marc Liebens, le metteur en scène l’avait bien compris, puisqu’il avait fait jouer le dernier fragment sur le proscenium, devant le rideau qui s’était baissé entre-temps. S’étant débarrassée de la carapace-Sade, Sylvie Milhaud faisait mine en même temps de vouloir sortir de l’enfermement-théâtre pour se lancer (enfin !) dans une existence plus autonome et qui avait peul-être à voir avec du réel.
Combats, initiation, naissance… Ne sont-ce pas là les ingrédients d’une action, même si elle est imaginaire et qu’elle ne se joue qu’à l’intérieur d’une seule tête ?
Que Jocaste ne rassemble pas autour d’elle Œdipe, Tirésias, le chœur et le Coryphée, cela me paraissait normal, mais qu’elle parlât seule me faisait peur : je ne voulais pas que sa parole devint ressassement inutile. D’autre part, qu’elle s’adresse directement au public me paraissait un peu facile : un personnage de fiction ne peut pas communiquer aussi simplement avec le public qui se trouve, lui, dans le réel. Il m’a donc plu que quel qu’un l’écoutât fût-ce d’une oreille distraite ou… musicale. Si réponse il y avait, elle ne pouvait faire sens, à peine relance, puisqu’il était muet, le musicien. Jocaste n’avait donc que ses mots pour exister : de l’Autre, rien ne pouvait venir.
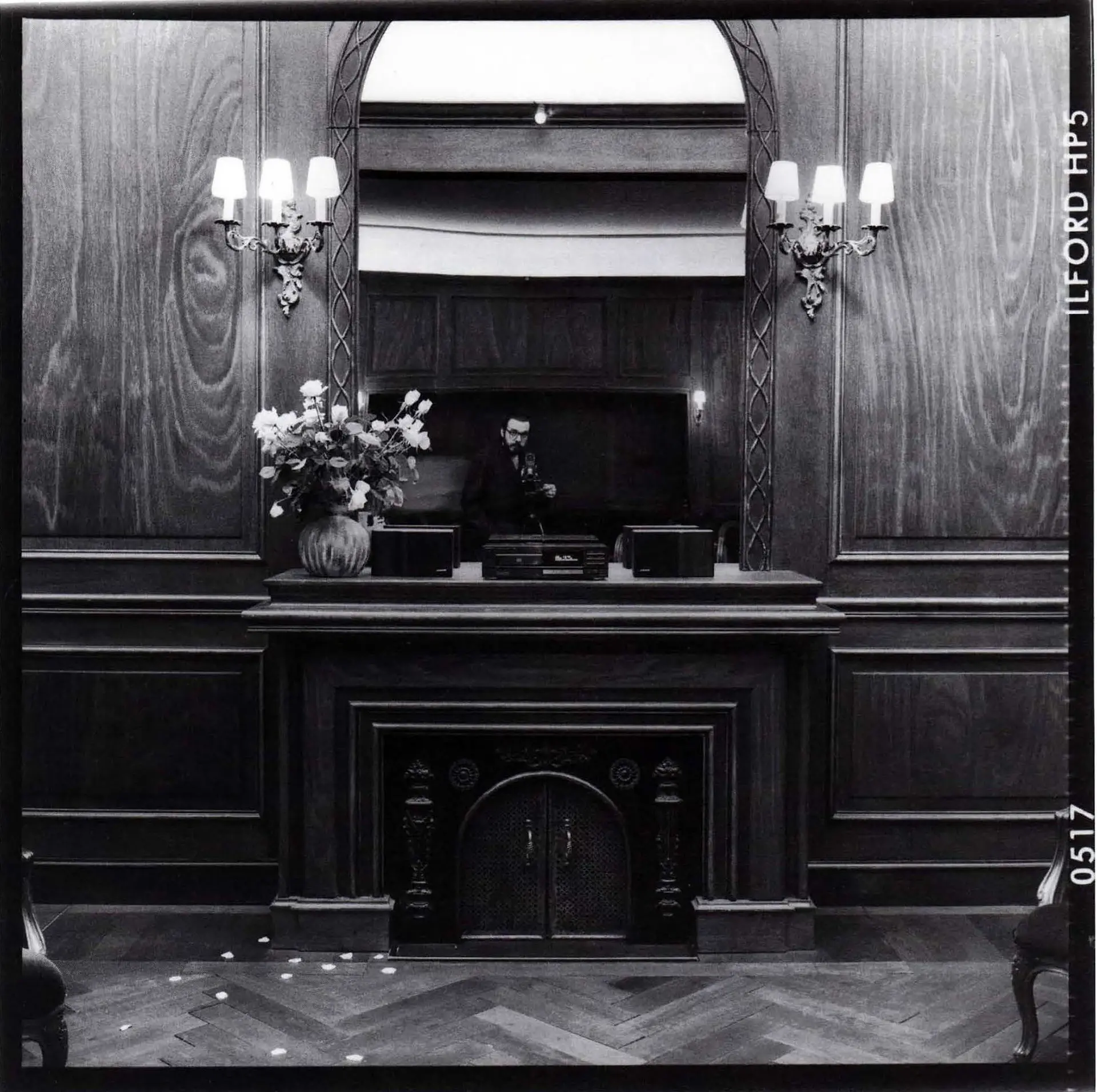
Je consulte le DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE de Bloch et Von Wartburg, et je constate que « monologue » a été fait sur le modèle de « dialogue» ; « dialogue », donc, est antérieur. Comme si la solitude venait toujours après… L’histoire se fait d’abord ; ensuite, elle se raconte. C’est bien vrai. Quand Homère a écrit L’ILIADE, la guerre de Troie avait eu lieu et tous les héros étaient morts !
Mais Jocaste, il me semble, raconte moins l’histoire d’Œdipe qu’elle ne se raconte elle, à travers cette histoire. Et encore, « raconter », est-ce le verbe qui convient ? Dans ce texte, il y a « Je », « Tu », « Il », « Elle », ce ne sont pas des noms, seulement des pronoms, mais quand même, cela peut faire de interlocuteurs. Et si « Il » est, la plupart du temps, facilement identifiable à Œdipe, comme « Tu » peut l’être au musicien ou au public, « Elle », par contre, c’est Jocaste, mais une autre, pas celle qui aujourd’hui dit « je », mais celle qui autre fois s’est jugée avec les yeux du monde antique, celle qui fut comme elle dit : « immonde et suicidée ». C’est donc bien à un dialogue que nous assistons, pas un combat comme dans NOTRE SADE, mais un dialogue entre deux Jocaste, l’antique qui s’est pendue et la moderne qui se parle. De parler, je pense qu’elle tente de se constituer ; de parler à l’autre Jocaste je veux dire.