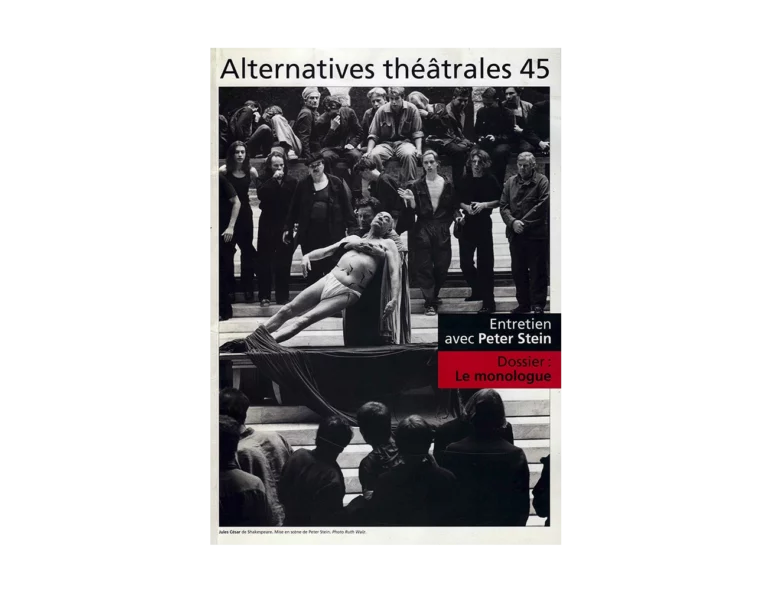1TOUT COMMENCE, au théâtre, avec le monologue de Lucky2. Sur l’injonction de Pozzo, « Pense, porc ! », la pensée sans maître se déverse, incohérente et chaotique, dans un flux non ponctué, comme si on avait ouvert les vannes au tumulte intérieur. La syntaxe se réduit à sa parodie, impuissante qu’elle est à l’aire autrement que semblant d’ordonner le désordre (ou le désastre), trouée de parasites venus de strates encore plus obscures, encore plus imprévisibles (« quaqua quaqua » ). Pensée misérable, qui se raccroche à des trucs ou à des tics (« mais n’anticipons pas »), se laisse ballotter par les associations(« à la campagne à la montagne et au bord de la mer ») et les assonances(« l’équitation l’aviation la conation »), bégaie (« à la suite des recherches inachevées inachevées de Testu et Conard il est établi tabli tabli »), prend ce qui traîne dans la mémoire (« aux nues si bleues […] si calmes ») et, si misérable qu’elle soit, se poursuivrait indéfiniment si on ne l’interrompait de force. On pourra dire que la pensée ici n’existe que dans cette extériorisation commandée (la pensée comme exercice de cirque), que dans le discours oral qui s’efforce (comiquement et pathétiquement) de la construire. C’est vrai, mais en même temps ce discours, s’il doit certaines de ses marques formelles à l’oralité, présente toutes les caractéristiques du monologue intérieur. Il y a donc comme un estompement de la frontière entre pensée proférée et monologue intérieur qui fonde doublement le théâtre à venir de Beckett : d’abord, parce que la plus grande partie de ce théâtre se donnera pour tâche de trouver des solutions scéniques au problème de l’extériorisation de la parole intérieure ; ensuite, parce que le monologue de Lucky, presque central dans EN ATTENDANT GODOT, est à la fois, dans son énormité, une excroissance de la pièce, et une sorte de siphon qui menace d’engloutir les autres personnages et la réalité extérieure. Vladimir et Estragon doivent se débattre avec l’énergie de qui est tout près de se noyer pour se sauver de là et sauver leur monde. FIN DE PARTIE constituera, cinq ans plus tard, un aboutissement de ce monde, celui de l’altérité3, mais c’est au cœur du siphon que nous entraînera la quasi-totalité de l’œuvre théâtrale ultérieure de Beckett.
Dès les nouvelles écrites en 1945, et surtout les TEXTES POUR RIEN (1950), préfiguration des grands romans des années 51 (MOLLOY, MALONE MEURT) et 53 (L’INNOMMABLE), se met en place la problématique que Beckett commencera à transposer au théâtre à la fin des années cinquante.
Pour nous en tenir aux TEXTES POUR RIEN, chacun des treize morceaux qui les composent — en particulier le premier — peut être lu comme prototype du monologue intérieur beckettien : un narrateur« couché face au sol »4, exilé de la « lumière » et du monde des « vivants » (demeurés « là haut »)5, un temps immobile6 ouvert au ressassement infini7, dans un « souffle », au bord de l’endormissement8 — « je souffle, en me disant, avec des mots comme faits de fumée »9. Le théâtre sera le lieu où se fera entendre ce « souffle » qui semble sortir d’« une poupée de ventriloque »10.
Le problème qui se posera à Beckett sera : comment transposer au théâtre cette immobilité aux antipodes du théâtre (du théâtre avant Beckett — avant lui, seul Maeterlinck s’était aventuré aussi résolument dans ces parages) ? Un semblant de réponse s’esquisse, pour qui connaît la suite, dans le dédoublement : « Je suis là haut et je suis ici, tel que je me vois, vautré, les yeux fermés, l’oreille en ventouse contre la tourbe qui suce »11. C’est ce clivage initial — que COMPAGNIE, autre texte clé à l’autre bout de l’œuvre (1980), portera à son comble en développant l’idée d’un moi gigogne, d’un moi parlé, plus qu’il ne parle, par une « voix parv [enant] à quelqu’un dans le noir »12 , elle-même parlée … et ainsi de suite — qui constitue une des failles par lesquelles s’immiscera le théâtre.
LA DERNIÈRE BANDE (1958) est la première pièce de Beckett entièrement monologuée. Encore cette affirmation doit-elle être aussitôt nuancée puisqu’il s’agit d’un monologue à deux voix : celle, parlée, de Krapp dans le présent, celle, enregistrée, du Krapp d’autrefois. Nous verrons que si Beckett ne cesse, dans ses œuvres ultérieures, de s’approcher de la forme monologue, aucune d’entre elles n’est un simple monologue — au sens où un personnage seul en scène parlerait à la première personne, ce qui est le cas de l’immense majorité des monologues écrits pour le théâtre. Il y a, au moins, dislocation ou dissociation — voix multiples, voix unique à la troisième personne, etc., tous procédés qui soulignent et quasiment mettent en abyme cette mise à distance de la monade du moi qu’impose le théâtre13. C’est en cela que l’œuvre dramatique de Beckett garde jusqu’au bout une spécificité qu’on lui dénie parfois, au nom, juste ment, du recours au monologue. D’une certaine manière, on peut dire que l’incessante recherche formelle qui caractérise son théâtre vise à apporter des solutions scéniques au problème de la convention sur laquelle est fondée toute tentative de représentation théâtrale du monologue intérieur.
La réponse qu’il apporte dans LA DERNIÈRE BANDE repose donc sur l’utilisation du magnétophone comme partenaire de Krapp, et ce de deux manières. D’abord, Krapp peut parler tout seul puisqu’il s’enregistre (c’est en cela que la convention se trouve revitalisée), et cette parole, au plus près de ce qu’il se dirait à lui-même, est un compromis entre le pur monologue intérieur, par définition inaudible, et la parole proférée. Mais surtout, lorsque la bande défile, c’est elle qui remplit le vide, tient lieu de pensée à Krapp : laissé à lui-même, celui ci ne livre que quelques brèves syllabes en relation avec ce qui l’occupe14. Il ne retrouve la parole que pour enregistrer ce qui pourra lui tenir lieu de pensée plus tard. La pensée, ici, est clone désignée comme pensée de l’autre, « pensée du dehors »15 ; rendue visible par le défilement de la bande, qui n’est pas sans évoquer l’automatisme cinématographique. Le spectateur, de plus, voit les bobines tourner, et c’est comme la matérialisation du déroulement de la pensée — l’effet produit a quelque chose d’hypnotique qui fait de cette pièce, paradoxalement, une des œuvres théâtrales dont la représentation offre la plus grande analogie avec le déroulement d’un film.
Si dans OH LES BEAUX JOURS (1961)16 l’extériorisation, les adresses de Winnie à son partenaire, disons la « théâtralisation », relèguent au second plan ce que son quasi-monologue présente comme points d’analogie avec le monologue intérieur, c’est dans les pièces ultérieures que se manifeste l’expérimentation de voies nouvelles dans la représentation scénique de ce dernier.