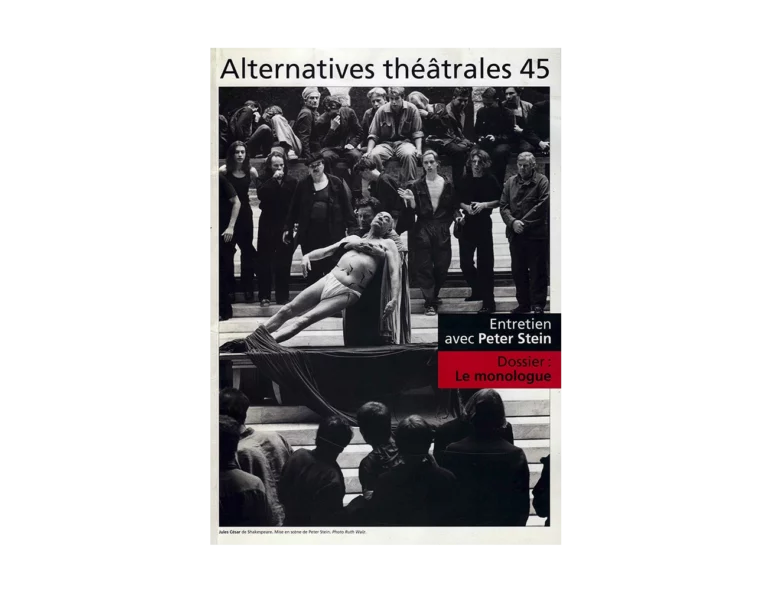LES VOIX s’organisent et se réfléchissent les unes par rapport aux autres, elles se donnent à entendre. Où se place le point d’accord entre la logorhée désarticulée d’un individu mis dans une « situation émotive » particulière et le pilote de chasse face aux commandes vocales du « Rafale MO 1′», dernier avion de combat polyvalent des armées françaises ? D’une seule voix, chacune de ces situations répond à des fonctions différentes. Elles ont pourtant un mode d’énonciation qui leur est commun : le monologue.
Le théâtre devrait être à priori le « producteur » légitime de paroles monologuées, or il semble que les situations monologiques débordent très largement ce cadre, devenant même des activités organisées, réfléchies souvent associées à des contextes où l’interactivité, l’échange d’informations, est au centre. Sans forcer les traits de l’imagerie classique du « theatrum mundi » qui ferait du monologue un point d’accord de plus entre théâtre et vie sociale, la mise en œuvre de la parole monologuée est aujourd’hui une pratique régulière, ritualisée, normée ; la mise en scène des voix et des corps s’établit comme une pratique sociale et politique qui donne à voir le monologue sous de multiples aspects dépassant très largement sa dimension théâtrale. Le pilote du Rafale écoute avec attention les instructions vocales de l’ordinateur qui lui fait face ; la voix féminine qui dédramatise et érotise la situation est le seul « maître » à bord. La voix signifie alors objectivité et autorité ; en cas de danger il faut la suivre (jusqu’à la mort). L’interactivité entre la machine et son utilisateur témoigne que « pour la première fois dans son histoire, l’homme n’est plus le seul à pouvoir parler »1 ce qui donne à l’horloge parlante le privilège d’être à tout jamais le plus long monologue possible et qui en idée ne comporte ni début ni fin. Les monologues d’instruction et de mode d’emploi s’attachent à déréaliser le danger des techniques. La pédagogie de l’hôtesse de l’air qui prend la parole au moment du décollage dans une démonstration du masque à oxygène, ritualisée par une mise en scène où la gestuelle est parfaitement synchronisée avec la partition vocale, fait du monologue un moyen privilégié des techniques de l’explication. Le monologue devient alors une pratique organisée ; sa dimension normative naît de sa démarche didactique. Le spectateur, focalisé sur la chorégraphie de l’hôtesse qui module ses intonations, pose avec application sa voix par souci de clarté, enregistre les informations rassurantes et attend patiemment une autre fiction ; celle du film qu’on lui projettera accompagné du casque traducteur trilingue. Ces monologues techniques, notices vocales désincarnées, sont aujourd’hui des pratiques organisées, ils deviennent les intercesseurs obligatoires entre l’utilisateur et l’objet technique ; rôle sans cesse grandissant de la figure de « l’intermédiaire », celui qui gère la communication entre deux mondes, ou qui, comme l’attaché de presse, vante et présente le produit. Le passager de notre avion avant de décoller a déjà construit son parcours dans l’aéroport en suivant les « annonces » monologuées qui, s’adressant au plus grand nombre, canalisent et distribuent l’individu dans l’espace et le temps. Tout comme le monologue du guide touristique, la voix donne une cohérence à un parcours, elle inscrit l’individu dans le temps et l’espace, conduit le touriste à respecter dans tous les sens du terme les horaires, les lieux, l’histoire. Le paysage archéologique, géographique, et historique est objectivé par le guide ; on légitime son voyage à travers la cohérence du discours du guide omniscient. C’est le privilège du passager qui, à la différence de la figure du flâneur du XIXe siècle, voit ses trajectoires contrôlées et gérées par le monologue d’explication qui plutôt que d’ordonner ou de discipliner, incite, conseille, induit l’utilisateur à suivre des parcours préétablis. Le monologue du guide ou de l’hôtesse reste l’intermédiaire qui assure la bonne mise en place des « conditions de circulation dans des espaces où les individus sont censés n’interagir qu’avec des textes sans autres énonciateurs que des personnes « morales » ou des institutions dont la présence se devine vaguement ou s’affirme plus explicitement, derrière les injonctions, les conseils, les commentaires, les « messages » transmis par les innombrables « supports » qui font partie intégrante du paysage contemporain ».2
La parole monologuée instaurée en une pratique inscrit l’individu dans l’espace, légitimant une présence, la voix devient un acte juridique. Colomb qui met le pied sur la nouvelle terre ou Armstrong sur la lune, touche et parle pour inaugurer une présence. La situation monologique dans un acte de baptême constate et atteste la prise de pouvoir sur une nouvelle scène. L’acte symbolique de l’inauguration est toujours accompagné d’une parole monologuée qui reste extérieure à celui qui énonce. Il parle au nom d’un État, d’une institution, sans implication de soi, sans expression d’une émotion particulière ; le monologue s’établit comme un phénomène d’autorité, un acte qui légifère et constate un état final où les mots sont prémédités. Le discours sur « le nouvel ordre mondial » de George Bush au terme de la guerre du Golfe avait valeur d’acte juridique témoignant de la fin du conflit, d’un redéploiement du territoire convoité. Il fait parler la loi américaine dans une prosopopée qui désengage le locuteur ; les « porte-parole » monologuent « au nom » d’un Autre, entité supérieure à laquelle ils prêtent leur voix.
- Ezio Manzini, ARTEFACTS. « Vers une écologie de l’environnement artificiel », éd. Centre George Pompidou, 1991, p.67. ↩︎
- Marc Augé, NON-LIEUX. « Introduction à une anthropologie de la surmodernité », éd. du Seuil, 1992, p. 120. ↩︎
- Michel de Certeau, L’INVENTION DU QUOTIDIEN. « Arts de faire », éd. Union Générale d’Editions, 1980, p. 269. ↩︎
- Melanie Hawthorne. PARALLAX 1, « States of architecture and Dance », 1989. ↩︎
- Richard Sennett. LES TYRANNIES DE L’INTIMITÉ. éd. du Seuil, 1979, p. 204. ↩︎