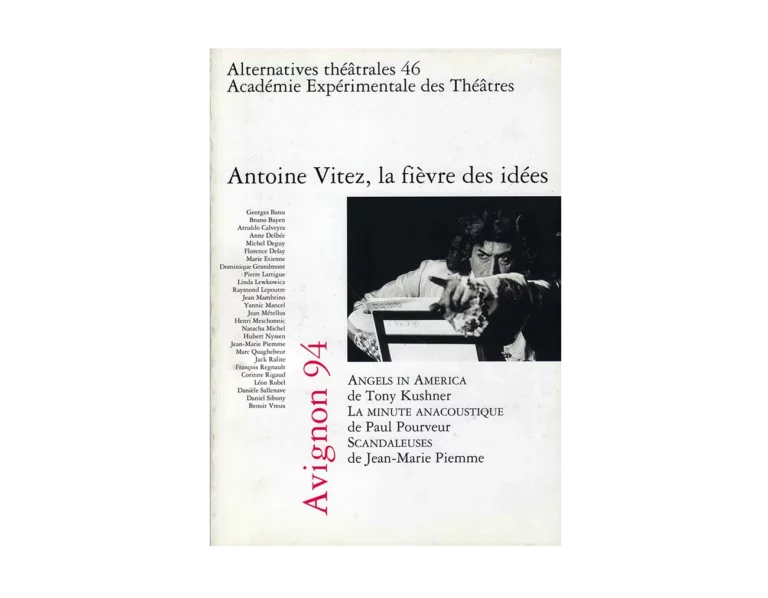VITEZ. J’ai de la sympathie pour cet homme — et son théâtre d’idées — la même sympathie que j’aurais pour un être qui se combat avec sérieux pour trouver le ludisme, qui cherche dans la souplesse la dureté pour tenir, qui réalise son origine en la niant, et qui la nie pour respirer — souffler un peu — devant la pression qu’elle exerce avant de s’y atteler encore ; qui pour se libérer s’enferme dans un bunker où il ouvre de belles fenêtres avant de voir que décidément c’est un bunker et d’en sortir accablé d’avoir cru le contraire — ou de s’être forcé à le croire ; bref, un être qui s’implique dans tout ce qu’il fait et se cache dans tout ce qu’il fait. (Comment ne pas entendre qu’en parlant d’Hamlet qui veut rencontrer son spectre, son père mort, c’est à lui-même qu’il pense en disant : « Je lui parlerai : seule conversation véritable [avec le père}, profonde, espérée depuis longtemps, enfin advenue »). Et quoi d’autre que le père — que la lutte contre le père pour avoir un « vrai » père — quoi d’autre peut pousser un homme à s’enfermer dans le bunker d’un Parti en vue d’y trouver la vraie loi, cohérente, efficace, différente de ce que disait le père réel — anarchiste marginal et démuni — mais visant tout de même à donner corps aux idéaux de ce même père, idéaux de culture « élitaire pour tous » ?
Émouvante, la déclaration de Vitez en mars 90 sur « la fin du socialisme autoritaire », sur l’«effondrement », de l’«idée ». Surtout si on l’entend comme déclaration d’effondrement de soi, désiré et impossible sauf dans la mort. Voilà, l’idée est perdue, elle a volé en éclats, et l’homme qui y a cru de tout son être n’a pas envie d’éclater de rire pour jouir de cette perte, et jouir de se perdre pour se retrouver autrement. Il y a le deuil. Mais l’homme est fort et il décide de le surmonter en annonçant un changement de rôle : dorénavant « ce qui nous reste » c’est « le devoir de prophétie », au sens biblique, dit-il. Rôle de devoir ; mais la prophétie n’est pas vraiment un devoir, pas plus qu’il n’y a le devoir de désirer, sauf à remplacer le désir par ce devoir — devoir d’école, devoir d’église ou de parti. Et ce nouveau « devoir » veut dire pour lui : « sarcasmes, invective et prévision, critique des temps actuels, annonce » ; mais n’était-ce pas justement son rôle antérieur, de militant « critique » ? Ainsi dans le nouveau rôle c’est l’ancien rôle qui ressurgit, le rôle du militant, religieux ou plutôt ecclésial.
C’est cela qui m’émeut : jeter l’ancien rôle à la faveur du cataclysme, et endosser le nouveau rôle qui se révèle dans le même style que celui d’avant. Cela veut dire que ce rôle, toujours le même, a été aimé d’amour, qu’il a fait corps avec l’acteur qui Le joue ; mais que l’impératif de le changer, aussi fort que celui de changer le monde, reste intact, en suspens dans le monde intérieur de l’acteur qui implose. Émouvante, la fidélité inconsciente, involontaire, comme toutes les grandes fidélités ; comme les emprises de l’origine, dont on ne peut pas se défaire sauf à vouloir le cataclysme intérieur qu’exige cette défaite. Comment n’être pas ému de voir le nouveau militant, le « prophète » , se forçant aux idées pour lui nouvelles concernant la société, mais ne pouvant les formuler que dans le moule dont il ne peut se séparer ?Par exemple, il s’enhardit jusqu’à dire que l’ordre actuel, décidément, « exige qu’il y ait des riches et des pauvres ». Et il ajoute : « afin que la tension augmente et que tourne la machine sociale ». Il lui faut rationaliser comme avant, comme s’il le fallait toujours pour conjurer l’irrationnel. Le fossé entre riches et pauvres, lui, n’a jamais eu besoin d’un argument social ou global pour exister ; nulle part il n’a jamais amorcé sa disparition. De même Vitez fait l’effort d’accepter le « capitalisme » comme étant dorénavant « le fonctionnement naturel de la société, en ce moment-ci de l’histoire »; comme s’il y avait jamais eu un fonctionnement « naturel » de l’homme ou du social. Mais la précision « en ce moment-ci de l’histoire » reste un délicieux rappel du matérialisme historique.
Donc, déclaration de changement d’où émerge la sensation que ce changement est impossible pour celui qui s’y résigne. Comme si une fois branché sur la loi idéale on ne pouvait plus s’en décoller malgré les efforts de pensée « objective ». Car cette loi idéale est celle du père manquant — et toujours il s’agit de sauver le père : c’est la hantise de ceux qui prennent parti pour son image idéale et croient devoir se sacrifier à son emprise.
Il dit aussi que : « les superstitions et les religions ayant pris la place des idéologies, nous voici dans la confusion ». Il était bien trop fidèle à lui-même, à son personnage, pour voir que les idéologies étaient parfois des religions et que les religions ne se réduisent pas aux superstitions mais ont aussi la fonction de gérer un rapport à l’origine. Et puis, ce rapport à l’origine est peut-être du même ordre que ce qu’il a dû lui-même gérer grâce à l’idéologie.
À croire que pour chacun de nous l’intelligence « objective » ne suffit pas dans Le cataclysme ; où peut s’ouvrir un ressourcement radical dans l’épreuve de l’origine. Faute de quoi chacun est réduit à dénoncer ce qui lui ressemble et qui réveille en lui des menaces intimes et réelles. Or Vitez fut un grand dénonciateur de la bêtise. Mais combattre la bêtise fait courir de gros risques ; non pas le risque d’échouer — l’échec est garanti — mais le risque de s’enfermer dans son idée, de s’arrondir dans son combat, comme un hérisson ; de tellement se fasciner sur l’idée vraie qu’elle en vient à fausser le reste, à se fausser elle-même ; et qu’on devient — ça arrive à tout un chacun — un peu bête en toute intelligence.
LA DERNIERE mise en scène d'Antoine Vitez LA VIE DE GALILÉE de Brecht à la Comédie Française, le seul théâtre…