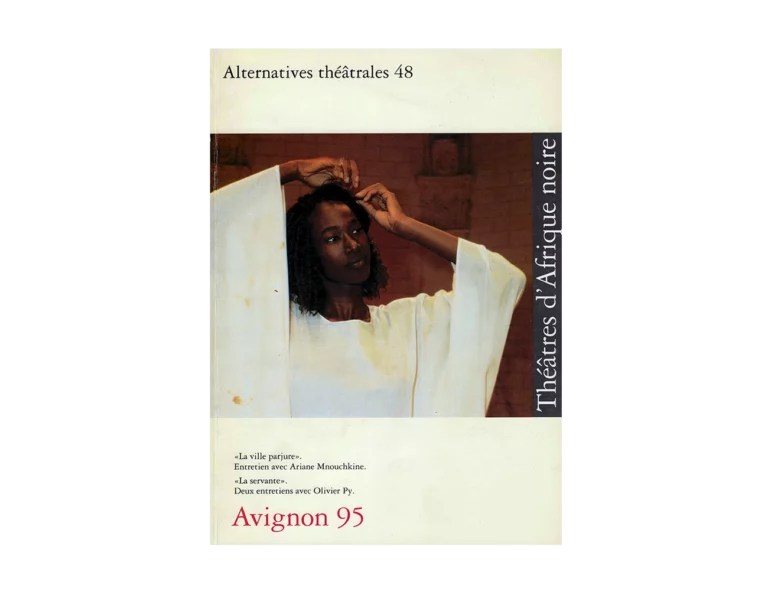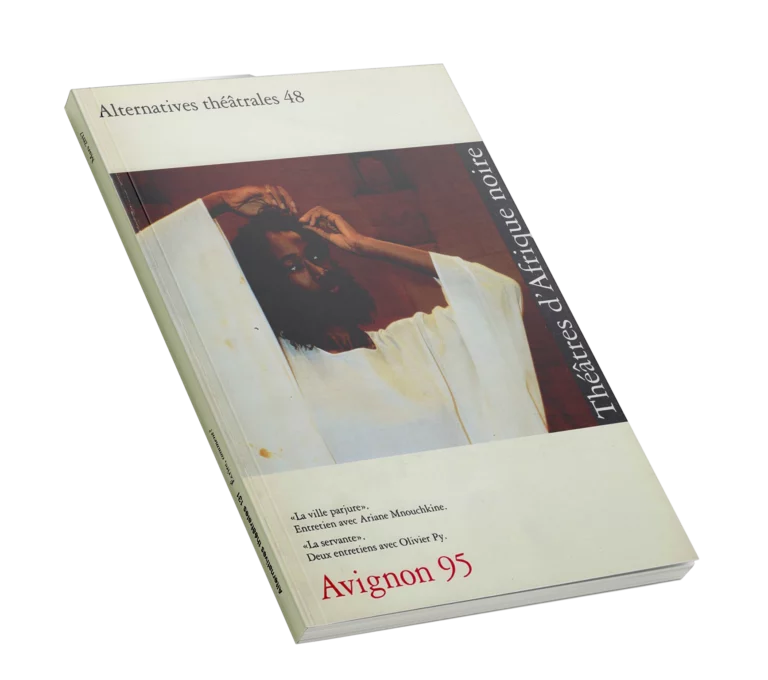« IL Y A EU à un moment donné une fausse couche. Il « faut en parler, elle est à l’image du monde. Au début des années 60, pour les plus concernés d’entre nous, nous nous retrouvions en Lumumba, parce qu’il était celui qui disait que nous avions autre chose à offrir au monde que des grimaces et que notre douleur nous rachetait le droit d’être des hommes libres dans ce monde. Nous sommes des porteurs de liberté et si, maintenant, elle est confisquée par ce pouvoir concentrationnaire dont je parle, ce sont des phénomènes qui ne pourront pas survivre parce qu’on ne peut pas confisquer l’histoire d’un peuple. »
Sony Labon Tansi (Entretien avec Tchicaya U Tam’Si, in « Antipodes », France Culture)
La réflexion de Sony Labou Tansi citée ci-dessus pourrait servir de base à une analyse du théâtre africain car celui-ci a toujours été, d’une manière ou d’une autre, quête de liberté et réponse à l’oppression, qu’elle soit coloniale ou dictatoriale. Vecteur des illusions et des rêves, le théâtre fut d’abord affirmation de soi, affirmation d’une dignité et expression d’un vécu tragique. En un sens, c’est là que la grande fragilité de cet art demeure. En effet, pour Roland Barthes, « écrire, jouer, c’est assumer une responsabilité et cette responsabilité désigne une liberté, mais cette liberté n’a pas les mêmes limites selon les différents moments de l’histoire. Il n’est pas donné à l’écrivain de choisir son écriture dans une sorte d’arsenal intemporel des formes littéraires. C’est sous la pression de l’histoire et de la tradition que s’établissent les écritures possibles d’un écrivain donné ».
Cet article ne reviendra pas sur les formes traditionnelles de spectacle qui ont existé dans chaque société africaine. Elles ont existé, perdurent et sont profondément enracinées dans les cultures, les mémoires et les inconscients. Le point de départ choisi ici sera le traumatisme primordial de la colonisation qui, sous sa forme assimilationniste, a essayé de faire table rase du passé des pays conquis.
Et de fait, l’idéologie coloniale a profondément marqué la genèse du théâtre africain. En effet, sous sa forme occidentale du moins, il y est récent, il a été apporté de l’extérieur, désigné comme « modèle », et pendant longtemps, il fut ignorant des formes locales de culture et de spectacle. Logiquement son apport sur Le continent était destiné à créer des griots de service qui, de par leur « culture » seraient un modèle identificatoire idéal pour la transmission et la pérennisation des schémas de domination.
Et c’est sur les bancs de l’Université française que la première génération d’intellectuels négro-africains se sont rencontrés. Là, ils ont appris leurs classiques. Il fallait connaître le répertoire français, parler la « belle langue », écrire comme Racine et citer ANDROMAQUE. Dominer la culture française, la posséder et donc la transmettre de manière impeccable. Une culture « négréco-romaine » aurait pu voir le jour… Or, dès le début, écrire a été avant tout revendiquer une identité. Les écrivains se sont engouffrés dans les brèches des paradoxes coloniaux. On les attendait blanchis, ils se sont définis noirs. Ils ont forgé leurs premières armes avec des revues comme l’Étudiant Noir. Aux mythes conquérants imposés par les colons et au dénigrement de l’image de soi véhiculés depuis près de trois siècles, les pionniers de l’écriture africaine ont répondu par une redéfinition des termes de la création et ce à une époque, pas si lointaine, où « Y a bon Banania » fut créé, pour faire sourire.
Les premières pièces écrites ont parlé du passé, recréé une Histoire de l’Afrique, résisté à l’assimilation. Et ce qui est extraordinaire dans ce théâtre-là, c’est que dès le début, la recherche fut commune entre les comédiens, les metteurs en scène et les dramaturges. Faire du théâtre procède de la quête et les rôles ne sont pas rigidifiés. Il y a une création commune, une lutte à instaurer, une liberté à défendre. Et les pièces mêleront harmonieusement chant, danse, costumes, tradition. Les schémas académiques devront s’adapter. Les auteurs qui, ne l’oublions pas, dans ces époques-là étudiaient latin, grec et culture française, effectuent des recherches sur les mythes, les légendes, retrouvent la culture des pères que d’aucuns veulent mettre en veilleuse, les évoquent, imposent tout ce qui était refusé et d’abord la culture « indigène ».
En effet, destinés à devenir une élite, bons élèves formés à prendre la relève des dirigeants coloniaux sans poser de questions, les auteurs, les metteurs en scène, les dramaturges dévient du chemin indiqué, placent euxmêmes les cailloux qui feront grincer la machine. Car parler du continent noir, de son histoire, de sa culture, c’est aussi se trouver face à l’occultation d’une mémoire, c’est tomber sur des zones de silence. Et elles sont nombreuses. Dans la mémoire collective négro-africaine, le temps des travaux forcés, des guerres occultes, des victimes cachées, des frontières reniées est encore vivace. Pour paraphraser Michel Serres : « Yeux fermés, oreilles bouchées, pieds et poings liés, lèvres closes. dans tel sous-bois. au coucher du soleil, hurlent les cris de l’oncle torturé, du grand-père assassiné, du cousin disparu » et reviennent, dans la conscience, les termes : sauvages, arriérés ou plus récemment sous-développés, acculturés… Face à cela, toute arme est bonne à prendre et le théâtre en est une. Les auteurs deviendront des chantres de la zone interdite et les comédiens les hérauts.
Mais, à peine cette définition donnée, le combat se situe ailleurs : dans et directement dans le politique. Le théâtre de Bernard Dadié en est un très bon exemple, lui qui représente l’entrée dans la modernité. En effet que ce soit dans MONSIEUR THÔGO-GNINI, LES VOIX DANS LE VENT ou BÉATRICE DU CONGO, il pose la problématique du choix de culture et de société pour l’Afrique. Et dans une structure dramatique autre que celle du théâtre gréco-latin. Cassandre particulièrement lucide, il pose le problème africain dans un contexte politico-économique plus global. Avant les grands débats sur les démarrages ou non-démarrages de l’Afrique, il anticipe les dégâts à venir. Les personnages qu’il met en scène incarnent les archétypes des protagonistes du malheur en couts : auxiliaires d’un pouvoir inféodé aux grandes puissances, techniciens et conseillers spécialistes en dépersonnalisation de l’autre, monarques à la limite de la caricature. Le discours est militant. Dadié se trouve face à l’émergence d’un mode de vie et d’une classe sociale dépendants de l’Occident et combattre ce phénomène devient chez lui une obsession. « Quelle politique serait politique qui ne serait pas leur politique », fait-il dire à Dessalines dans ÎLES DES TEMPÊTES. À quoi répond Toussaint Louverture : « Notre malheur est d’avoir trop d’amis pour aimer ce pays sans savoir comment nous aimer ». Reflet d’une époque ? Sûrement. Les années 70 sont encore celles de l’espoir. Les révolutions se font sur l’air des lendemains qui chantent. L’engagement artistique se fait sur le mode de la dénonciation des ignominies et des injustices, crier pour mieux se faire entendre et inverser le cours des choses. Les gens de théâtre deviennent ingénieux, contournent toutes Les censures, sont présents devant toutes les urgences.