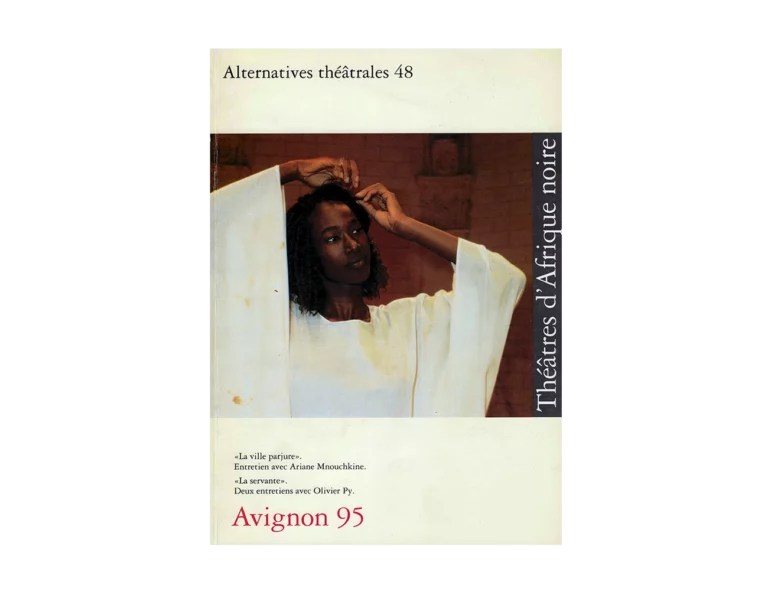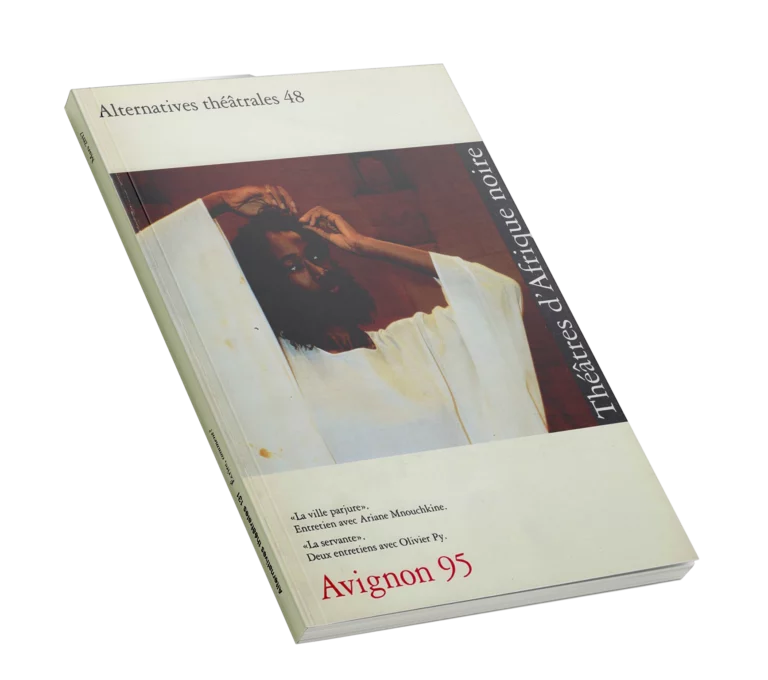Aborder l’œuvre du dramaturge zaïrois Mikanza, c’est aborder une réalité fondamentale du théâtre africain : son implication dans la réalité sociale et politique, son rôle « d’éveilleur des consciences » et sa fonction pédagogique. Les quatre pièces analysées ici correspondent à quatre moments de l’histoire du Zaïre sous Mobutu.
AU ZAÏRE, la « mutation » des indépendances a redonné une place privilégiée au théâtre, moyen d’expression et de communication plus immédiat que l’écrit, et plus accordé à la tradition orale et gestuelle des cultures africaines.
Pendant la colonisation belge, la tradition orale noire était entrée en conflit avec l’écriture et la langue française, et cela au détriment de l’énorme bagage culturel qui s’exprimait jusque-là dans les rites, les fêtes, les fétiches, les masques. D’autant que les Congolais de l’époque coloniale ne pouvaient jouir, en tant que théâtre officiel, que d’une dramaturgie essentiellement francophone, de tradition occidentale didactique religieuse. Reste que, dans ce contexte, et dans les quinze dernières années du régime colonial, on voit surgir un homme de théâtre polymorphe, Albert Mongita, sans lequel une bonne part du théâtre zaïrois contemporain ne s’expliquerait pas.
Avec l’indépendance politique explose peu à peu plus nettement un théâtre qui recommence à faire couler du sang zaïrois dans ses veines.
Parmi les personnalités qui prennent en charge cette mission : Norbert Mobyem Mikanza1. Intellectuel polyédrique et engagé, Mikanza constitue un excellent repère de l’évolution théâtrale de son pays. Ses spectacles parcourent en effet toutes les étapes de l’aventure sociopolitique et culturelle du Zaïre.
Avec Mikanza, la métaphore théâtrale entend exprimer les conflits et les contradictions de la génération pleine d’enthousiasme qui passa du régime colonial à celui du président Mobutu. Celui-ci entendait se servir de la scène pour mobiliser le citoyen. Aussi, le nouveau gouvernement zaïrois crée-t-il un Théâtre National dont Mikanza deviendra le directeur.
En 1969, sur une idée du Ministre de la Culture, Paul Mushiete, Mikanza met en scène PAS DE FEU POUR LES ANTILOPES2 , pièce en trois actes et un intermède, qui invite à la sauvegarde de la terre, de la flore, et au travail des champs.3
Pas d’unité de temps (l’histoire se déroule en plusieurs jours), ni de lieu (il y a deux villages et un troisième endroit « neutre » ), ni d’action (chaque village a sa chronique). Une forme de reprise de la tradition zaïroise et des rythmes séculaires qui ponctuent sa vie.
Le premier acte nous présente le chef, Manga, bon vivant, insouciant du futur, conscient de sa position sociale, mais peu soucieux de ses responsabilités face aux problèmes de famine et de misère de son village. Manga s’obstine à poursuivre une tradition — le feu de brousse — désormais dépassée et nuisible. En réalité, ce chef se laisse complètement entraîner par les coutumes de ses aïeux. C’est pourquoi, il se confie à son sorcier Dititi, qui devient le détenteur d’un système de contre-pouvoir très fort. Dititi est l’intermédiaire entre les hommes et les divinités surnaturelles :
« DITITI : Chef Manga, les esprits et nos ancêtres t’accordent force et santé. Sages notables de Kipwala, ma bénédiction repose sur vous.
CHEF : Salut Grand Sorcier Dititi, initié au secret dialogue avec nos pères. » (p. 10)
Comme son chef, Dititi est le témoin de la tradition. Avec lui, le texte se plaît à alterner proverbes et images typiques :
« MANGA : LE chien a quatre pattes, mais il ne peut suivre qu’un seul chemin.
DITITI : Ainsi parlait la sagesse par la bouche des anciens. » (p. 14)
Si Manga apparaît comme un roi assez naïf, obstinément rivé aux œillères de la tradition du feu de brousse, Dititi n’est pas un sorcier « classique » : il est — et veut être — le trait d’union entre les morts et les vivants, mais il n’est pas à proprement parler magique ou maléfique. Il est une arme dont se sert le dramaturge pour diffuser son message. Instrument fonctionnel aux traits ludiques, il rappelle le « fool » shakespearien qui se permet de tout dire, même contre la tradition. En ce sens, il est paradoxal, et, comme l’écrit Le dramaturge et critique À.B. Latere à ce propos : « La dernière contradiction qui apparaît aux yeux du critique, et peutêtre à ceux du spectateur, c’est lorsque le sorcier qui s’est présenté comme le défenseur de la coutume pour éviter la colère des ancêtres, s’oppose, paradoxalement, au traditionnel feu de brousse au nom de l’avenir. »4
Dititi fait cohabiter un côté « tradition » et un côté « modernité » tout en diffusant plutôt le parfum triomphant de ce dernier. Ce comportement « progressiste » rejoint le projet des fabricants du nouveau Zaïre. Ils se servent de lui pour arrondir les vieux angles au nom de l’amélioration sociale. Il est d’ailleurs patronné par l’équipe qui challengera Manga et les siens dans le match opposant traditionalistes et modernes.
Ces derniers entrent sur le terrain au deuxième acte. Ils sont commandés par leur chef Mukoko. À la différence de Manga, Mukoko est « dynamique », pragmatique. Il est aussi préoccupé par le futur :
« Ce qui compte, ce n’est pas d’en finir avec la faim que l’on a aujourd’hui, mais aussi de prévoir celle plus âpre peut-être qui nous tenaillera demain. » (p. 36)
Musongi, le sorcier de Mukoko n’a pas le même poids que Dititi. Il n’est somme toute « qu’un écho de ce dernier ; mais un écho faible »5. En tant que figure traditionnelle, il est toutefois l’intermédiaire des aïeux : « Ancêtres de Benga qui habitez à présent le pays heureux de l’au-delà, nous vous saluons. Vous nous avez vus tantôt rassemblés pour étudier ce qu’il faut faire pour le bonheur de notre village. Nous avons sauvegardé la coutume telle que vous nous l’avez léguée. Nous voulons que la saison des chasses et des marchés qui commence, nous soit favorable. Si vous êtes fâchés contre nous, apaisez votre colère. Voici un coq blanc que nous vous immolons. (…) Voici de ce vin que vous aimiez pour étancher votre soif. » (p. 38)
Au troisième acte, au moment où la tension amusée, voire euphorique, du spectacle atteint son acmé (avec la « guerre des danses » entre les deux chefs), il y a convergence comportementale des deux sorciers (Dititi et Musongi invoquent la force de leurs ancêtres pour vaincre l’ennemi). Mais, il y a un seul gagnant : Mukoko qui impose la disparition du feu de brousse pour les deux villages. De cette victoire du progrès, Latere donne l’interprétation suivante : « Deux interprétations nous paraissent plausibles : où Mukoko triomphe par la force des ancêtres qui sont intervenus à la suite de l’infusion opérée par Musongi ;ou il n’y a eu aucune intervention des puissances surnaturelles. La force des circonstances jouerait dans Le second cas, surtout que Manga doit être miné par la famine qui sévit dans son village. »6
En dramaturge subtil et en politique avisé, Mikanza a laissé la question ouverte. Il contente les adeptes et Les négateurs de la tradition, et il réalise surtout la fonction référentielle de sa pièce. Pour le dramaturge et le régime politique, l’important est alors de promouvoir la croissance de la société zaïroise et d’éliminer une série de mœurs ancestrales qui font obstacle à la modernisation. C’est l’époque où le régime du président Mobutu accélère la « zaïrianisation » des biens et espère favoriser la relance de l’agriculture et de la métallurgie.
1977 voit naître une autre pièce : PROCÈS À MAKALA7. Aux espaces en plein air de PAS DE FEU POUR LES ANTILOPES, se substitue un endroit clos : la prison. En lieu et place des personnages traditionnels (chefs, sorciers, notables, villageois), des types « urbains » (l’assassin, la femme, Le voleur, le garçon). À la différence de PAS DE FEU…, où le message didactique était caché sous la drôlerie et la fête assourdissante des personnages, ici, la volonté pédagogique se rend visible tout au long de la pièce. On la retrouve explicitée dans le résumé de la pièce qu’en donne l’auteur lui-même :
« Dans la prison de Makala, la conversation entre trois prisonniers est brutalement interrompue par l’arrivée d’un jeune détenu de quinze ans environ. Le nouveau venu pleure à fendre l’âme : il se dit innocent. Alors que la Femme prisonnière, émue, voudrait consoler le jeune homme, les deux autres, c’est-à-dire le Voleur et l’Assassin, lancent des quolibets avant d’être gagnés à leur tour par la pitié. C’est ainsi que les trois prisonniers en arrivent à reconnaître leur responsabilité dans la conduite des jeunes dans la société. La prison se transforme alors en tribunal devant lequel Les trois adultes vont dérouler le film de leur vie antérieure, qui justifie leur présence derrière les barreaux. (…) Ce procès dans la prison se transforme en un procès de la société. (…) Hélas, la société est souvent injuste à l’égard des innocents : ceux-là mêmes qui viennent de reconnaître leur responsabilité dans la détention du Garçon bénéficient d’une mesure de grâce. Le scandalisé demeure en prison. Toutefois, le procès de Makala aura servi à quelque chose : les trois adultes libérés s’en vont le cœur lourd et la conscience pleine de bonnes résolutions. »8
La pièce s’est moulée dans des formes occidentales avérées. Mikanza réintègre en effet le système des trois unités. Un seul lieu, la prison, qui contient les sousensembles des flash-back imaginaires. Le temps est au présent. Un présent à double épaisseur — réelle et scénique — avec de sporadiques « sauts d’écrevisse ». L’action, enfin, concerne le moment du repentir dans une situation de punition — ce qui implique en même temps de vieilles causes (le mauvais comportement) et de nouveaux buts (les bonnes résolutions pour le futur) .
Tout cela se déroule devant les yeux du lecteur/spectateur au travers de personnages à dimension religieuse — là aussi d’origine « occidentale » — puisque le garçon condamné injustement est une sorte de Christ.
« LE GARÇON : Non, je ne veux pas. Non, non, c’est injuste. Sortez-moi d’ici. Non, oh ma pauvre maman, viens au secours de ton pauvre enfant. Je suis innocent. Qu’ai-je fait ?C’est injuste ! oh non ! » (p. 18)
On y trouve aussi les deux larrons de l’Écriture. Le mauvais prend les traits de l’Assassin et du Voleur. Le bon larron, par contre, est incarné par le personnage de la Femme qui s’émeut à la vue d’un si jeune garçon dans une prison :
« Comment pouvez-vous avoir le cœur aussi dur ? Comment pouvez-vous être insensibles à la douleur de ce garçon ? » (p. 20)
L’atmosphère christique est foncière. Au moment où le jeune garçon avoue qu’il fait partie d’une organisation de hors-la-loi commandée par un chef, le Voleur bascule dans le repentir : « debout et raide », il bégaye un « c’est … c’est moi ». Il n’est pas le vrai coupable, mais « c’est tout comme ». (p. 22)
Au fur et à mesure que le Garçon raconte son histoire digne de commisération (il appartient à une famille trop nombreuse, sa mère est morte, son père ne s’acquitte pas de ses devoirs), les deux hommes voient s’effriter peu à peu leur dureté, tandis que la Femme, qui était déjà initiée à la pitié, nous amène pour un instant dans ces feuilletons américains des années’50 où les personnages féminins pleurnichent sans fin alors que les héros masculins jouent les « durs ».