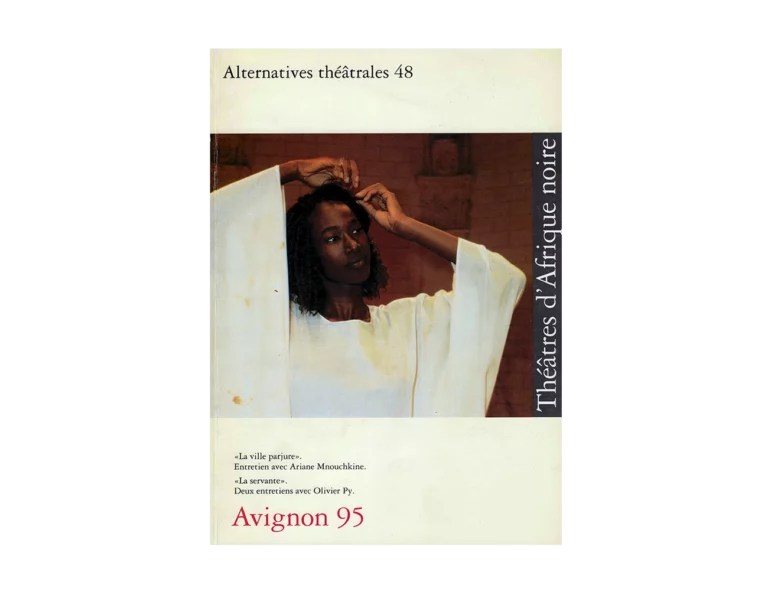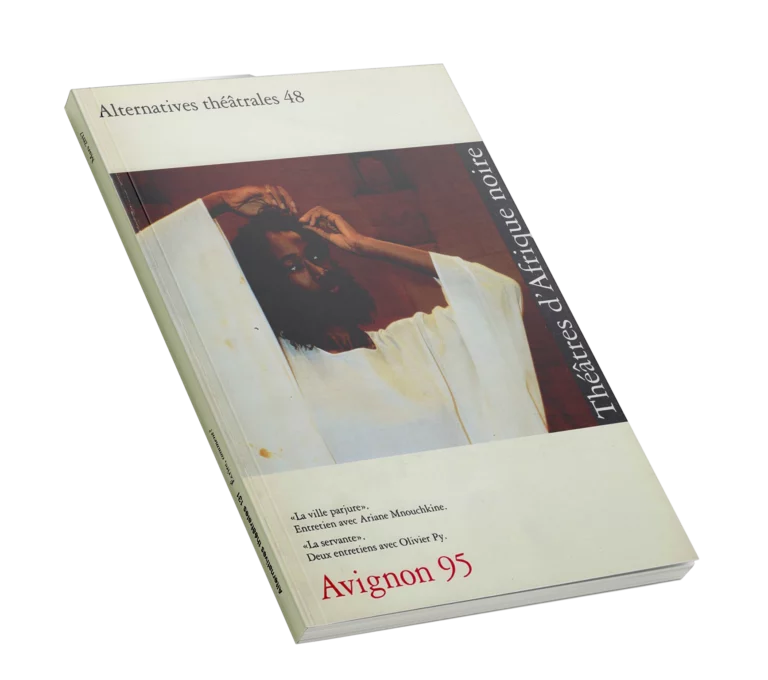TRENTE ANS de théâtre, acteur, metteur en scène, cinéaste, producteur, à cheval sur plusieurs pays et continents, Sidiki Bakaba a participé à toute l’histoire du théâtre africain contemporain. Formé aux pièces classiques qu’il a jouées au pays, au départ, avec un détour du côté des arts de la rue et de Grotowski, ce pionnier a vu toutes les évolutions contemporaines et a toujours tenu un rôle primordial.
« Ce métier, je l’ai inventé, avait-il expliqué dans une interview donnée au journal « Libération », inventé comme un petit prêtre qui est né avec, qui doit le créer avec ses rites. Chez nous, il y avait une tradition orale, celle des griots, mais pas de textes. Quand j’ai commencé à jouer, je n’avais jamais vu de théâtre, je n’avais jamais vu de pièces, les professeurs nous faisaient écouter des disques, mais je ne peux pas dire qu’un acteur m’ait donné envie de jouer, le théâtre m’a choisi, alors qu’il m’était inconnu, qu’il n’existait pas. »
Cette expérience de créer un métier avec un imaginaire qui pallie tous les manques, il la partage avec nombre d’artistes africains. Les fondements mêmes du métier, on les découvre sur le terrain. Pour Sidiki Bakaba, la naissance a dû avoir lieu du côté des boy-scouts avec lesquels il découvre la joie des feux de camps et des saynètes. La renaissance a lieu aux côtés de Bernard Dadié avec la pièce MONSIEUR THÔGÔ-GNINI.
« Dadié a été pour nous un tournant, dit-il. Au Théâtre National de Côte d’Ivoire, nous jouions alors Les classiques. C’était passionnant. Mais avec Bernard Dadié, ce fut autre chose. Nous parlions de nous. Nous avons quasiment créé MONSIEUR T’HÔGG-GNINI avec lui. Ce fut l’expérience de la création collective, l’auteur était là, avec nous, adaptait son texte au fur et à mesure et nous assistions à la genèse de cette pièce.Il y a eu alors un tournant décisif, ajoute l’acteur, nous avons compris ce qu’est un aft vivant. »
Ils partent à travers l’Afrique avec cette pièce et ce voyage ouvre toutes les perspectives. Au-delà de la Côte d’Ivoire, Sidiki Bakaba, à l’instar de nombreux jeunes gens de sa génération, se découvre africain. C’est effectivement la période de la post-indépendance, celle des rêves panafricains, de la conscience qui s’éveille à une histoire commune, à un avenir commun.
« Après MONSIEUR THÔGÔ-GNINI, nous avons continué à faire du théâtre classique, poursuit-il, mais surtout, nous avons pratiqué Le théâtre de rue. Et c’est là que l’enseignement fut le plus fructueux. On prenait des extraits de pièces classiques et même des farces du Moyen-Âge et on allait les jouer dans les quartiers populaires, dans les petits villages alentour d’Abidjan, devant les parvis des petites églises, à la lueur des lampes Petromax. Il nous fallait alors nous adapter constamment au public et adapter le texte. Il est évident que nous ne trahissions pas Molière, mais on y apportait des exclamations, des tournures africaines, un travail du corps pour que le public, pas obligatoirement francophone, puisse comprendre les vers. Pour faire passer le texte, nous étions obligés d’utiliser un jeu qui nous soit propre. Et même nous fûmes obligés de nous adapter à la conception de la scène du public. L’enseignement en art dramatique que nous avions reçu au Conservatoire était conçu comme celui qui se faisait en France : salle avec une scène, projecteurs et public dans la salle. Là, sur les terrains vagues, c’était autre chose. On essayait de tracer une délimitation, mais le public nous entourait, nous encerclait. Il fallait travailler avec ce mouvement circulaire. Nous trouvions cela insupportable et nous avions honte de ce public, mais quelle ne fut pas notre surprise de voir que tout cela que nous rejetions était en fait le sujet de recherche du théâtre européen de cette époque-là.. »
Sidiki Bakaba se jette dans cette recherche. Sa quête le mène à l’Université Internationale du Théâtre à Paris, au Living Theatre, chez Grotowski. Il joue, entre autres, BÉATRICE DU CONGO de Bernard Dadié au Festival d’Avignon sous la direction de Jean Marie-Serreau, LULU dans la mise en scène de Claude Régy, avec Jeanne Moreau, LA DÉPOSSESSION de Seydou Bokoum au Festival mondial des arts nègres à Lagos, COMBAT DE NÈGRES ET DE CHIENS avec Patrice Chéreau à Nanterre, etc. Et saisit en profondeur les problèmes de déphasages et de diglossie que les comédiens africains doivent affronter.
« Il est évident, dit-il, qu’à partir du moment où on est dans une école d’art dramatique, on va apprendre en français, travailler sur les méthodes de diction française. Mais l’acteur qui ne fait pas un travail sur lui-même, qui ne retourne pas vers Les sources de ses premiers émois, et ceux-ci sont dans sa langue maternelle, cet acteur-là sera excellent techniquement, mais il ne pourra apporter aucune émotion, et ne pourra pas convaincre quand il va se trouver devant son public. » « Je me suis aperçu, ajoute Sidiki Bakaba, que beaucoup de comédiens africains qui avaient reçu une excellente formation, régressaient sur le terrain. En fait, je crois que c’est parce qu’ils ont un blocage. Ils ne peuvent pas faire passer les nuances du texte parce qu’ils ne l’ont pas fait au préalable dans leur langue. Quand je donne une formation, souvent je dis : travaille-le dans ta langue, vis-le dans ta langue d’abord.Et cela, j’ai pu l’expérimenter parce que j’ai eu la chance d’arriver en France à une époque où les recherches concernaient ce domaine. On demandait alors à l’acteur de faire vibrer ses cordes, les mots étaient des coups de poing. »
« Aujourd’hui, le théâtre africain va beaucoup mieux, dit-il, après un moment d’hésitation. Il y a beaucoup de textes qui sont écrits. Les metteurs en scène ont le choix. Les auteurs eux aussi ont suivi les évolutions du théâtre, de la conception scénique, maintenant, les pièces qui sont écrites peuvent être jouées n’importe où, ne sont plus ptisonnières du théâtre à l’italienne. »
À un moment donné, dans l’interview, il a encore dit ceci : « Un des plus beaux rôles que j’ai joués, c’est celui d’un soldat revenu de la guerre, dans LE CAMP DE T’HIAROYE, de Sembène Ousmane. Cet homme-là a vécu les camps de concentration, la mort. On l’a mutilé de sa langue. Il est muet, personne ne sait d’où il vient. Mais il est là, il est présent, par son regard, par son silence. Et tout le monde l’appelle « mon pays ».
D’après un entretien réalisé en mars 1995.