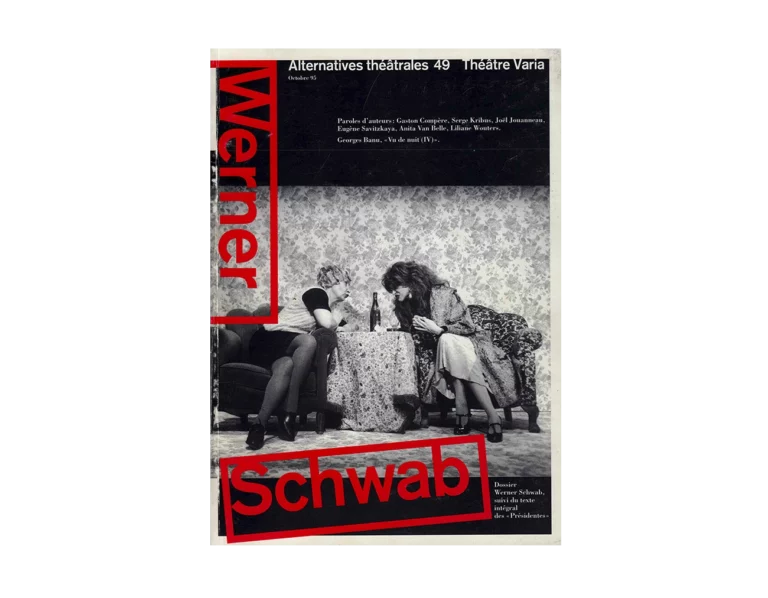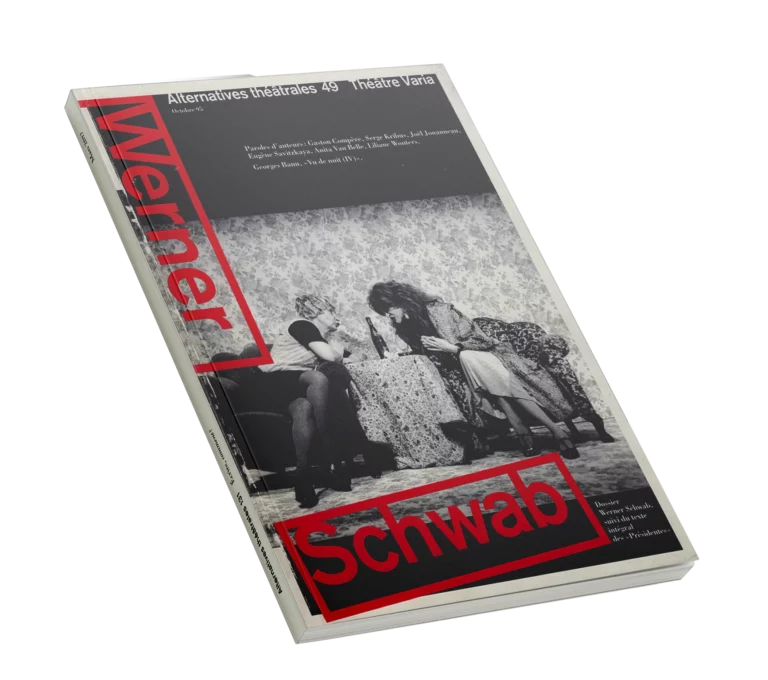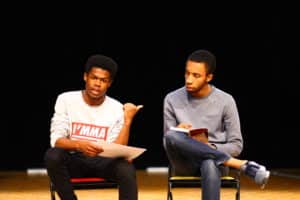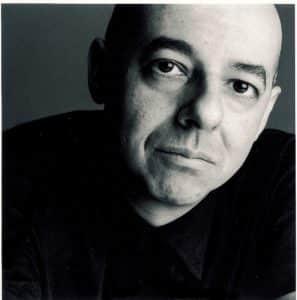PIETRO PlZZUTI : Devant la page blanche, qu’est-ce qui a fait que vous écriviez pour le théâtre ? Quelles sont les images de votre théâtre ?
Liliane Wouters : Les personnages. C’est toujours par eux que cela commence. Des personnages que je visualise, dont j’ai une perception très physique et qu’il faut que je nomme.
A l’origine, il y a eu Claude Etienne1, c’était en 1963. Il m’a envoyé une lettre dans laquelle il me demandait de lui écrire une pièce. J’ai été extrêmement surprise· je ne le connaissais pas personnellement, il ne savait pas si j’étais capable d’aligner deux répliques et il me demandait une pièce ! En fait, depuis très longtemps, je pensais au théâtre, je faisais même plus qu’y penser, j’avais des débuts de pièces dans mes tiroirs, j’avais écrit de courtes comédies à l’école, vers treize quatorze ans, et elles avaient été jouées lors de fêtes scolaires. Mais, curieusement, je n’osais pas me lancer « pour de bon » dans l’écriture dramatique. On peut dire que Claude Etienne a été un catalyseur. Je lui ai répondu affirmativement et je l’ai rencontré. J’ai compris alors pourquoi il avait confiance : « Il y a des personnages dans vos poèmes ». C’était vrai, ça ne l’est plus guère aujourd’hui, sans doute parce que je les conduis immédiatement dans leur lieu naturel : à la scène.
Vous voyez que les personnages étaient déjà le moteur de l’action dramatique, ils le sont toujours. Même précédés de quelque thème, de quelque vague, très vague idée, eux seuls donnent corps à la pièce.
P. P.: S’agit-il d’un théâtre de poète ?
L. W.: Oui et non. Prenez LA SALLE DES PROFS, elle n’a rien de poétique. Là, c’est d’abord le thème qui m’a tentée, l’envie d’écrire une pièce sur les enseignants. Il me fallait un lieu unique, j’ai immédiatement pensé à la salle où ils se réunissent, boivent du café, corrigent des copies, etc. Ce n’est qu’à ce stade que j’ai pensé aux personnages. J’ai cherché des types très courants, j’en ai fait des amalgames, j’ai dressé leur carte d’identité, il ne s’agissait pas de rêver mais de serrer de près ce que j’avais vu.
J’ai parlé de perception physique. Il faut que celle-ci soit très forte, que je voie les personnages et aussi : que j’entende comment ils parlent. C’est à la fois visuel et auditif. Et pour que leur présence s’impose, il est urgent de les nommer. On ne dira jamais assez le rôle du nom. Regardez autour de vous : les gens qui s’intéressent vraiment aux êtres demandent toujours leur nom. Avoir un nom, c’est exister. Dans les camps, les prisonniers n’étaient plus que des numéros.
Dans mon théâtre, il existe un lien entre le nom et l’aspect physique. Je ne conçois pas l’un sans l’autre. Prenez L’ÉQUATEUR. Vous y trouvez un capitaine de bateau très matérialiste, un bon vivant, qui ne se pose pas trop de questions, un sanguin qui pompe l’air autour de lui, il lui fallait un nom tout rond mais dur. D’instinct, j’ai choisi « Budoc ». Réflexion faite, au plan de la technique poétique, cela donne une rime masculine. Et les rimes masculines de ce type ont un impact plus fort que les rimes féminines, même dans des noms masculins. Prenez Octave, Alceste ou Clitandre et comparez.
Parfois, je suis influencée par une symbolique, des références. La femme de Budoc s’appelle Hildegarde à cause d’Hildegarde de Bingen, grande mystique rhénane. Il y a, d’une part, l’eau – ici le Rhin –, d’autre part le côté religieux, prophétique. Dans la pièce, Hildegarde a des crises pendant lesquelles elle parle en vers et prédit l’avenir. D’où la référence.
Dans L’ÉQUATEUR, la symholique est d’ailleurs omniprésente. La pièce se passe en mer et, d’une part, tous les noms ont un rapport avec l’eau, d’autre part, ils ont leur signification propre. J’ai déjà parlé d’Hildegarde. Quant à Budoc, c’était un saint breton dont la légende dit qu’il voyagea dans un tonneau (Budoc, tout rond, le tonneau). Jonas, c’est le personnage biblique que la baleine avale au cours d’un naufrage. J’ai oublié l’origine de Nix,je sais seulement qu’elle a quelque chose à voir avec une divinité marine malfaisante. Ajoutez à cela qu’il est nihiliste et que le son « nix » ressemble au « niets » (rien) néerlandais, ou à son équivalent allemand : nichts. Lady Morgan, c’est un clin d’œil à la fée Morgane, fée bretonne, clone liée à l’océan…
P. P.: Une fois les personnages nommés, d’où naît leur dialogue ?
L. W.: Il s’établit très vite, intuitivement, ce n’est pas une démarche intellectuelle. J’ai remarqué que les débuts de scène ont souvent l’air de sortir d’un contexte, comme si je prenais la conversation au vol, en plein dans son cours. J’ai aussi remarqué que je participais physiquement à ces cüalogues, par un certain mimétisme.
P. P.: Vos personnages ont vos opinions ?
L. W.: Surtout pas, ils ont les leurs. Bien sûr que je leur donne une part plus ou moins grande de moi, c’est fatal, mais je peux aussi mettre en scène quelqu’un qui se trouve aux antipodes de ma nature. Cela permet de faire entendre des choses que l’on ne dirait – ne penserait – jamais.
Bien entendu, chaque personnage a une façon personnelle de s’exprimer, voire des manies, des tics. Dans LA SALLE DES PROFS, par exemple, Madame Firquet, l’institutrice popote, qui ne lit que des mémoires de vedettes, ne parle pas comme Mademoiselle Jaumain, capable de citer Oscar Wilde.
Une chose épouvantable, ce sont ces pièces visiblement bâties autour d’une idée (comme si le théâtre était une idée!), où tous les personnages s’expriment de la même façon, ce n’est pas possible, ça ne passe pas la rampe. Ce genre de théâtre est d’ailleurs souvent le fait d’intellectuels purs et durs. Il ne faut jamais oublier qu’avant d’être une œuvre littéraire, le théâtre est d’abord un spectacle.
P. P.: Avec ou sans rapport avec le réel ?
L. W.: C’est selon. Pour LA SALLE DES PROFS, j’ai dû travailler en plein réalisme. J’avais un matériau vécu important, je l’ai exploité. Tout en prenant distance. On me demande souvent si j’ai peint les personnages tels quels, si c’étaient mes collègues. « Avez-vous connu Monsieur Vandam ?» J’ai connu plusieurs Monsieur Vandam, c’est-à-dire des instituteurs de ce genre, ou du genre Firquet – ô combien ! – ou du genre Dini, mais aucun d’eux n’est inspiré par tel ou tel collègue. Chacun est une superposition de visages familiers, chacun représente un type précis – et courant – d’enseignant de l’école primaire. Je me suis beaucoup amusée en écrivant cette pièce. Comme je me suis beaucoup amusée en écrivant récemment une autre comédie intitulée MOHAMMED ET JULIETTE.
La plupart de mes pièces relèvent plutôt du genre poétique. Le symbolisme y a plus de poids que la réalité. EUes sont aussi moins construites. Ainsi VIES ET MORTS DE MADEMOISELLE SHAKESPEARE, pièce excessive, désespérée, fut écrite dans une période difficile de mon existence, j’avais beaucoup de choses à régler, j’ai abordé cette pièce comme une sorte de psychanalyse sauvage. Ça m’a fait du bien.