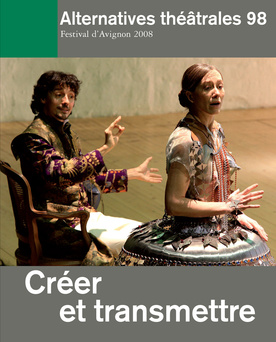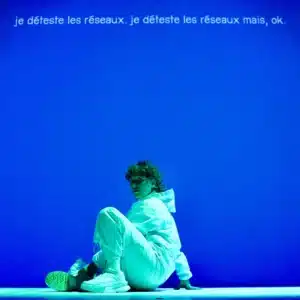Deux techniciens répandent successivement, à l’aide d’un tamis, une poudre blanche sur la surface des trois bassins rectangulaires qui s’offrent à nos yeux, l’un derrière l’autre, au début du spectacle ; puis ils disposent trois tuyaux plastiques par lesquels s’écoulera l’eau qui la dissoudra peu à peu. Ce sera la seule intervention humaine qui nous sera donnée à voir dans Stifters Dinge. Au fond, une masse encore comme sans relief se distingue : un collage de pianos, en tous sens, cordes à nu, d’où émergent comme d’une montagne des branches d’arbres. « Une œuvre pour piano sans pianiste mais avec cinq pianos, une pièce de théâtre sans acteur, une performance sans performer – un non one-man show ou peu importe la dénomination qu’on choisira »1 : installation ou composition pour pianos mécaniques, sons, eau, lumières et autres choses, Stifters Dinge (« Les choses de Stifter ») présente un paysage dont l’homme se serait absenté.
Paysage tout en profondeur et non panoramique, où le regard donne sur les trois petites étendues d’eau puis, comme sur un horizon, sur le massif chaotique de pianos auquel les variations lumineuses donneront relief, ou sur l’écran qui descend par moments devant lui pour diffuser la lumière, filtrer l’éclat d’un projecteur ou devenir surface de projections — d’une image (marais et bosquet sur un tableau du XVIIème siècle) ou des reflets de la lumière sur la surface de l’eau devant lui. Car ce qu’il y a à voir, dans cet espace sans homme et ce temps sans drame, ce sont les événements produits par de telles variations : des lignes géométriques qui se tracent ou un ballet de rectangles lumineux se déplaçant sur le sol, le jeu de la lumière sur les surfaces, un nuage de fumée s’élevant entre branches et pianos, une fine pluie qui tombe sur l’étendue lisse de l’eau, la lente dissolution de poudre dans des lacs miniatures – jusqu’au bouillonnement final de carboglace, comme autant d’îles et de geysers au milieu de mers immenses, se dissolvant jusqu’à ce que la surface de l’eau soit recouverte d’une couche blanche se défaisant alors en un progressif dégel. Une averse, de la neige, les formes dessinées par des soleils rasants ou tombant du zénith de la scène… Des variations climatiques. Le dispositif scénographique de Klaus Grünberg et la suite des séquences scéniques construites autour de lui instaure alors une temporalité qui n’est plus celle de l’activité de l’homme, mais celle d’un cours naturel.
Nulle action humaine, nul drame si ce n’est celui du regard, et de l’écoute, de l’attention aux sons, aux mouvements lumineux, et à leur articulation au temps : le temps qui les fait voir, l’autre temps qu’ils font percevoir. Se déploie ainsi, concentrée en une heure dix, la contemplation d’un monde en miniature où s’offrent à nos yeux les mille et une nuances d’un après-midi d’hiver (ou d’un hiver entier, on ne sait plus) : un paysage sans cesse changeant, à explorer (comme ces terres inconnues à découvrir, dont Levi-Strauss regrette la disparition dans un extrait d’entretien diffusé dans le spectacle) et face auquel il nous faut faire l’expérience d’un regard vierge.
Il nous faut voir, donc, percevoir les « choses ». Il nous faut aussi entendre, la composition musicale de Goebbels : piano, voix humaines et chants « primitifs » de Papouasie, de Colombie ou de Grèce, mais aussi les sons produits par les cordes frottées ou tapées, par de l’air projeté dans de longs tubes, les craquements ou les frottements d’une matière sur une autre matière. Il nous faut aussi voir-entendre : le deuxième mouvement du concerto italien en fa majeur2 de Bach joué, tandis que tombe l’averse, par un piano mécanique, les touches précisément éclairées mues sans doigts pour les actionner ; l’avancée vers la face du bloc de pianos, jouant tous ensemble comme une machine folle, comiques, menaçants, impressionnants. Il nous faut entendre-voir, enfin : la stupéfiante description, extraite des Carnets de mon arrière grand-père d’Adalbert Stifter, dont la lecture est diffusée durant une séquence du spectacle : celle d’un paysage, en lisière d’une forêt, entièrement pris par le givre, pétrifié-vitrifié, traversé de craquements et de bruits sourds – ceux des branches et des arbres qui se brisent et s’effondrent sous le poids du gel. Un spectacle étrange, où l’effroi se mêle à la beauté3, fascinant :