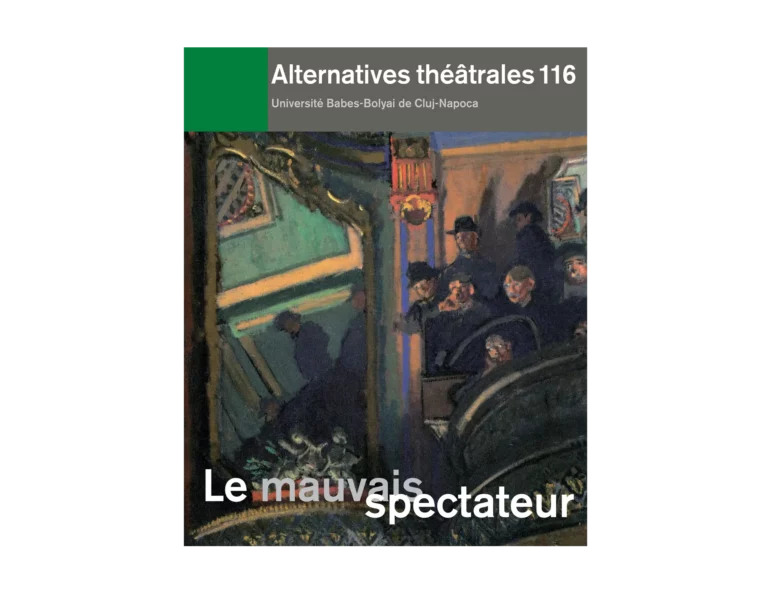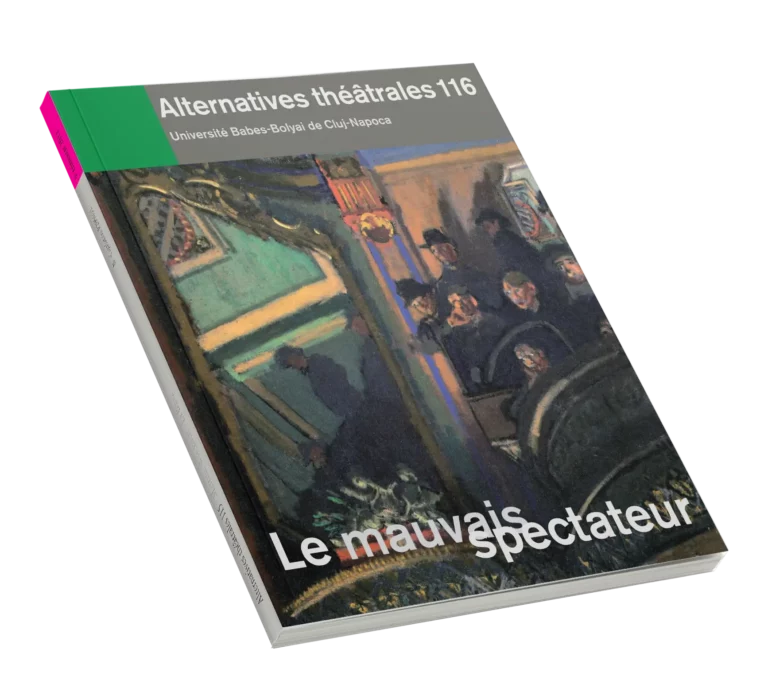AFIN DE MIEUX CERNER les processus complexes qui ont lieu à la réception « négative » d’une oeuvre d’art, je me propose d’aborder le « mauvais spectateur » à la frontière entre le cinéma et le théâtre. L’ESTHÉTIQUE DU TRAGIQUE, de Johannes Volkelt, dont la première édition date de 1896 et la quatrième, revue par l’auteur, de 1923, me sera utile en ce sens1. Je partirai du constat qu’une mauvaise posture du spectateur du crime et de la violence peut entraîner les conséquences les plus terribles ou funestes, alors qu’une bonne posture contribue au renouvellement moral, à la libération psychique du sujet récepteur à travers la catharsis. Afin de nuancer et d’illustrer ce constat, et de mieux cerner la mauvaise posture spectatoriale, j’ai choisi trois films et deux pièces de théâtre dans lesquels, à des degrés et avec des nuances diverses, on se confronte à des protagonistes qui commettent des crimes d’une violence insoutenable (des « serial killers »).
Dans le film de Michael Powell, PEEPING TOM (1960), le personnage principal, Mark, tue des femmes en les filmant pour surprendre leur peur, comme pour reprendre les expériences que son père – psychologue célèbre – faisait avec lui lorsqu’il était enfant, en le filmant sans cesse. Toutes les victimes du tueur sont jeunes, belles, blondes ou rousses, légèrement frivoles et très coquettes, et – surtout – elles montrent une ressemblance assez évidente avec la seconde épouse du père haï et admiré, avec la mère substitutive, la « mauvaise » mère.
C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS (1992), de René Belvaux, André Bonzel, Benoît Poelvoorde, raconte, sous forme de (pseudo-)documentaire, l’«histoire » incroyable d’un criminel en série, Ben (Benoît Poelvoorde), suivi par une équipe de quelques personnes qui meurent l’une après l’autre au cours du tournage : on a donc une structure de film dans le film, qui permet de grandes libertés narratives. Devant la caméra, Ben détaille toutes les méthodes employées pour tuer ses victimes, chaque fois avec des exemples à l’appui : parfois, les scènes sont horribles à force de détails, d’autres fois elles deviennent amusantes, à force de raffinements narratifs et de trucs de montage.
ELEPHANT (2003), de Gus Van Sant, est un film qui – se fondant sur une structure narrative articulée autour du point de vue et de la reprise – raconte les meurtres perpétrés dans un lycée par deux adolescents. Solitaires, isolés de leurs camarades, Alex et Éric passent beaucoup de temps ensemble, dans des conversations sur les armes et la violence, et – avant le meurtre – les spectateurs apprennent qu’il y a un amour homosexuel entre eux, car ils prennent une douche ensemble et s’embrassent. Lorsqu’ils reçoivent les fusils par courrier, les deux copains sont en train de voir un documentaire sur Hitler : il n’y a pas de doute que c’est l’idée d’une supériorité caractérielle qui motive leur geste violent car, même s’ils traitent les gens qui acclament le Führer de « tarés », c’est fait avec une grande admiration juvénile2.
Si le cinéma se complaît surtout à montrer les meurtriers en acte, le sang qui gicle, les victimes qui expirent, il n’en va pas de même au théâtre, quoique la fascination pour les criminels en série se soit manifestée souvent dans le champ de cet art aussi, au moins depuis un spectacle célèbre SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET, réalisée à Londres en 1847, à partir d’un fait divers réel. Puisque le théâtre est un art plus direct, plus corporel, les auteurs dramatiques ou les metteurs en scène évitent d’habitude d’imposer au public une grande dose de sang et de violence, en se concentrant plutôt sur la psychologie des tueurs ou sur le côté juridique de leurs affaires. Par exemple, le dramaturge et sculpteur Christian Siméon, dans sa pièce LANDRU ET FANTAISIES3, inspirée de la vie d’un célèbre tueur en série français, Henri-Désiré Landru, focalise son attention sur la confrontation de celui-ci avec Anatole Deibler, bourreau auquel la « loi » donne le droit de tuer impunément. Leur longue conversation porte sur les femmes, les manières de tuer, la justice et la nécessité de punir le crime.
De même, TUEUR SANS GAGES, d’Eugène Ionesco ne montre le fameux criminel qui terrorise la « cité radieuse » que vers la fin de la pièce : il est petit, vilain, pervers et pauvrement vêtu. De ses innombrables victimes, on n’en voit que trois, noyées dans la même piscine où sont attirés tous les curieux qui veulent découvrir la « photo du colonel », avant d’être poussés au fond des eaux. Une didascalie laisse aux lecteurs et aux metteurs en scène la liberté de réduire le criminel à une simple présence sonore : « Une autre possibilité : pas de Tueur. On n’entend que son ricanement. Bérenger parle seul dans l’ombre. »4
Quel serait le trait commun entre les oeuvres mentionnées supra ? Le fait qu’elles ont tendance à transformer ceux qui les voient en mauvais spectateurs, en les amenant à sympathiser avec les criminels, à trouver des justifications à leurs actes, ou même à agir de manière violente. Des chercheurs en psychologie, dirigés par L. Berkovitz, ont depuis longtemps montré par voie expérimentale que la représentation visuelle de la violence – loin de fournir une échappatoire et d’avoir des effets socialement bénéfiques – est susceptible d’entraîner les personnes du public à se conduire de manière violente (surtout peu de temps après la projection ou la représentation). Même quand la fiction se construit autour du criminel puni, la conséquence psychologique néfaste de la représentation est de faire tomber chez le spectateur les inhibitions relatives à l’hostilité, car il se dit que la violence est bien placée quand un méchant est châtié5. Le spectateur, sous l’impact de la violence représentée, pourrait donc être tout prêt à passer à l’action. Alex et Éric – protagonistes du film de Van Sant – ont fourni le modèle du massacre de Red Lake School, Minnesota, en mars 2005, dans lequel Jeffrey Wise a tué sept adolescents et en a blessé quatorze autres dans son lycée. Il déclarait avoir vu ELEPHANT dix-sept jours avant les événements, en insistant sur les fragments du film qui montrent la manière dont les attaques sont planifiés et mis à exécution6.