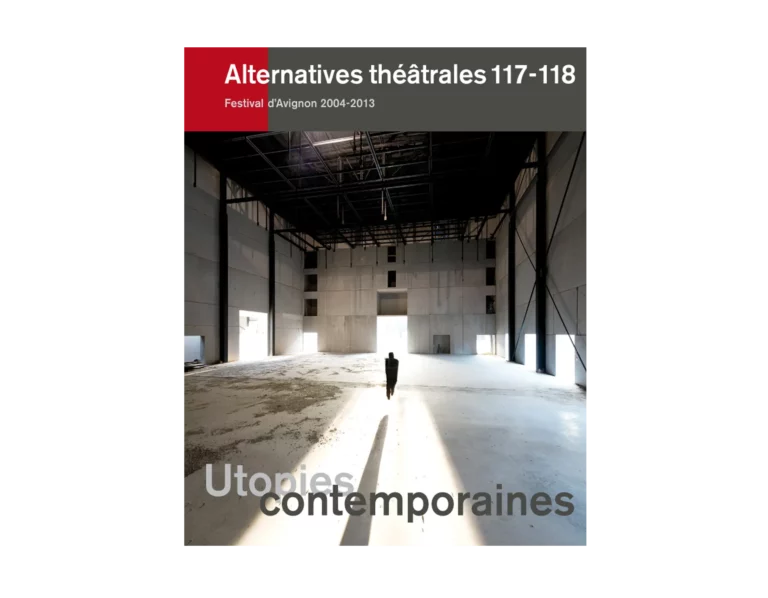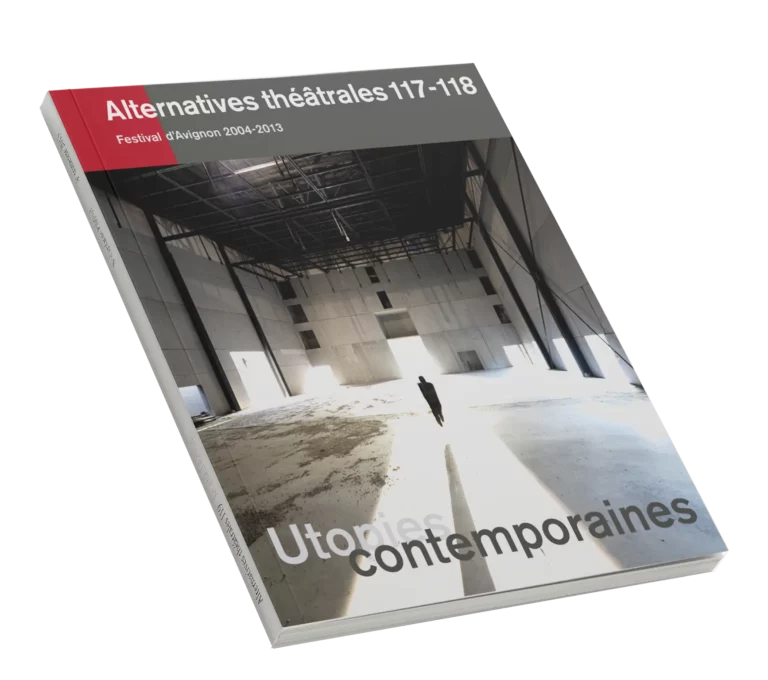EN 2004, Thomas Ostermeier est le premier artiste associé du Festival d’Avignon dans le cadre du projet que les deux directeurs nouvellement nommés, Hortense Archambault et Vincent Baudriller, ont élaboré pour ce festival. À Avignon, l’artiste a déjà présenté plusieurs spectacles, dont notamment, en 1999, SHOPPING AND FUCKING de Mark Ravenhill, HOMME POUR HOMME de Bertolt Brecht et SOUS LA CEINTURE de Richard Dresser qui l’ont révélé au public français. La même année, après avoir dirigé La Baracke, sorte de lieu-laboratoire associé au Deutsches Theater, il prend la direction de la Schaubühne, une institution phare dans le paysage théâtral allemand.
Nancy Delhalle : Quelles étaient les motivations pour accepter d’être le premier artiste associé au Festival d’Avignon ? Quels étaient pour vous les enjeux ?
Thomas Ostermeier : Un des éléments importants était mon amitié avec Hortense Archambault et Vincent Baudriller. Être artiste associé donnait la possibilité de créer la programmation ensemble avec les deux nouveaux directeurs. C’était l’occasion pour moi de rassembler des metteurs en scène allemands que j’admire et qui n’étaient peut-être pas très connus en France à l’époque, comme René Pollesch, Christoph Marthaler ou Frank Castorf, même si les deux derniers avaient déjà fait des tournées en France avant. Ces artistes essayaient de développer un théâtre engagé et même politique. Il y avait notamment une production de Marthaler traitant de cette période à Zurich où l’économie servait de prétexte à des décisions artistiques qui étaient en réalité des décisions politiques. Être artiste associé m’a donc donné la possibilité de rassembler une grande partie des metteurs en scène allemands et internationaux qui représentent le théâtre que j’aime le plus. Il est dommage que Simon McBurney n’ait pu venir mais il a été artiste associé par la suite (2012). L’enjeu était donc plutôt un désir de programmation.
N. D. : Avez-vous eu l’impression de collaborer à la consolidation d’un axe franco-allemand ?
T. O. : La nationalité n’a jamais joué un rôle important pour moi. Les questions qui m’intéressaient étaient plutôt celle du public – qui est merveilleux à Avignon –, celle de la présence d’une tradition et celle d’un intérêt pour l’avant-garde théâtrale. Par rapport à cela, la nationalité ou la situation géographique du Festival dans le monde ne sont pas importantes. Le renforcement de l’axe franco-allemand fut peut-être un résultat de cette première aventure, mais ce n’était pas pensé en ce sens, pas prévu comme tel.
N. D. : En 2004, vous présentez au Festival plusieurs spectacles dont WOYZECK de Büchner et NORA d’après MAISON DE POUPÉE d’Ibsen. Ce sont des textes issus du répertoire, ce qui tranche un peu avec votre première démarche à la Baracke et à la Schaubühne, plutôt axée sur l’écriture contemporaine, sur des auteurs moins connus. Comment négociez-vous alors cette orientation vers une relecture du répertoire par rapport à la dimension de laboratoire liée au triangle « théâtre- société-politique » du début ?