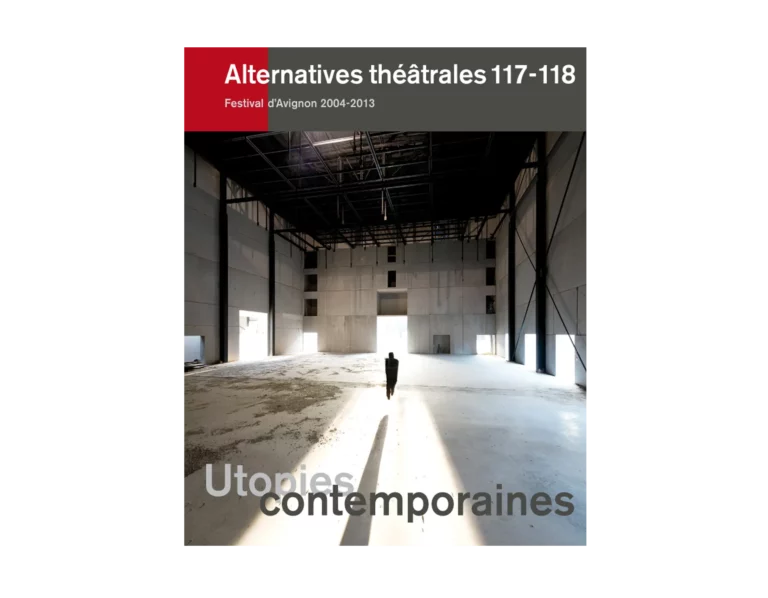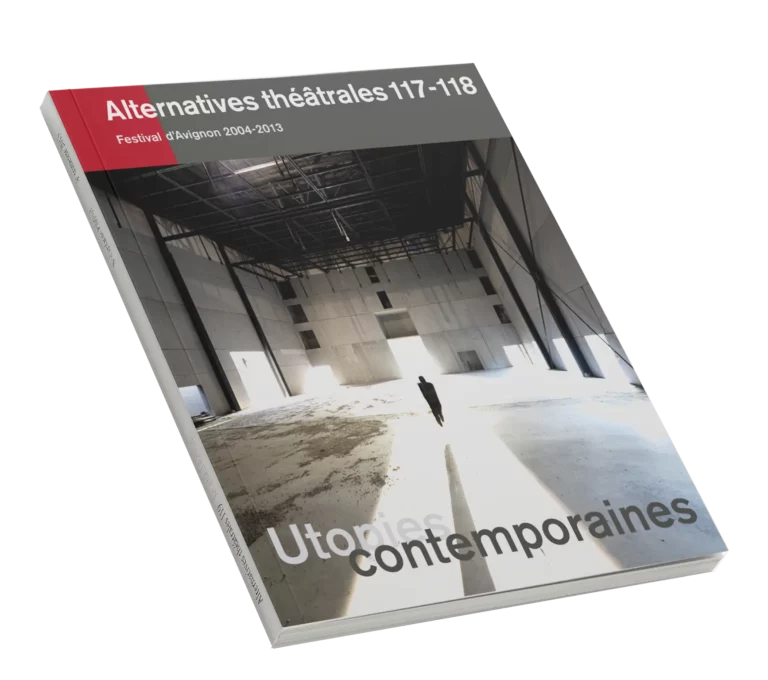COMPRENDRE les élans et les tourments d’un monde désorienté, les errements et les raisons d’espérer d’une planète convulsée. Des entretiens, dialogues et débats pour penser le monde tel qu’il va et ne va pas. Telle est l’ambition du Théâtre des idées, cycle de rencontres intellectuelles du Festival d’Avignon. Inauguré en 2004 par le philosophe Jacques Derrida (1930 – 2004), ce théâtre de la pensée vivante souhaite donner à voir, à entendre et à lire la « force violente des idées », comme l’écrivait Antoine Vitez1. En résonance avec les questions soulevées par les propositions artistiques du Festival, le Théâtre des idées est un espace public qui cherche à faire vivre toutes les pensées critiques à travers des interventions dialoguées. Crise de la représentation, abus de pouvoir, politique de l’art, devenir de l’école… Des auteurs les plus confirmés aux talents émergents, les intellectuels engagés dans la réflexion sur le temps présent dressent un état des lieux des questions qui taraudent notre modernité.
« Les guerres mondiales – et locales –, le national- socialisme, le stalinisme – et même la déstalinisation –, les camps, les chambres à gaz, les arsenaux nucléaires, le terrorisme et le chômage, c’est beaucoup pour une seule génération, n’en eût-elle été que témoin », écrivait en son temps le philosophe Emmanuel Lévinas (1906 – 1995)2. Sans comparer notre situation à celle traversée par cet enfant du siècle des extrêmes, il n’est peut-être pas vain de dire que Tchernobyl et le World Trade Center, la précarité généralisée et la vie numérisée, le terrorisme global et la synchronisation des émotions télévisées font aujourd’hui partie des données immédiates de notre conscience. Pour décrire la fabrique du commun, le destin des générations, l’éclipse du politique ou l’emprise hypnotique du leurre économique, nous avons donc sollicité les chercheurs qui nous semblaient le mieux à même de saisir les enjeux d’une planète déchirée. Afin de comprendre ce que parler veut dire, ce que la jeunesse veut parfois subvertir, ce que peut encore le corps, ce que signifie la modernité, ce qu’il reste de sacré, ce que l’on pense ailleurs et comment on pense autrement, nous avons réuni des intellectuels qui ont le souci du monde et de la transmission. Car le Théâtre des idées est conçu comme un ensemble de rencontres exigeantes et accessibles, approfondies et introductives, dont l’accès, nous l’espérons, ne nécessite aucun présupposé, ne sollicite aucun implicite. Afin de sortir
de la résignation qui gagne notre civilisation, nous avons souhaité faire appel à des penseurs qui s’attachent à rendre la parole à ceux qui en sont privés, à des philosophes, anthropologues, sociologues, écrivains ou historiens qui nous donnent quelques raisons d’espérer.
Créé avec Hortense Archambault et Vincent Baudriller, codirecteurs du Festival d’Avignon, qui ont souhaité que l’espace théâtral redevienne un lieu de critique du monde et de ses représentations, le Théâtre des idées s’est donc aventuré sur des domaines et des thèmes arpentés par le projet artistique du Festival. Et ce n’est sans doute pas un hasard si cette « espèce d’espace » intellectuel, pour reprendre les mots de Georges Perec, a trouvé son ancrage, son terrain et son écrin à Avignon, au cœur même du temple du théâtre, cet art en apparence anachronique qui fait encore le pari de la présence, au moment même où les relations et les transactions se font et se défont virtuellement derrière des écrans électroniques. Chambre d’écho des problèmes sociaux, carnaval artistique où se côtoient les plus divergentes esthétiques, caisse de résonance des engagements politiques, le Festival d’Avignon demeure en effet unique par l’importance de son aura symbolique. Avec sa capacité singulière à transcrire le monde et ses soubresauts, le Festival d’Avignon est, depuis sa création en 1947, un théâtre de la pensée. Et gageons qu’il le restera encore longtemps.
Qu’on en juge. 11 septembre 2001, les tours jumelles de Manhattan s’effondrent. Et avec elles, semble-t-il alors à la planète entière rivée aux écrans de télé mondialisés, toute une civilisation. Avril 2002 : en France, Jean-Marie Le Pen rivalise avec Jacques Chirac au second tour de l’élection présidentielle française. De la politique à l’esthétique, de nombreux auteurs s’accordent à reconnaître le symptôme d’une « crise générale de la représentation ». Après l’annulation de l’édition 2003 du Festival d’Avignon suite au mouvement des intermittents du spectacle, une nouvelle équipe s’installe. Trentenaires en phase avec les questions de leur génération, Hortense Archambault et Vincent Baudriller décident d’associer chaque année un artiste à l’élaboration de l’édition, afin de « tracer avec lui la carte d’un territoire artistique ». Par souci du devenir de notre société, s’imagine alors le Théâtre des idées, nouvelle agora du Festival d’Avignon où les propos d’intellectuels critiques font écho aux réalisations artistiques.
Acte I : en 2004, Thomas Ostermeier, premier artiste choisi pour inspirer la programmation, fait entrer la clameur des rappeurs dans la Cour d’honneur du Palais des papes où le soldat WOYZECK imaginé par Georg Büchner (1813 – 1837) est transposé dans un no man’s land de la périphérie des grandes villes européennes. Le jeune directeur artistique de la Schaubühne de Berlin déplace également l’intrigue d’UNE MAISON DE POUPÉE d’Henrik Ibsen (1828 – 1906) dans un loft calqué sur le papier glacé des magazines de déco huppés, afin de déjouer la comédie sociale du nouveau bonheur conjugal. Avec rage et imagination, le nouveau théâtre européen réinvente la critique sociale théâtrale. Sur la scène du Théâtre des idées, le philosophe Jacques Derrida tutoie la vieille Europe dans un rare moment d’intimité philosophique. Sans renier sa déconstruction de l’eurocentrisme, il demande à la « neuve vieille Europe » de s’engager dans un chemin qu’elle est la seule à pouvoir emprunter aujourd’hui, « entre l’hégémonisme américain, la théocratie fondamentaliste et la Chine, qui devient déjà, pour ne prendre en considération que la question du pétrole, déterminante dans les lignes de force géopolitiques du temps présent », écrit-il dans DOUBLE MÉMOIRE, lettre adressée à la « vieille Europe » qui précéda son intervention. En un mot, déclare l’un des représentants les plus marquants de la French Theory, la « déconstruction » est derrière nous. Il s’agit désormais de construire un autre monde, une autre Europe, une autre histoire. Acmé et success story du Festival 2004, LA CHAMBRE D’ISABELLA de la Needcompany, dirigée par le Flamand Jan Lauwers, témoigne de ce retour au récit. Après avoir accompagné le mouvement de déconstruction des formes convenues du théâtre et de la danse, Jan Lauwers et sa bande chantent le XXe siècle tel que le perçoit une femme de quatre-vingt-quatorze ans, qui fait défiler l’histoire de ses amants et de ses enfants dans le rétroviseur de son passé.
Acte II : du souci du monde au souci de soi, il n’y a qu’un pas. Entre le monde et le moi, il y a un média, un médium, un intermédiaire : le corps, dont l’édition 2005 affirme le primat. Artiste associé d’une édition vivement débattue, le Flamand Jan Fabre reprend son conte de fées médiéval, JE SUIS SANG, comme un tableau de Jérôme Bosch vivant. Dans son HISTOIRE DES LARMES, également présentée dans la Cour d’honneur, un Diogène en chair
et en os cherche en vain un homme, comme le rapporte la célèbre anecdote. On se souvient que Platon avait défini l’homme comme un « bipède sans plumes ». Qu’à cela ne tienne : Diogène plume un poulet et lance dans les jambes du fondateur de l’Académie la créature qui, par sa seule apparition ludique, déjoue la définition platonicienne. Sur la scène du Théâtre des idées, Michel Onfray réactive la tradition philosophique des Cyniques, dont le chien était l’emblème et Diogène l’un de leurs plus percutants représentants. Face au cynisme vulgaire et ordinaire, il y défend cette singulière capacité à manier l’ironie qui peut permettre à un artiste d’être réellement subversif en devenant « un penseur d’utopie en prise directe avec son corps ». Historiens du sensible et de l’intime, Alain Corbin et Georges Vigarello s’attellent à l’histoire culturelle de la déchristianisation de la chair et de l’autocontrôle des émotions. Côté cour, le débat est lancé. Dans un ouvrage en forme de va-et-vient critique et nostalgique entre la « fraternité » de l’année 1956 et le « tournis » que lui a donné l’édition 2005, lors de laquelle il était invité au Théâtre des idées à parler de la persistance du sacré dans notre monde désenchanté, Régis Debray déplore que, dans notre pays « américanisé », il y ait désormais « la France des petits blancs qui regardent TF1, où le théâtre est banni. Et celle des théâtreux, où les premiers n’entendent que du petit-nègre3 ».