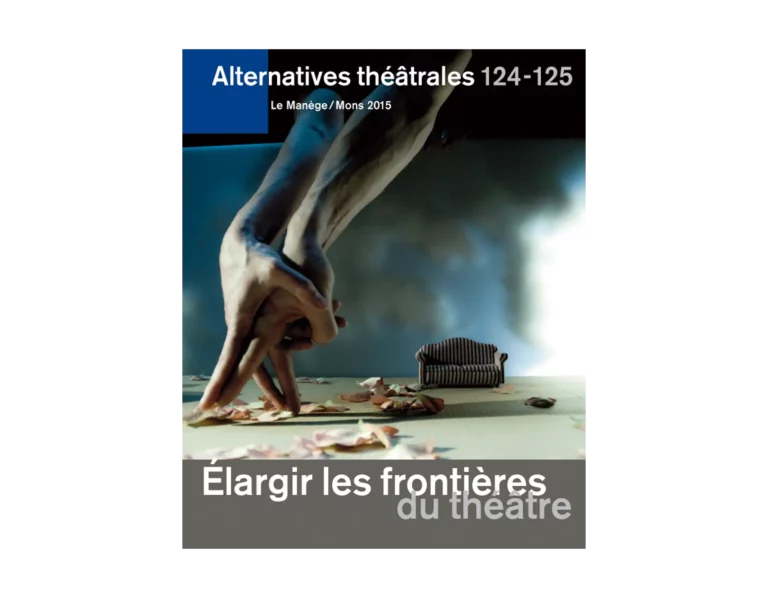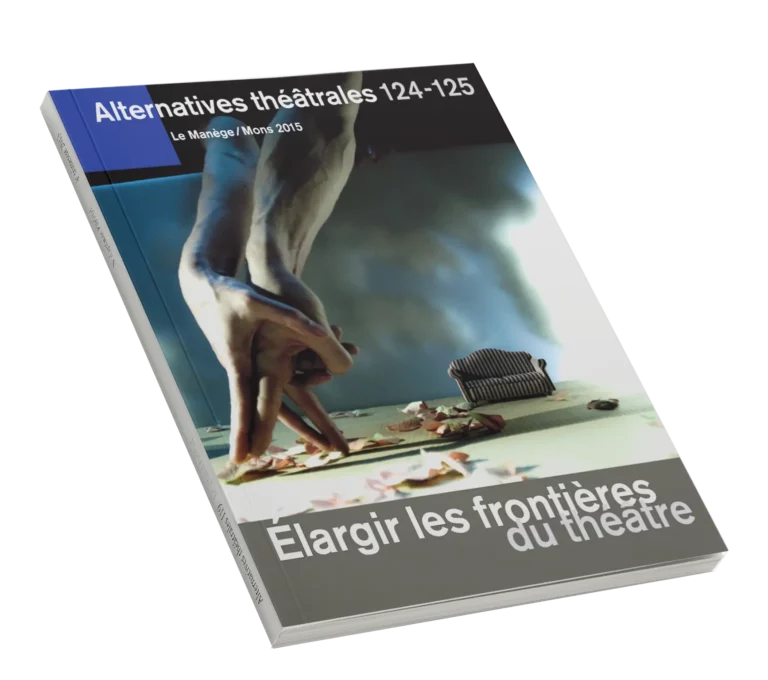DEPUIS quelques décennies, les artistes du « vivant » investissent régulièrement l’espace public. (On pourrait ici rappeler que pendant plus de deux mille ans, le théâtre s’est joué sous le ciel. et qu’il ne s’est enfermé que très récemment, il y a quatre cents ans environ, dans des bâtiments. perdant ainsi son lien direct avec la Cité. mais cela c’est une autre histoire).
Le théâtre « retourne » donc dans la rue dans le courant de Mai 68. Des collectifs veulent quitter les théâtres pour s’adresser aux gens, ils revendiquent la gratuité, l’abolition du 4 mur, la création collective, souhaitent surtout directement toucher les populations. En bref, ils veulent « jouer dehors parce dedans il fait froid » (dixit Bruno Schnebelin d’Ilotopie). (En Belgique francophone, plutôt que la rue, rarement investie, c’est le mouvement de Théâtre-Action qui poussera à quitter le confort des salles bourgeoises pour les usines, abattoirs, maisons du peuple. mais là aussi, c’est une autre histoire).
Cinquante ans plus tard, pas une municipalité française (et de plus en plus de communes belges plus récemment) qui n’ait son festival de « théâtre de rue », pas une administration qui ne développe sa politique de soutien aux « arts de la rue ». Mais avec quels enjeux ? Tous ces événements proposent des créations, certes, mais dont la finalité est bien plus souvent distractive et animative que critique ou interpellative sur les enjeux du vivre ensemble.
Ainsi, quand je me rends aujourd’hui dans un festival de théâtre de rue, j’ai l’impression de me retrouver dans une immense salle de spectacle, une sorte d’espace scénique élargi, un espace-temps homogénéisé, certes joyeux, coloré ou parfois un brin provocateur, mais bien souvent dépourvu de ce qui fait l’essence de l’art de la rue : la rencontre inopinée, l’effet de surprise, l’esthétisation de l’inattendu et du non-conformisme (définition toute personnelle et subjective).
Pourtant, face àcet « espace public » déshumanisé, abandonné aux caméras de surveillance, privatisé, sécuritaire, saturé des images et des bruits qui égrènent principalement les différentes façons de consommer, les artistes ont une grande responsabilité à agir.
« Il faut aller au front, c’est un Grand Combat qui commence, et il faut y aller résolus, et très offensifs » (Bernard Stiegler)
Mais pour faire quoi, si la simple occupation de la rue ne suffit pas ?
Tout projet artistique placé en espace public entretient un dialogue — maîtrisé ou non — avec son contexte. Ce qui apermis à Paul Ardenne d’explorer la notion d’art contextuel. La notion de dialogue est fondamentale car, si chaque espace public peut accueillir les formes les plus diverses, un acte artistique n’est pertinent que s’il résonne avec son contexte, s’il en fait apparaître des aspects inconnus ou peu visibles, s’il nous le fait redécouvrir.

Paul Ardenne l’exprime clairement, quand il écrit en introduction à UN ART CONCEPTUEL1 : « Pour l’artiste contextuel, il s’agit bien de « tisser avec » le monde qui l’entoure, de délaisser les classifications classiques de la représentation pour leur préférer la mise en rapport directe et sans intermédiaire de l’œuvre et du réel ».
En tant que conseiller artistique « fêtes, installations et espace public » de Mons 2015 Capitale Européenne de la Culture, mes collègues et moi-même avons fait un choix clair : celui de proposer aux publics des projets d’écritures qui se frottent à la ville et ses enjeux dans cette dynamique « contextuelle ». Plutôt qu’«arts de la rue » on préfèrera « art de la ville », ville qui n’est plus le contenant d’une œuvre, mais désormais son contenu.
Ainsi, en 2015, les artistes qui envahiront les pavés montois auront bien évidemment à charge de nous distraire, de nous amuser, de nous faire rêver. mais bien au-delà ils se sont tous donné pour mission de redonner corps à une certaine utopie du vivre ensemble.
Les dizaines de milliers de dominos qui arpenteront plus de deux kilomètres de pavés montois le 14 mai 2015 en ouverture de La ville en jeux racontent cela : lier Les quartiers, Les lieux, et les habitants dans un « faire ensemble » impliquant des centaines de participants (responsables du placement des dominos géants!) et les milliers de spectateurs qui, au-delà de la jubilation de la chute finale, redécouvriront leur propre ville dans un parcours traversant parcs, homes, écoles…
Il en va de même pour Pride, le projet plus intime du Groupenfonction, présenté dans le même festival et qui propose à un groupe de danseurs amateurs (formés en workshop) d’investir l’espace public sous la forme d’un parcours en lien avec la ville. Le groupe se rassemble pour danser. Ils ne se regardent pas, mais s’écoutent, écoutent le rythme qu’ils créent. Il n’y a pas de musique, seuls leurs souffles les guident vers un rythme commun.
Ils forment un tas, une créature à mille corps, qui se déplace dans la ville, lentement, à raison d’un à sept mètres par minute.
En apparence chacun pour soi, dans une somme de solitudes. Et pourtant, ils dansent ensemble, à l’écoute de soi, de l’autre, du groupe, du monde… « Une danse persistante d’individuation collective qui donne à voir l’irréductibilité de l’être en présence » (Arnaud Pirault, concepteur).
Ces deux projets, et — nous l’espérons — beaucoup d’autres présentés en 2015 auront à cœur de modifier le « partage du sensible », perturberont l’ordre des évidences, montreront que le monde n’est pas fatalement comme il est, qu’il y a des réserves de possible, que les ressources de l’imaginaire permettent de faire advenir d’autres agencements du réel.
Pour nous rappeler que l’artiste, tout comme le spectateur, ont le pouvoir de modifier l’état des choses, fût-ce modestement.
- Paul Ardenne, UN ART CONCEPTUEL, Flammarion, 2002. ↩︎