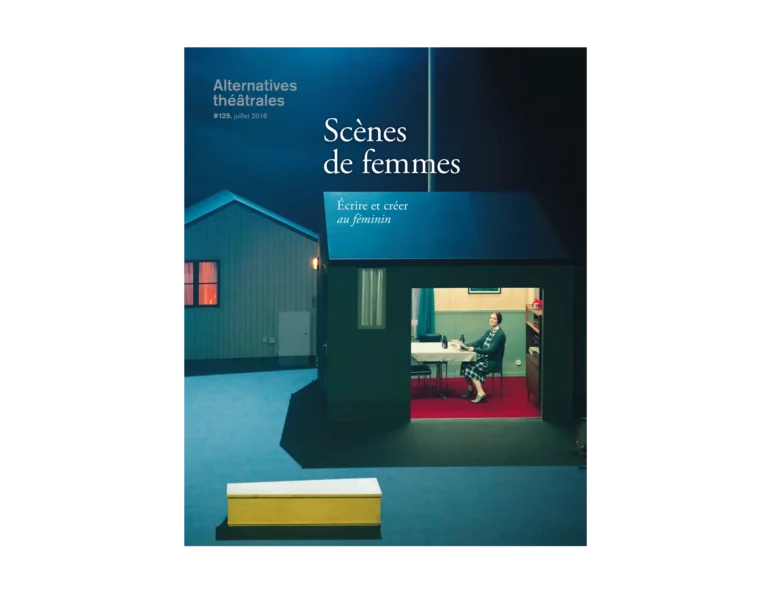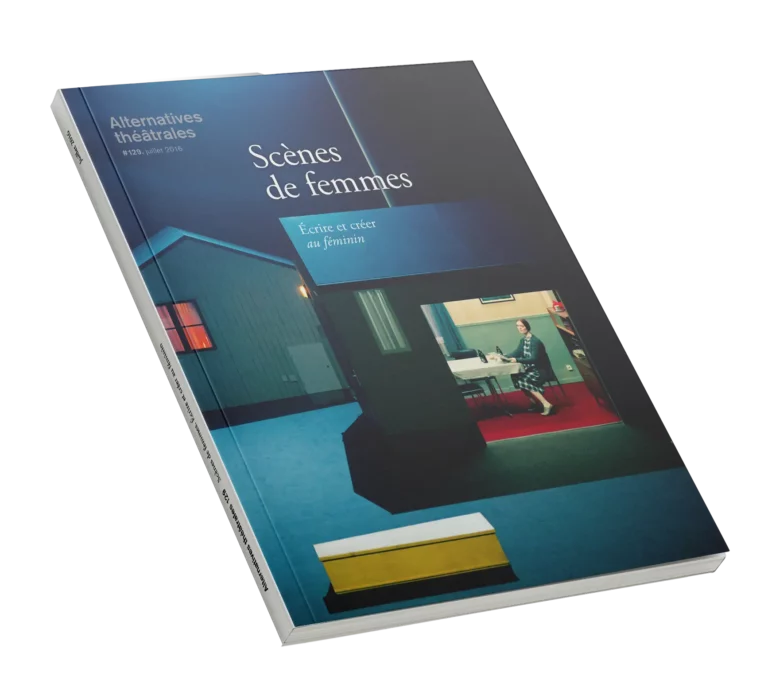En 2013, comme probablement beaucoup d’autres acteurs mâles de la scène bruxelloise, j’ai reçu un mail d’Anne-Cécile Vandalem. Exprimée dans le cadre de la préparation du premier Marathon des Autrices1 en Belgique francophone, la demande était la suivante : « comment, selon toi, formuler l’invitation à cet événement pour qu’il intéresse les hommes que nous souhaitons y inviter ? » Les réponses collectées devaient fournir la matière à une performance d’Anne-Cécile. J’avais répondu quelque chose comme « Ta question me semble cruciale et essentielle ; je voudrais prendre le temps d’y répondre le mieux possible », j’avais laissé passer du temps et n’avais finalement rien répondu du tout. Avec trois ans de retard, ces quelques courtes notes sont – peut-être – une forme de nouvelle tentative.
Dans Théories de la littérature2 (sous-titré « Système du genre et verdicts sexuels »), Didier Eribon affirme ceci : « On ne peut pas défaire tout ce que l’histoire a fait, et l’on ne peut pas se défaire de tout ce que l’histoire nous a fait être. Et c’est pourquoi l’analyse critique du monde social requiert toujours comme une de ses exigences les plus fondamentales d’en passer par l’auto-analyse comme critique de soi-même, comme critique de l’ordre social en soi-même. La généalogie politique du présent – l’ontologie de nous-mêmes comme investigation sur l’ensemble des verdicts qui nous constituent – passe nécessairement par une auto-généalogie, une autoanalyse comme moyen de donner forme et sens aux pulsions hérétiques et subversives. »
Des six formes longues dont j’ai signé la mise en scène, seules deux3 réussissent le test de Bechdel-Wallace. Pour rappel, appliqué généralement au cinéma, le test de Bechdel-Wallace4 consiste à vérifier la présence féminine au sein d’une œuvre. Le test est réussi si les trois affirmations suivantes sont vraies : « deux femmes sont identifiables dans l’œuvre ; ces deux femmes parlent ensemble ; elles parlent d’autre chose que d’un personnage masculin. » Idée de billet pour le blog d’Alternatives théâtrales : appliquer le test à tous les spectacles programmés dans un lieu, un festival, une saison (à suivre).
En 2011 – 2012, lors de la tournée du spectacle Les Langues paternelles5, j’ai été plusieurs fois surpris que l’on accole avec force à notre travail l’étiquette de « spectacle féministe ». S’agissant d’un texte écrit par un homme, dont le personnage central est un homme parlant de son père et de ses fils, porté sur scène par trois acteurs masculins, cette analyse ne s’imposait pas d’emblée. À la réflexion, il semble que ce soit le fait d’affirmer avec force que la parole sensible (à dimension familiale, introspective jusqu’à l’impudeur) puisse être portée pleinement par des hommes, qui ait pu donner cette impression à certains. Associer avec aplomb la sensibilité à la masculinité, « féminiser » le discours masculin en somme, ne semblait pas aller de soi…
La féminisation du discours masculin… un sillon à creuser. Renseignements pris à ce sujet, avant Judith Butler, Luce Irigaray a publié plusieurs livres marquants qui semblent aujourd’hui un peu oubliés6. Entre autres idées, elle y défend la nécessité de féminiser le langage d’abord, pour parvenir à féminiser les rapports humains ensuite. Non pas donc l’exhortation faite aux femmes d’entrer dans la logique phallocentrée archi-dominante et de l’intégrer, mais bien la perspective – in fine profitable aux deux sexes – de mettre à bas le phallocentrisme et l’exercice masculinisant du langage, du pouvoir, du système, pour les réinventer au féminin. Vertigineux programme.
Lorsque le Festival d’Avignon a programmé Angelica Liddell pour la première fois, c’était éructant : elle, se scarifiant, entourée de Mariachis et de leurs cuivres rutilants7. En quelques spectacles, Liddell a ensuite imposé aux spectateurs francophones une identité esthétique puisant dans l’énergie punk – le long monologue du Syndrome de Wendy constituant sans doute un sommet du genre8. Est-ce parce qu’elle semble y « féminiser » soudain son énonciation que Tandy en a déstabilisé plus d’un ? Dans la salle du Kaaitheater où j’assiste à la représentation de son dernier spectacle, les spectateurs me semblent se diviser en deux groupes : ceux (dont je suis) qui reçoivent la violence sourde et contenue comme une épée qui transperce, terrassés par l’émotion ; les autres, déçus du peu de cris et d’hémoglobine, que le spectacle indiffère et qui se demandent où est passée sa rage. Tandy n’est certainement pas moins violent que les spectacles précédents d’Angelica Liddell. Mais il l’est différemment, à coup sûr.

Isabelle Pousseur en 1991 (Si l’été revenait et Le Songe), Martine Wijckaert en 1998 (Et de
toutes mes terres rien ne me reste que la longueur de mon corps) et Anne-Cécile Vandalem en 2016 (Tristesses) sont les trois dernières femmes de Belgique francophone programmées au Festival d’Avignon. C’est un fait.
Anne-Cécile, cette question de 2013, je ne parviens toujours pas à y répondre. J’avais assisté à ce Marathon des Autrices, et j’avais été un peu désolé de penser malgré moi que l’acte le plus politique et transgressif de la soirée avait été la seule prise de parole masculine : Antoine Pickels en talons hauts donnant une conférence – Avoir la béguine – sur le « devoir et le désir masculins de féminisme ». La classe…
Finalement, c’est peut-être ton arrivée sur le plateau de Tristesses, l’aplomb et la morgue avec laquelle tu imposes ta présence, et avec elle ton écriture politique, la force de l’ambiguïté de ce que tu y incarnes à plusieurs niveaux (pêle-mêle et sans exhaustivité : le pouvoir, l’organisation du récit, la manipulation, la revanche…), qui constituent les meilleures réponses à ta propre question.
Éribon, encore, dans les dernières lignes de son livre déjà cité : « Se pose alors la question : telle ou telle forme d’oppression spécifique – la domination masculine et avec elle la domination hétérosexuelle – ne doit-elle pas être analysée dans ses relations avec les autres formes d’oppression ? »9
- Suivant la formule initiée à Grenoble et à Paris, le Marathon des Autrices à Bruxelles s’est déroulé les 13 et 14 novembre 2013 à l’Atelier 210 : vingt-quatre heures continues durant lesquelles 72 femmes de théâtre ont lu 72 extraits de leurs œuvres. ↩︎
- Théories de la littérature. Système du genre et verdicts sexuels, Paris, Presses universitaires de France, 2015. ↩︎
- Les Langues paternelles : raté ! Dehors : réussi ! L.E.A.R. : raté ! Démons me turlupinant : raté ! Le Réserviste : raté ! Szénarios : réussi ! ↩︎
- Du nom de l’autrice de bande dessinée Alison Bechdel et de son amie Liz Wallace (1985). ↩︎
- Spectacle créé en 2009 à Bruxelles, d’après le roman de David Serge (éd. Robert Laffont). ↩︎
- Linguiste, philosophe et psychanalyste née à Blaton (Belgique) en 1930, elle a publié, entre autres Speculum en 1974 et Ce sexe qui n’en est pas un en 1977 (tous deux aux Éditions de Minuit). ↩︎
- La Casa de la fuerza, en 2010. ↩︎
- Todo el cielo sobre la tierra (el síndrome de Wendy) en 2013. ↩︎
- Théories de la littérature, op. cit. ↩︎
Antoine Laubin co-dirige Alternatives théâtrales avec deux femmes : Sylvie Martin Lahmani et Laurence Van Goethem. Il est par ailleurs metteur en scène au sein de la compagnie De Facto. En octobre 2016, il créera – avec six femmes et six hommes – un spectacle consacré aux questions du désir et du genre : Il ne dansera qu’avec elle.