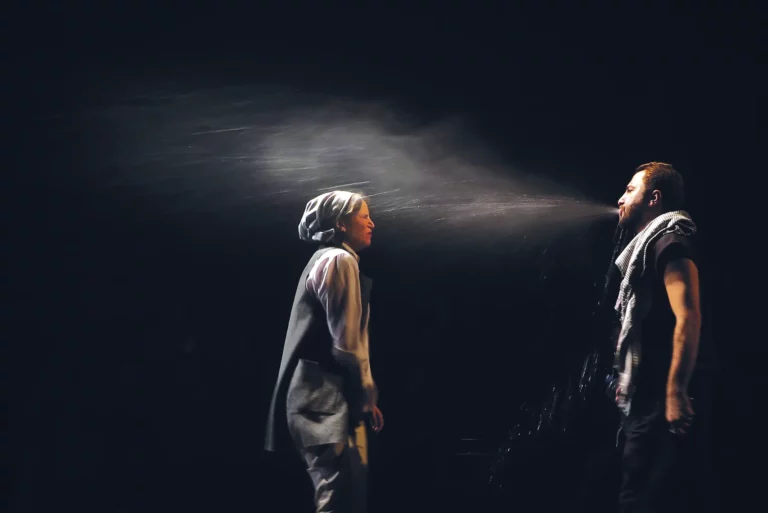SM‑L Depuis quelques années, en France et en Belgique tout du moins, les observateurs de la scène théâtrale s’intéressent de plus en plus aux arts de la scène en Iran. La spécialiste de théâtre en Iran Liliane Anjo, écrivait dans la Revue de Téhéran : « Le théâtre iranien contemporain est depuis plusieurs années traversé par une sorte d’élan vital… Depuis la fin des années 1990, le nombre de troupes et de spectacles ne cesse de croître. » Si vous êtes d’accord avec cette datation, comment expliquez-vous ce phénomène ?
PS En effet, je peux confirmer cette date. Une des explications vient du fait que le nombre de facultés de théâtre a considérablement augmenté. La deuxième raison est liée à la jeunesse de la société iranienne. Parmi les jeunes gens qui ont suivi les filières d’art dramatique, un grand nombre est entré dans le monde professionnel du théâtre depuis. La génération qui est née dans les années 1970, avant la Révolution, est entrée dans la vie active dans les années 1990, et le monde artistique a évidemment attiré un grand nombre de jeunes. Nous savons que chaque année, 700 à 1100 étudiants sortent diplômés des universités de théâtre. Cela explique en grande partie le nombre croissant de créations. La présence des compagnies iraniennes dans les festivals à l’étranger a également débuté à ce moment-là.
Il est certain que le développement d’internet a favorisé les relations internationales entre artistes.
SM‑L Avec quels pays développez-vous des projets théâtraux ?
PS Les cursus universitaires à Téhéran sont très influencés par ce qui se passe en Europe.
Il y a donc une relation naturelle entre l’Iran et plusieurs pays européens. Les Iraniens regardent beaucoup ce qui s’y passe, la manière de concevoir des programmations et de produire des projets aussi. Nous dialoguons notamment avec la Belgique, l’Allemagne, la France, des pays où le théâtre iranien a pu exister. Nous nous sommes également intéressés aux pratiques artistiques et culturelles de l’Asie de l’Est, de la Chine, de la Corée et du Japon… Nous avons également noué des échanges importants avec la Pologne, autour de la conception de festivals de théâtre de marionnettes en plein air.
SM‑L Le premier Guide de théâtre iranien1 a récemment été publié. Il donne un aperçu de l’ampleur du dispositif théâtral dans le pays. Pouvez-vous nous donner des clés pour comprendre le paysage théâtral dans toute sa complexité : dans les provinces et à Téhéran ; structures d’État et éclosion des salles privées ; formes traditionnelles et contemporaines ; en salle et hors les murs…
PS Ce guide est effectivement très important pour nous. Pendant longtemps, nous avons travaillé sans guide exhaustif de ce type, sans documentation large sur le théâtre iranien.
Il nous a paru important de rappeler qu’il ne se résume pas au théâtre à Téhéran. Il existe fortement dans toutes les provinces du pays !
Nous avions besoin d’un outil neuf pour affiner notre connaissance des arts dramatiques depuis les années 1970, d’un outil statistique de ce genre pour comprendre, par exemple, l’influence des universités sur la vitalité artistique aujourd’hui, pour connaître le poids des structures gouvernementales et non gouvernementales dans le paysage théâtral… Pour être précis, en Iran, il y a vingt-trois universités dédiées au théâtre, huit institutions privées et trois institutions publiques (universités des sciences appliquées et technologies)2. À Téhéran, il y a vingt-quatre salles gouvernementales (des salles subventionnées par l’État) et cent six privées. Dans les autres provinces d’État, on compte vingt-trois salles privées. Le but de ce nouveau guide est de recenser la diversité des possibilités existantes en espérant que l’État pourra modifier ses modes d’interventions.
SM‑L En France, le ministère de la Culture définit et insuffle la politique culturelle des établissements publics (quel que soit le label), sur l’ensemble du territoire via les DRAC (Directions Régionales des Affaires Culturelles).
Qu’en est-il en Iran ? De quel type d’intervention parlez-vous ?
PS En Iran, c’est l’État qui définit la politique culturelle. Jusqu’à maintenant, il imaginait les axes directeurs de cette politique (dans tous les secteurs artistiques, théâtre mais aussi cinéma, arts plastiques…) et la subventionnait. Ces cinq dernières années, le nombre de productions de spectacles a énormément augmenté, en raison de l’arrivée sur le marché de l’emploi des jeunes gens diplômés en études théâtrales et de la multiplication des espaces de représentation (publics mais aussi privés). L’État poursuit cependant son soutien aux structures théâtrales, notamment en termes de subvention directe aux compagnies. Mais quand l’État soutenait environ soixante-dix œuvres par an il y a six ans, il octroie aujourd’hui un montant global – certes un peu augmenté – mais réparti sur deux-cents œuvres théâtrales par an… On note également que le théâtre se présente de moins en moins comme un art réservé à un public particulier, privilégié. Le fait que de nombreux jeunes viennent se former à Téhéran avant de retourner vivre, et faire vivre les outils culturels dans les provinces iraniennes, explique en partie cette tendance à la « démocratisation » culturelle.
Par ailleurs, l’État a choisi de diminuer son soutien global aux compagnies, en raison du nombre croissant des compagnies et des œuvres déjà évoqué, et aussi pour améliorer l’économie du spectacle vivant, qui peut générer de nouvelles recettes financières grâce à la billetterie ou au soutien de la sphère privée (mécénat et sponsoring). Le théâtre n’est plus considéré comme un art ne pouvant survivre qu’avec des subventions. Ces dernières années, l’État a essayé de jouer son rôle tout en facilitant la présence
du secteur privé dans le domaine culturel. Il a également souhaité accompagner qualitativement l’augmentation du nombre de créations, tout en essayant de légitimer des formes de spectacle très souvent déconsidérées en Iran, comme le théâtre jeune public ou le théâtre de marionnettes.
Enfin, d’après les lois en Iran, toute pièce de théâtre mais également toute œuvre artistique, cinématographique, musicale, etc. doit recevoir les autorisations de l’État.
SM‑L En Europe comme à l’échelle internationale, nous connaissons relativement bien le cinéma iranien, mais notre connaissance du théâtre se limite malheureusement aux œuvres du metteur en scène Amir Rezâ Koohestâni.
Comment expliquez-vous cela ?