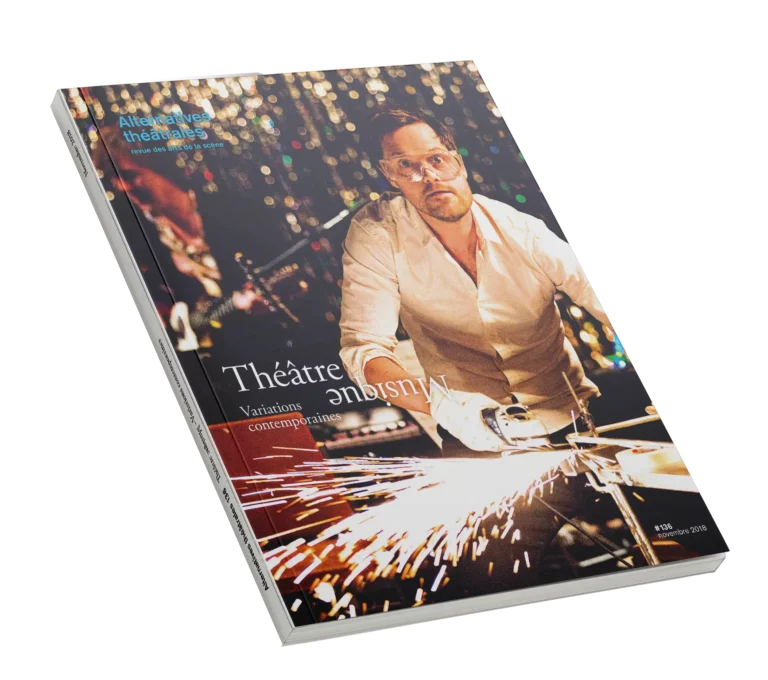Volontairement éloignée du théâtre de texte, c’est la sphère musicale et le voyage sensuel qu’ils inspirent qui est le moteur des créations d’Ingrid von Wantoch Rekowski. La recherche que l’artiste mène depuis ses premiers spectacles se fonde sur cette intuition : la musique est porteuse de tout un monde ambigu et sa traduction scénique permet d’ouvrir à une polyphonie du sens. Dans A Ronne II1, le spectacle qui l’a révélée au public, le spectateur était plongé dans un univers sensoriel qui multipliait les propositions imaginaires. Le texte, même s’il peut suggérer des « ailleurs », est souvent plus univoque que la musique qui permet des interprétations multiples. Corps et musique vont développer des dimensions supplémentaires. L’incarnation de la musique dans le corps des acteurs va entraîner le spectateur dans les méandres de perceptions insoupçonnées.
L’univers baroque est un terrain de prédilection pour les recherches d’Ingrid von Wantoch Rekowski. Le travail réalisé à partir des madrigaux de Monteverdi2 mettait en valeur les « dissonances » et les frictions qui se trouvent dans la partition. Un madrigal traduit davantage une émotion qu’un récit. Il n’est pas nécessairement linéaire, est construit avec plusieurs voix. « Le théâtre de la musique se suffit à lui-même et ne doit pas être illustré ; il faut conserver ce théâtre et créer un langage scénique en parallèle, complémentaire et en contrepoint. »3 On sent dans cette affirmation de l’artiste la relation tumultueuse qu’elle entretient avec l’opéra. Le théâtre musical veut souvent dire ce que la musique dit déjà, et l’on y rencontre alors une lourdeur et un manque de respiration. L’enjeu est de trouver le contrepoint juste, éviter le cliché et créer une tension qui, par la mise en scène, n’enferme pas le sens, car la musique n’est pas dans la fermeture du sens.
En écoutant la Messe en si de Bach, ce n’est pas le récit qui l’emporte d’abord, c’est le choc musical qu’il crée et c’est ce matériau musical qu’elle projette sur scène dans le corps des acteurs. Ingrid von Wantoch Rekowski reprend en 2018, près de vingt ans après sa création, In H‑moll4, avec la même équipe artistique (sauf Dominique Grosjean remplacée par Daphné D’Heur), donc les mêmes personnalités qui ont participé à inventer la matière théâtrale et qui sont allées chercher derrière les mots et les notes ce qui est caché…
Avec sa compagnie, Lucilia Caesar, elle développe une recherche sur la « parole musicalisée ». Il s’agit pour les acteurs (qui ne sont pas des chanteurs) de rentrer dans la partition et de s’inspirer de la logique et de la mécanique musicale, puis de s’emparer de la parole comme le ferait un compositeur. Il s’agit toujours de chercher le « corps » du musical. On assiste alors à la création d’un étrange sabir, une sorte de tentative d’inventer une langue nouvelle, à première vue « indécodable », qui permet de proférer des sons qui sont articulés comme des « mots inconnus », mais qui participent d’une tentative de communication d’affects intégrés à l’expression du corps tout entier. Dans une série de spectacles5, Ingrid von Wantoch Rekowski a intégré l’univers de la peinture (tableaux vivants) au cœur de son processus de création théâtrale. Pour elle, la partition se trouve dans la peinture comme dans la musique. La partition structure la voix dans la musique comme elle structure les corps dans la peinture. Il y a une convergence entre la peinture et la musique baroque qui permet de saisir et d’exploiter les tensions qu’elles révèlent et de proposer une partition physique, vivante, polyphonique. Dans ses quatre ateliers sur Wagner6, l’artiste n’a pas craint d’aborder ces monuments musicaux qui font partie de notre culture (particulièrement de la sienne, liée à ses origines). L’enjeu était d’imaginer une création à l’opposé du gigantisme qui entraîne des lourdeurs et des longueurs souvent insoutenables. Pourtant, cette musique est fascinante et nous transporte entre sublime et barbarie. Le travail avec les étudiants d’origine et de formations diverses (Lausanne, Mons, La Cambre, INSAS) a permis de déconstruire la fascination parfois ambiguë que révèle cette musique. Quatre ateliers pour plonger dans les méandres de la tétralogie wagnérienne et scruter la tension entre folie et génie : réinvention d’un langage archaïque (L’Or du Rhin), dérision de l’art de la guerre (La Walkyrie), délire et peur de l’amour (Siegfried), pulsion de mort (Le Crépuscule des dieux). La metteure en scène pédagogue n’a pas craint d’aborder ce monde où « l’univers [se] confronte au particulier, le sublime au pathologique, l’héroïque au grotesque, le mythique à l’insignifiant. La pensée y est toujours paradoxale, dangereuse, à la fois fragile et puissante. Le génie porte ici au paroxysme les pulsions les plus obscures et une idéologie tragique et ambiguë de la violence ».7
Comment compenser le manque de technique vocale des « acteurs » quand on aborde l’opéra ? Même si le travail d’Ingrid est empreint de rigueur et de précision, ce qui l’intéresse aussi et qui nous touche dans ses spectacles c’est la maladresse, la faille, l’accident. Les musiciens, les chorégraphes, sont toujours en quête d’une certaine perfection. Ce n’est pas ce qu’elle recherche théâtralement. Je partage avec elle ce sentiment, pour l’avoir vécu, que souvent les répétitions procurent des émotions et des fulgurances qui sont ce qu’il y a de plus beau… Raphaël8, le spectacle qui sera repris cet hiver à Bruxelles, s’inscrit dans cette démarche. L’actrice qui chante La jeune fille et la mort n’a pas la technique d’une chanteuse d’opéra, mais cette fragilité fait partie du jeu et accentue la dimension humaine. Le théâtre surgit aussi de l’endroit où ça casse. Les personnages ne sont jamais tout à fait eux-mêmes. Il s’agit de ne pas se prendre au sérieux. Cette fragilité, ces moments précieux où l’on tente de fabriquer des petits mondes, c’est ce qui est fascinant dans les répétitions… C’est peut-être un des secrets de l’art d’Ingrid von Wantoch Rekowski : comment faire du processus des moments de spectacles. Qu’il y ait de l’humour et que ça grince !
- A‑Ronne II, pièce radiophonique de Luciano Berio d’après un poème d’Edoardo Sanguineti, création en 1996 aux Brigittines à Bruxelles. ↩︎
- Cena Furiosa, madrigaux amoureux et guerriers de Monteverdi, création au festival d’Aix-en-Provence 1999. ↩︎
- Pour l’ensemble de l’œuvre réalisée par I. von Wantoch Rekowski de 1994 à 2016, on se rapportera au remarquable ouvrage coordonné par Yannic Mancel, Musique en corps, édité par Alternatives théâtrales, Bruxelles, décembre 2016. ↩︎
- In H‑Moll, adaptation libre de la Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, création en 2001 aux Brigittines, reprise au théâtre des Martyrs à Bruxelles du 18 au 22 décembre 2018. ↩︎
- Métamorphoses nocturnes, Beursschouwburg, Bruxelles 2002, La Vergine dei dolori, Teatro San Carlo, Napoli, 2003 ; Rubens-Métamorphoses, tableau vivant d’après les œuvres de Pierre Paul Rubens, Anvers, 2004 ; Marguerite, l’âne et le diable, promenade cocasse à travers l’histoire de l’art, Beursschouwburg, Bruxelles, 2004 ; Lorette et monsieur K sur fond bleu, performance à Beaubourg et Ixelles, 2010 ; Impromptus, musée de Cassel (France), 2012 et Bozar (Bruxelles), 2014. ↩︎
- À la recherche du corps wagnérien, quatre ateliers d’après le Ring des Nibelungen de Richard Wagner, Conservatoire de Mons, École de la Cambre, Bruxelles, INSAS, Bruxelles, La Manufacture, Lausanne, 2007/2008. ↩︎
- Ingrid von Wantoch Rekowski, Musique en corps, op.cit. p.40. ↩︎
- Raphaël, les sirènes et le poulet, d’après des duos célèbres, Théâtre National, Bruxelles, 2011, reprise au théâtre des Martyrs à Bruxelles du 26 au 30 décembre 2018. ↩︎