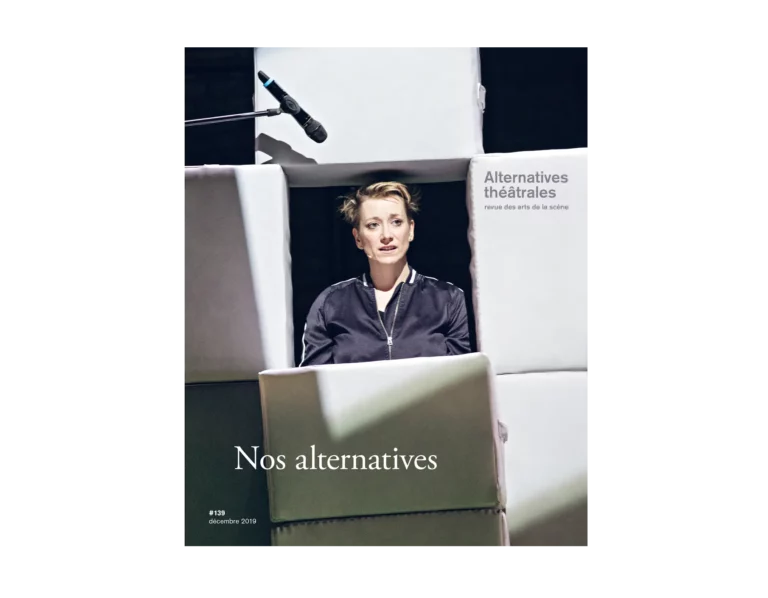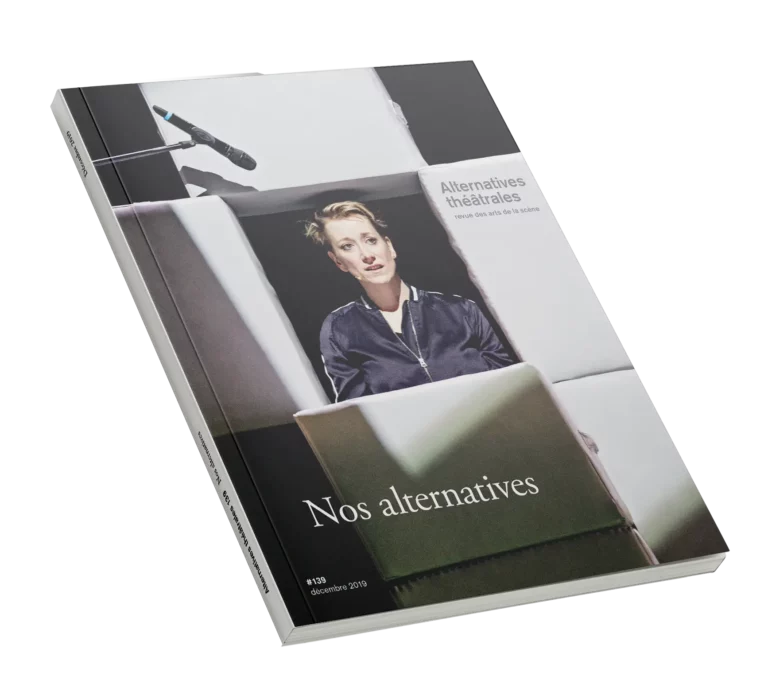« La vie organique du groupe c’est le souffle, l’air… ça entre et ça sort tout le temps, et ça ramène de l’oxygène et des vents nouveaux. »
Réponse d’un membre des Lucioles, lorsqu’en fin d’année 2019, on leur a demandé de parler de la vie organique du groupe.
(par ordre chronologique de réponses)
Que faites-vous ensemble ?
Philippe Marteau
Le collectif permet avant tout de se lancer. Comme un défi irrépressible, d’abord à soi-même et ensuite à l’ensemble : “j’ai envie d’essayer quelque chose avec ce texte, cet auteur.”
Et dans un premier temps, à la marge des institutions, sans disposer toujours de beaucoup de moyens, il est possible de faire exister un nouvel objet. Cela donne de l’encouragement et de la confiance. Et souvent ça marche ! Au-delà de nos espérances. Et c’est ça qui est beau.
Nous nous connaissons depuis 1991 et le regard que nous portons les uns sur les autres est nécessairement profond et complexe.
Il nous arrive parfois de ne pas être d’accord avec ce que fait l’autre. Nous agissons comme une démocratie, rarement avec des votes, mais le plus souvent empiriquement, toujours favorables au développement des projets.
La politique n’est pas au cœur de nos discussions, c’est ce qui se raconte, ce qui se fabrique dans les spectacles qui peut être politique, sociétal. Mais il s’agit principalement de trouver une réponse poétique.
Nous avons été influencés, en plus de nos expériences personnelles, par des maîtres qui la plupart du temps venaient enseigner à l’école du TNB (Matthias Langhoff, Claude Régy, le Théâtre du Radeau, des gens moins reconnus et des acteurs- actrices bien sûr aussi…) et avec le temps le cercle s’est élargi, allant du cinéma au champ littéraire, et plus particulièrement contemporain.
Le collectif permet surtout de prendre son temps, le développement personnel de chacun est primordial. C’est un accompagnement dans la durée, comme une épaule solide.
L’énergie circule. De nouvelles personnes entrent dans le groupe. Des amitiés fidèles se nouent. Des passions se font et se défont. Comme une famille.
C’est toujours aujourd’hui une forme de résistance.

Valérie Schwarcz
Qu’est-ce que vous faites ensemble ?
Quand deux personnes qui s’aiment, pour ne pas dire un couple, se posent cette question, ce n’est pas toujours bon signe ; je dirais qu’après vingt-cinq ans arrive le temps de se poser franchement la question.
Comment vous êtes-vous trouvés ?
Nous étions ensemble dans la première promotion de l’École du TNB et l’évidence a été de rester ensemble. La question du « pourquoi « était moins présente que celle du « comment ». Comment inventer une forme de collectif avec déjà des personnalités fortes et parfois antagonistes, comment résister à la pression et à la tentation de faire émerger tout de suite des individualités…à notre manière assez empirique et ludique, on a réussi cela, un certain temps.
Que refusez-vous ? qu’affirmez-vous ?
Nous avons toujours affirmé la liberté pour chacun d’aller et venir en dehors du collectif et de proposer des projets, de là découlait le fait que nous avons très vite eu plusieurs projets en même temps portés par un.e porteur(se) de projet différent, sans obligation aucune que tous y soient inclus, ce qui a créé du mouvement, mais aussi un mouvement vers la sortie… et parfois une difficulté à nous identifier.
Quels sont vos objectifs ?
Je crois que nous voulions ça, un théâtre en mouvement, une liberté de jeu, expérimenter les places
Comment se prend une décision ?
C’est là où réside notre contradiction, le peu de décisions prises en commun sont d’ordre administratives, ou logistiques…au niveau artistique de plus en plus chacun défend son projet et s’il a les arguments et les moyens de production, on ne discute pas ; ce n’était pas forcément le cas au début mais on a tendu vers ça au fur et à mesure que s’affirmaient les individualités et les choix individuels de faire de la mise en scène. Ainsi on se retrouve maintenant souvent avec plusieurs projets produits par le collectif mais avec des économies et une visibilité très différentes. On peut donc aussi se faire de la concurrence à nous-mêmes, ça peut créer des tensions et des incompréhensions.…
Quelle est la vie organique du groupe ? Qui entre, qui sort ? (comment se vit la
fidélité)
A partir du moment où le collectif est devenu un collectif de metteurs en scène (plus que d’acteurs) et que chacun est dans une logique de distribution, il arrive de plus en plus souvent à tous de travailler en dehors du collectif ; se pose bien sûr la question du désir, et de la fidélité …disons que nous sommes absolument volages mais que nos amitiés peuvent être fidèles…
Quelle est la durée de vie de cette association ?
25 ans c’est déjà formidable, je crois que personne n’est resté sur le bord de la route, chacun s’est affirmé dans ses choix, le collectif nous a rendus plus fort, nous en explorons encore les limites…
Quelle appellation/signature ? collectif, bande, groupe, troupe, ensemble…
Théâtre des Lucioles, collectif d’acteurs
Quelles sont vos influences (théâtrales et non théâtrales ?)
Nous avons rencontré des maîtres à l’école qui nous ont inspiré, des metteurs en scène (Régy, Langhoff, Gabily, Colin) des auteurs et autrices ont marqué nos premiers spectacles (Fassbinder, Copi, Noren, Leslie Kaplan)
Constatez-vous un retour du leader ?
La question du rapport au pouvoir est une question qui finit toujours par se poser au sein d’un collectif, sans parler des pressions de l’extérieur pour en effet identifier clairement un (ou plusieurs) « chef » pour nommer, se référer etc…
Quand on est soi-même plutôt méfiant par rapport aux prises de pouvoir « l’imbécillité essentielle de l’exercice du pouvoir » disait Duras, il est important de se mettre en capacité de ne pas subir ; pour ma part je suis très partagée sur cette place dominante qu’a prise le « metteur en scène » dans le paysage, et ça n’a pas toujours été le cas d’ailleurs… Je pense que l’acteur agissant est responsable de ce qu’il fait et bien souvent au centre du processus de création mais ce n’est guère mis en avant.
Y‑a-t-il une dimension politique à votre démarche collective, un projet politique à affirmer et défendre ?
Ce n’est pas ce qu’on remarque de premier abord, le projet politique, mais le choix des auteurs, autrices, artistes qui nous ont accompagnés raconte quelque chose de notre histoire. Le prisme du politique n’est pas le plus pertinent je pense pour définir notre collectif, parce que notre fonctionnement a toujours été très empirique, ce qui ne veut pas dire que nous n’ayons pas été à des moments très impliqués dans la cité, et auprès de populations très différentes (dans les quartiers, dans les prisons etc…)
Y‑a-t-il une menace à travailler ensemble ?
La menace étymologiquement vient d’en haut, de ce qui fait saillie, comme une épée de Damoclès, le danger viendrait plus de l’intérieur, le danger serait de ne plus avoir de désir, il faut donc travailler à le renouveler sans cesse…
Pierre Maillet
Qu’est-ce que vous faites ensemble ? comment vous êtes-vous trouvés ?
Après l’École du TNB qui n’existait pas avant notre arrivée en 91, la question ne s’est pas posée elle était évidente. Après 3 ans passés ensemble, on ne voulait pas se quitter. Non pas d’un point de vue romantique ou communautaire, mais parce qu’ensemble on savait que quel que soit notre geste artistique il serait plus fort, plus atypique et plus puissant. Même si justement en créant les Lucioles en 94, nous n’avions pas de projet artistique clair à part celui de construire ensemble. La grande particularité de notre rencontre tient bien sûr du hasard puisqu’on ne s’est pas choisis, mais la grande réussite de Christian Colin (notre directeur d’études) dans le choix des élèves a été tout de suite de défendre l’idée qu’un groupe ne pouvait être constitué que d’individualités fortes. Nos différences étaient grandes tant au niveau des âges (les plus grands avaient 28 ans et les plus jeunes 18) que des expériences vécues par chacun. Nous n’avons jamais été considérés comme des élèves mais plutôt comme une troupe d’acteurs réunis pour 3 ans dans un grand théâtre où il fallait tout inventer et construire : une école, sa place dans un théâtre et bien sûr développer nos univers artistiques. Dès le début la notion de simple interprète a été non seulement évacuée mais presque bannie. Du coup en sortant nous étions plus des chiens fous que des acteurs en attente que quelque chose arrive. Nous avons choisi l’indépendance et la liberté sans pour autant vivre en vase clos.
Que refusez-vous ? qu’affirmez-vous ?
Justement je dirais que l’histoire des Lucioles s’est écrite à partir de ce que nous ne voulions pas. A savoir un metteur en scène extérieur qui mettrait en scène le « groupe » type Comédie Française. Ou une troupe avec un chef : à notre époque il n’y avait que ça : Stanislas Nordey, Didier-Georges Gabily, François Tanguy, bien sûr Ariane Mnouchkine… des bandes mais une seule vision artistique spectacle après spectacle. Paradoxalement nous ne croyions pas non plus à la mise en scène collective. Nous ne voulions surtout pas « fermer » le groupe : si nous travaillions ensemble de manière exclusive on se serait séparés au bout d’un ou deux ans (ce dont tout le monde était persuadé à part nous). Bref, encore une fois 25 ans plus tard je pense que de manière empirique, spectacle après spectacle, nous avons défendu et continuons d’affirmer que la confiance du groupe dans la construction individuelle de chacun lui donne une liberté qu’il n’aurait pas tout seul. C’est en tout cas mon cas. Si je dirigeais une compagnie à mon nom, je serais face à des contraintes dont le fonctionnement des Lucioles me libère. Nous sommes tous acteurs, et c’est ça qui nous met tous au même niveau ; mais pour ce qui est de la mise en scène ça me permet de mettre la nécessité au centre. Si je ne suis pas convaincu d’embarquer qui que ce soit dans une création, et bien je n’en fais pas. Je ne suis pas contraint d’en faire une chaque année pour assurer la vie de l’association. Marcial, Élise, Fred, Laurent Javaloyes et moi avons tout de suite été tentés par la mise en scène, les 15 premières années étaient surtout des créations venant de nous quatre, puis Mélanie Leray en a eu envie ; quant à David, Philippe et Valérie ils ont mené leurs premiers projets passé leurs 40 ans. Les Lucioles sont un cadre, un foyer, une « maison » qui permet tout ça. Être à l’écoute de ses propres nécessités, et pouvoir les concrétiser quand c’est le bon moment.
Quels sont vos objectifs ?
Que ça continue.
Comment travaillez-vous ?
Il n’y a pas de « méthode Lucioles ». Chacun invente et/ou développe son chemin. Contrairement à ce que nomme Valérie, je ne dirais pas que nous sommes passés du « collectif d’acteurs » à un « collectif de metteurs en scène ». Je dirais plutôt que rétrospectivement, et toujours aujourd’hui nous sommes un « collectif d’artistes ». C’est un terme un peu pompeux mais plus ouvert et plus juste. Si nous faisons des spectacles de façon pyramidale (metteur en scène, auteur, acteurs, etc…), il y a beaucoup de projets qui sont nés (et qui naissent toujours) de façon différente. Dont la fabrication même définit la particularité de la création, à savoir de très forts désirs d’acteurs qui essaient d’inventer une circulation dans le travail qui se passe de « regard extérieur ». Pour exemples « Copi un portrait » signé par Marcial, Élise et moi ; la longue et belle histoire qui unit Fred, Élise et l’auteur Leslie Kaplan avec pas moins de 4 spectacles à leur actif ; David Jeanne-Comello et le musicien Stéphane Fromentin pour jouer « Le discours aux animaux » de Novarina ; Valérie Schwarcz et Nathalie Pivain pour « Le reflet cannibale » de Nelly Arcan ; la prochaine création de Philippe Marteau sur Édouard Louis et récemment en ce qui me concerne « One Night With Holly Woodlawn » un cabaret réunissant sur le plateau 2 musiciens, 1 acteur/musicien et 1 régisseur général… Nous avons aussi beaucoup mis en scène en duos : personnellement avec Laurent Javaloyes et Mélanie Leray, Élise Vigier avec Marcial Di Fonzo Bo… Ce qui est sûr, c’est que quelles que soient les formes (et même celles apparemment plus classiques dans leur fabrication) elles mettent toujours l’acteur au centre. Qu’il se laisse regarder ou qu’il force le regard, c’est toujours de lui dont il est question. Et le plaisir de jouer. Le plaisir c’est important. Pour moi il est signe de générosité, d’empathie et tout simplement de vie. Là-dessus je pense qu’on est tous d’accord.
Comment se prend une décision ?
« Il faut qu’on se voie, qu’on en parle et qu’on décide ». Souvenir d’une phrase que j’ai dite un jour un peu tendu à Élise, et du fou rire commun qui s’en est suivi… Ceci dit ce n’est pas tout à fait faux.
Quelle est la vie organique du groupe ? Qui entre, qui sort ? (comment se vit la fidélité)