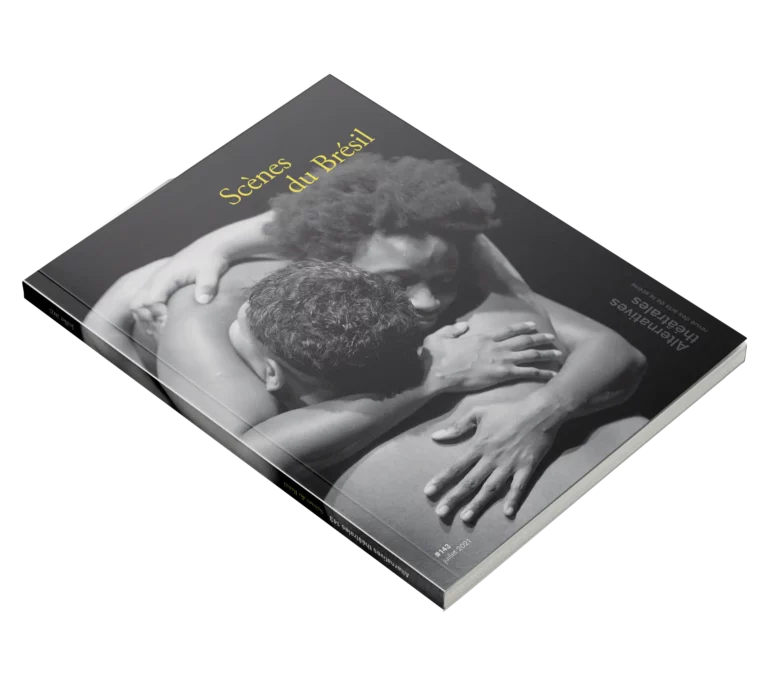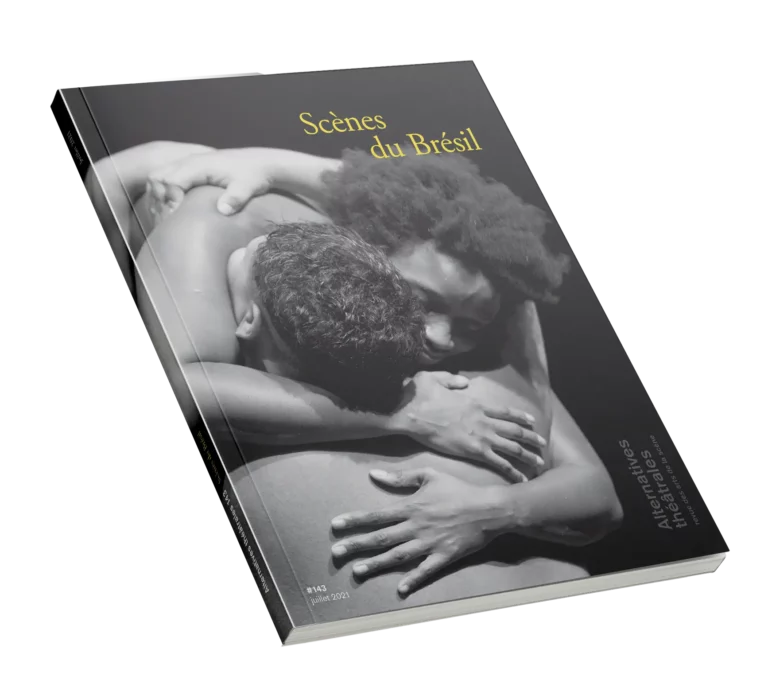À partir du début du XXIe siècle, les créations scéniques brésiliennes ont opéré un glissement vers un engagement résolu dans le contexte social et politique du pays. À mesure qu’avance la première décennie, on observe le retour à un activisme qui a pour ambition de se lier étroitement aux problèmes sociaux, au moyen d’expériences menées en plein essor des combats pour la représentativité et les droits des femmes, des Noirs, des indigènes et de la communauté LGBTQIA+. L’élection d’un président d’extrême droite en 2018 a eu pour effet d’accentuer la mobilisation collective contre les inégalités sociales croissantes, le chômage à des niveaux alarmants, la remise en cause d’acquis des salariés, la corruption endémique, la militarisation des institutions et l’assassinat systématique de groupes marginalisés ou liés à des minorités. La destruction de la forêt amazonienne par déforestation et les incendies criminels représentent une triste synthèse de la mise en crise de diverses instances de la vie sociale au Brésil.
Il est indéniable que cette situation est l’un des principaux moteurs de l’engagement des collectifs de théâtre dans un activisme politique et éthique toujours plus intense, que démontrent leurs interventions dans les quartiers défavorisés et le besoin urgent de penser les conditions sociales de la manifestation de la théâtralité. Les groupes représentatifs de cette démarche sont Pandêmica Coletivo Temporário de Criação, Cia Marginal, As Capulanas Cia de Arte Negra, Grupo Clariô de Teatro, Coletivo Negro et ZAP 18 (Zona de Arte da Periferia 18), pour n’en citer que quelques-uns parmi ceux, nombreux, qui interviennent dans les banlieues de métropoles comme Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo et Belo Horizonte.
Cette tendance n’est sans doute pas exclusive au contexte brésilien, même si elle affiche ici un voltage susceptible d’attiser les tensions entre théâtralité et activisme.1 Analysant une série de manifestations de la période immédiatement antérieure, Claire Bishop détecte un « tournant social » de l’art de la fin du XXe siècle, qui trouve son reflet dans la démarche militante des artistes et dans le rejet de l’esthétique et de la formalisation, remplacées par des interventions auprès des populations défavorisées et sur des modes proches du travail social.2
Même si une telle posture est fréquente sur la scène brésilienne, il y a des expériences fortement inscrites dans le tissu social qui ne remplacent pas pour autant la forme artistique par des pratiques communautaires d’action culturelle. On se rend compte qu’elles préservent la distance entre l’art et la praxis sociale et maintiennent une tension entre autonomie et hétéronomie que l’on peut peut-être appeler une autonomie dissidente.
Ce sont des œuvres à la formalisation instable, caractéristiques d’une scène élargie qui effacent les frontières entre performance, arts visuels, danse et cinéma, tout en incluant des modes renouvelés de théâtre documentaire pour mieux s’engager dans le contexte social.
Les spectacles de Lia Rodrigues et de Christiane Jatahy sont de bons exemples de cette scène élargie. Créées avec leurs collectifs – Lia Rodrigues Companhia de Dança et Companhia Vértice de Teatro – ils représentent une génération d’artistes connue pour des productions qui sont à la limite des cultures, des langues et des arts. C’est une scène qui joue sur les frontières artistiques, esthétiques, géographiques et culturelles. Entre la danse et la performance, le théâtre et le cinéma, le local et le mondial, les œuvres sont étroitement liées à des situations de conflit, mais n’en portent pas moins un certain type de spécificité artistique dans le rapprochement entre théâtralité et réalité.
Soutenir le ciel
La Compagnie de danse Lia Rodrigues, fondée en 1990, a intensifié la puissance politique de ses spectacles à partir du moment où elle est allée s’installer à la Maré, un des plus grands complexes de favelas de Rio de Janeiro, qui réunit seize territoires, pour 140 000 habitants. L’artiste rappelle que son souhait de transférer le siège du groupe correspondait au désir d’expérimenter de quelle façon un « projet d’art contemporain dialogue avec un projet social ». Là où il a lieu, l’acte de créer ne peut pas se restreindre à la production d’une œuvre et il faut trouver des façons d’intervenir, de subsister et d’ouvrir des espaces où l’on puisse le partager. C’est de ce besoin que sont nées les interventions de la compagnie, avec la construction d’un centre artistique, la formation continue à l’École libre de danse de la Maré et la recherche artistique pour le montage des spectacles.3
Les diverses formes d’intervention stimulent la circulation entre la danse contemporaine et le contexte de la favela, remise à jour à chaque nouvelle création. Les résultats sont visibles dans les spectacles créés après ce changement de lieu de création, comme Pororoca (2009), Piracema (2011) et Pindorama (2013) et prennent un tour singulier dans Para que o céu não caia (Pour que le ciel ne tombe pas, 2016), inspiré du livre du chaman yanomami Davi Kopenawa, qui raconte le mythe de la fin du monde. Écrit à partir d’une conversation avec l’anthropologue Bruce Albert, La chute du ciel est le premier récit présentant la voix de la communauté qui peuple le plus vaste territoire indigène du monde couvert par la forêt, entre le nord du Brésil et le sud du Venezuela. Véritable manifeste chamanique contre la destruction de l’Amazonie, il aborde les questions climatiques et la dévastation de la nature selon la cosmogonie amérindienne. Ayant recours aux fondements de la culture yanomami, Kopenawa nous avertit que l’extermination croissante de la forêt et des animaux entraînera une rupture totale de l’harmonie sur Terre. Quand ce temps arrivera, l’esprit des « xapiri », relais du « message codé de la forêt », ne parviendra plus à empêcher que le ciel s’abatte sur tous les êtres vivants de la planète, y compris le « peuple de la marchandise », les indigènes, les arbres et les animaux. Dans la préface de l’ouvrage, l’anthropologue Eduardo Viveiros de Castro note que la lucidité politique et poétique du chaman porte un « discours sur le lieu auquel on appartient, parce que son énonciateur sait ce qu’il est et où il se trouve »4