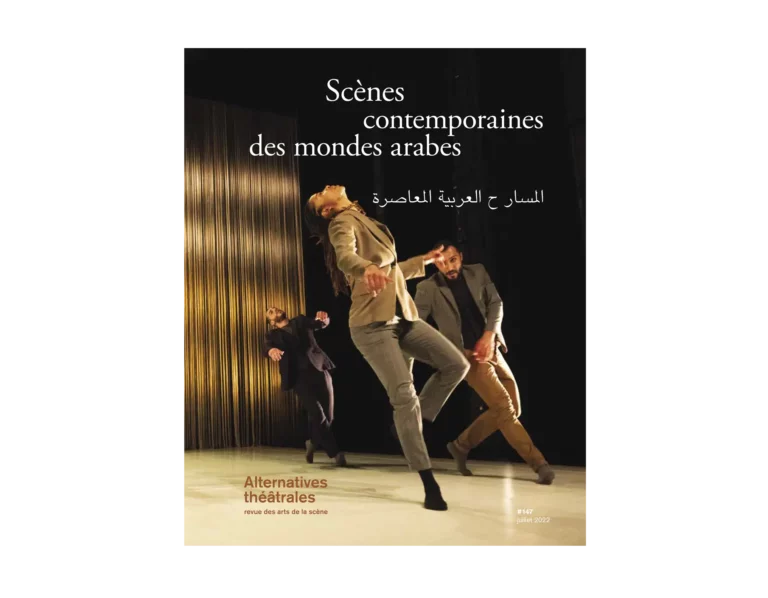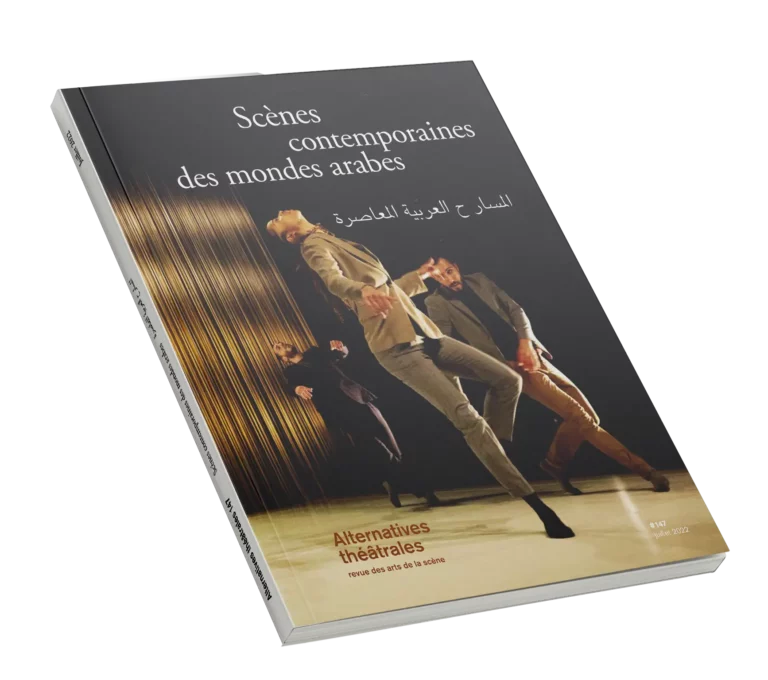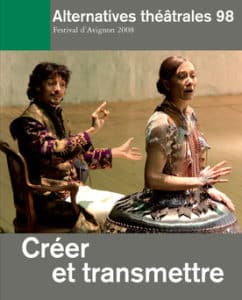Si Sapho est Parisienne depuis longtemps, c’est à Marrakech que la charismatique et mystique chanteuse (également compositrice, poète, écrivaine, plasticienne et comédienne) est née. Pour celle qui affirme qu’on ne se « remet pas d’une enfance au Maroc », c’est une influence constante que l’on retrouve en écoutant l’envoutant J.A.M. (Jalousie, Amour, Mort). Inspiré autant par Shakespeare que par l’Orient…
Elle se définit volontiers comme « juive arabe et franco-marocaine ». Sapho est atypique. Comme artiste d’abord, parce que, de la scène punk à ses reprises de Barbara et Georges Brassens, elle s’est immergée dans des courants musicaux éclectiques sans jamais y perdre son âme. Comme citoyenne aussi, parce qu’elle incarne un cosmopolitisme heureux et la soif intarissable de découvrir d’autres cultures, sans jamais perdre de voix l’Orient originel. « Mes grands-parents parlaient l’arabe, explique-t-elle, mon père a étudié l’arabe classique et la chanteuse libanaise Fairouz était son artiste favorite. Pendant mon enfance, l’arabe et la culture arabe ont toujours été présents. » C’est justement avec les disques Passages d’Enfer et Barbarie, pétris d’influences nord-africaines, que Sapho rencontre le succès au milieu des années 1980. Puis avec Passions, passons en 1985, pétri d’influences judéo-arabes.
Dans ses compositions suivantes, c’est la musique arabo-andalouse qui surgit et des hommages aux chants traditionnels des sheikhates, les chanteuses populaires marocaines. Puis, Oum Kalthoum qu’elle reprend en se passionnant pour l’art du tarab1, cette émotion extatique entre l’artiste et le spectateur, difficile à atteindre, vénérée et recherchée par les grands musiciens orientaux. Mais Sapho c’est aussi Avec le temps de Léo Ferré dans une version en arabe déchirante. Ou encore Orients, joué par un orchestre de Nazareth sur lequel elle convoque des musiciens palestiniens et israéliens. Ce tissage entre l’Orient et l’Occident se niche également dans son écriture. L’artiste écrit en français, mais chante aussi en hébreu ou en arabe : « J’étais trop Marocaine pour être Française et trop Française pour être Marocaine. Entre ces deux cultures, j’ai eu la possibilité de bouger d’un monde à l’autre », analyse-t-elle.
Cette identité mouvante est au cœur de J.A.M., dont le point de départ n’est autre qu’une commande pour une adaptation d’Othello, il y a huit ans, par Razerka Ben Sadia-Lavant. « Elle voulait restituer son atmosphère maure à Othello. C’est pourquoi elle avait fait appel à Mehdi Haddab et moi pour en composer la musique », se souvient Sapho. La chanteuse se passionne notamment pour une troublante réplique de Iago (interprété par Denis Lavant), « I am not what I am », qui lui permet de consacrer une chanson vertigineuse à cette figure du traître par excellence, tout en jouant sur les identités multiples. Elle s’empare aussi de la fameuse Willow Song. Cette ballade de la Renaissance, que Desdémone chante peu avant de mourir, est considérée par d’aucuns comme la chanson la plus triste du monde. Sapho la pare d’une atmosphère un brin celtique, dont l’ambiance et les claviers évoquent cavalcades et paradis perdus.

Plus surprenante, elle s’inspire aussi d’Emilia, la suivante de Desdémone, pour une chanson pleine d’humour, Lalla Imilia. Elle y chante, en darija (l’arabe dialectal marocain) et en français : « Fous-moi la paix le barbu, les hommes tombent sous mes charmes (…) Je suis belle et je suis en vie. » Des paroles dont le double sens n’a bien sûr pas échappé à celle qui les a écrites. « La chanson évoque la jouissance féminine. Je ne suis pas innocente, je sais très bien que cela peut être à double tranchant, mais ce n’est pas agressif », nous explique-t-elle. L’inspiration n’est pas ici directement shakespearienne mais familiale. Sapho s’est souvenue avec malice d’une belle tante, un brin narcissique, à laquelle son grand-père disait de cesser de s’admirer dans la glace… C’est en fu ā (arabe classique) qu’elle interprète comme une incantation L’art d’aimer, de Darwich, qui clôt J.A.M. L’ode à l’amour pleine d’érotisme du poète palestinien sied bien à Sapho, dont la démarche est selon elle « éminemment politique ». « C’est mon histoire, nous raconte-t-elle. J’ai toutes ces influences. C’est également politique. Je persiste à convoquer tous les territoires de ma mémoire et à dire que l’art n’a pas de frontières. Il n’a pas de passeport, il ne demande pas les papiers, il traverse. » Sapho, magicienne des deux rives, construit inlassablement des ponts, quel que soit son mode d’expression artistique. Un exemple parmi tant d’autres : son exposition, aux Beaux-Arts de Tourcoing en 2015, s’intitulait Réparation Islah – Sliha. Islah veut dire « réparation » en arabe et Sliha signifie « pardon » en hébreu.
- Abû Hâmid, Al Ghazâli, Kitâb âdâb as-samâ3 wal wajd (Auditions spirituelles et extase), traduit et annoté
par Hassan Boutaleb, éditions Albouraq, Beyrouth, 2012, p.116. ↩︎