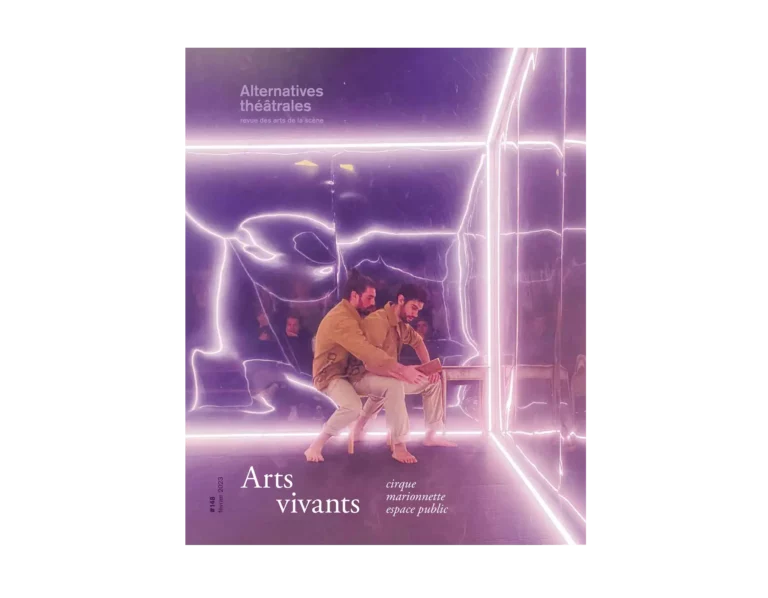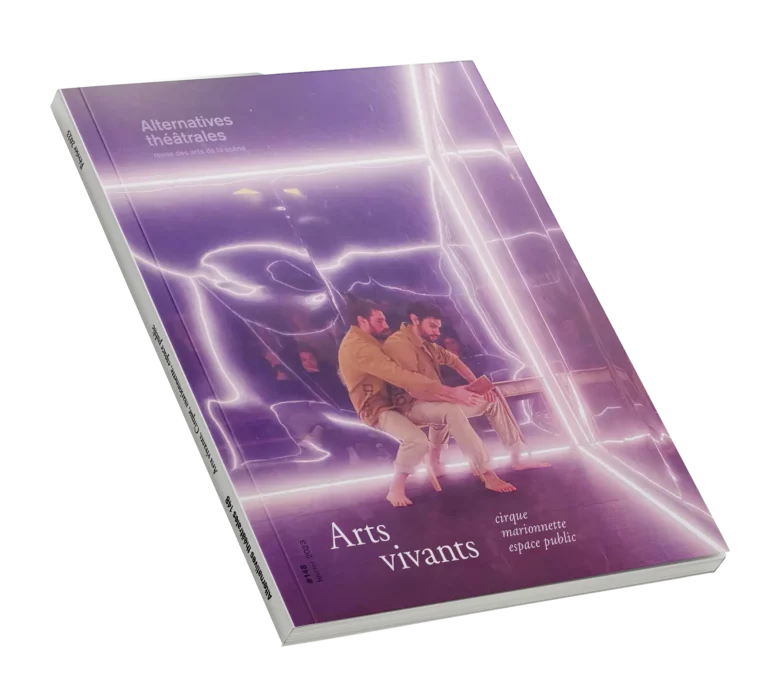Gwénola David, « Arts de la rue », in Laurent Martin, Vincent Martigny, Emmanuel Wallon (dir.), Les Années Lang. Une histoire des politiques culturelles, 1981 – 1993, Paris, La Documentation française/Comité d’histoire du ministère de la Culture, 2021 p. 411 – 414. © Collection du Comité d’histoire du ministère de la Culture/Direction de l’information légale et administrative, Paris, 2021.
À l’orée des années 1970, la France voit fleurir des événements artistiques et festifs au-dehors des institutions culturelles, dans des lieux publics, des espaces extérieurs ou d’autres locaux. Le mouvement des « arts de la rue » va peu à peu se constituer artistiquement et professionnellement, devenir un secteur à part entière et appeler à la mise en place de politiques publiques pour structurer son développement. Portés par l’élan libertaire soixante-huitard, des saltimbanques prennent la rue pour espace libre d’expression contestataire et chahutent les autorités artistiques qui tenaient le spectacle dans des formes bien cadrées à l’abri respectable de l’institution. Ces artistes autoproclamés fuient l’entre-soi bourgeois, brisent le quatrième mur et déboutonnent le corset de la culture légitime pour créer comme il leur plaît. Ils osent à tout-va, bricolent des expérimentations rebelles à tout encartage disciplinaire, descendent dans les quartiers et s’adressent directement aux gens du quotidien qu’ils alpaguent au vol, ou bien rassemblent des foules pour célébrer le plaisir d’être en commun. Le Palais des Merveilles, le Footsbarn Travelling Theatre, le Théâtracide ou encore le Théâtre de l’Unité, plus tard Oposito, Royal de Luxe, Ilotopie… ouvrent des chemins buissonniers qui mènent vers de nouvelles expériences esthétiques et ludiques à la croisée des genres.
Le phénomène n’est pourtant pas une résurgence des manifestations festives qui, depuis le Moyen Âge, avec ses bateleurs de foires, ses baladins de carnavals et ses mystères sur les parvis d’églises, transformaient la ville en scène ouverte. S’il fouille volontiers l’imagier des traditions forai-nes, il s’origine plutôt dans les marges d’un théâtre en crise, où s’activent dès les années 1960 des artistes en rupture de ban académique, et il profite des éruptions inventives de Mai 68 pour descendre dans la rue et se manifester au grand air. L’Agit-prop, le happening, les avant-gardes venues d’ailleurs, de Jerzy Grotowski à Tadeusz Kantor, du Living Theatre au Bread and Puppet Theatre, avaient déjà tranché radicalement avec les conventions, attirant les jeunes générations, notamment au Festival mondial de théâtre universitaire de Nancy alors dirigé par Jack Lang. Le mouvement des arts de la rue s’inscrit aussi dans la crise urbaine, sociale et politique de l’époque. Par l’intervention dans l’espace public, la gratuité et l’interpellation comme mode d’expression, il entend s’engager dans la vie sociale et riposter au fonctionnalisme de la planification urbaine, qui bétonne la société et standardise l’existence. Durant la décennie 1970, les collectifs sont de plus en plus nombreux à prendre la route. Ils investissent les réseaux d’animation culturelle à l’appel de municipalités préoccupées de vivifier leurs centres historiques et de renforcer la sociabilité des espaces nouvellement construits. Ils se retrouvent lors de grands rassemblements qui agrègent leur profusion désordonnée et cristallisent la représentation de cette mouvance artistique : notamment pour Aix ville ouverte aux saltimbanques, organisé en 1973 par Jean Digne, alors directeur du Théâtre du Centre d’Aix-en-Provence, l’École d’été, commencée à La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon en 1975 et poursuivie par Les Ateliers publics d’art et spectacles d’inspiration populaire à Manosque, en 1978, Diable à Padirac, en 1977, ou encore La Falaise des fous, en 1980, qui attire à Chalain (Jura) quelque 230 « Saltimbanks réunis » autour de Michel Crespin, fondateur de Théâtracide, avec le soutien de subventions publiques.
Une institutionnalisation progressive et paradoxale
C’est au tournant des années 1980 que s’engage la lente institutionnalisation de ce mouvement disparate où se côtoient plasticiens, « cogne-trottoirs », théâtreux, bonimenteurs, circassiens et autres inclassables. Les premières rencontres d’Artistes d’espaces libres, organisées en 1981 par Michel Crespin et Fabien Jannelle, directeur de la Ferme du Buisson, Centre d’action culturelle de Marne-la-Vallée, s’inspirent de La Falaise des fous et annoncent l’ouverture en 1982 du Centre international de rencontre et de création pour les pratiques artistiques dans les lieux publics et les espaces libres – Lieux publics, qui ambitionne de devenir un outil de création sur le modèle d’un Centre dramatique national. Il est subventionné l’année suivante par la Direction du développement culturel (DDC) du ministère de la Culture, pilotée par Dominique Wallon. C’est par la brèche d’un projet relevant d’un champ « hors discipline », via une sous-commission « Innovation », que se fait l’intrusion dans l’enceinte de la rue de Valois, contournant ainsi la place forte tenue par le théâtre. Le ministère Lang suit la vogue de ces spectacles hors les murs qui sert sa politique de développement culturel visant à répartir les moyens sur l’ensemble du territoire, jusqu’aux zones rurales et périphériques, à élargir le champ culturel à de nouvelles expressions et à démocratiser l’accès à l’art… tout en partageant le gout de la fête.
Lieux publics déploie son action sur la réflexion, la formation, la documentation et la diffusion. Il contribue activement à la constitution d’un secteur encore flou, en organisant les Rencontres d’octobre de 1983 à 1987, qui mêlent débats et foires aux projets, et en publiant dès 1985 le Goliath, premier guide-annuaire des artistes et des opérateurs culturels « pour la création et l’animation dans les lieux publics », définissant ainsi le contour de ce qui deviendra une profession. Il lance aussi Éclat, premier festival européen de théâtre de rue, à Aurillac, en 1986, avec le soutien de la Direction du théâtre et des spectacles du ministère de la Culture, sous la houlette de Robert Abirached, qui souhaite privilégier la dimension artistique sur l’animation.