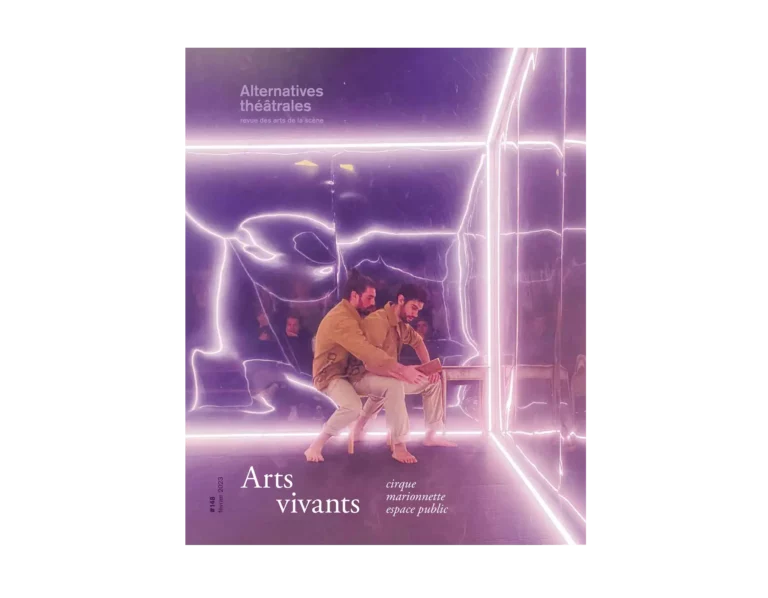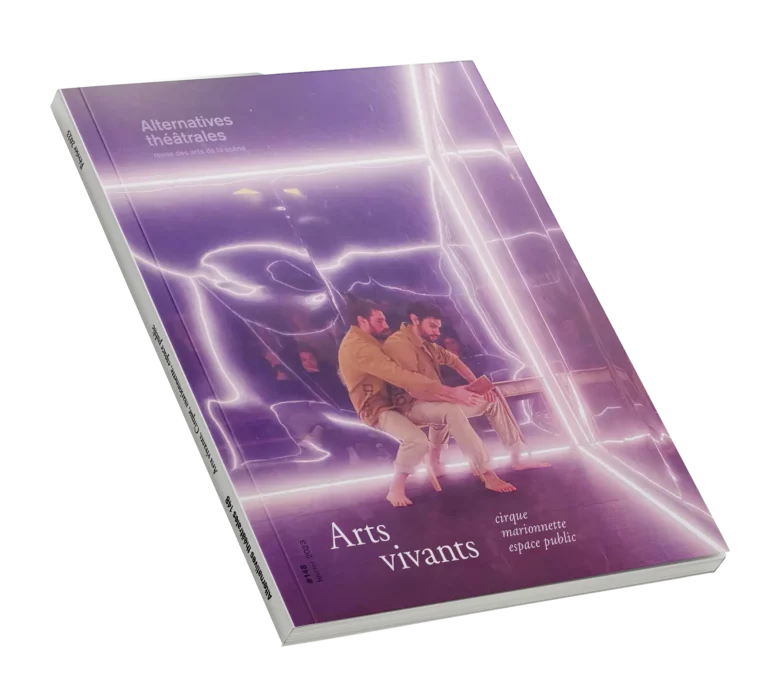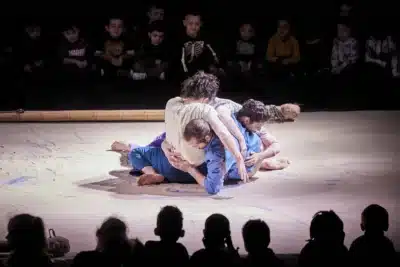Quel est ton parcours ?
Comme plein de gamins, je montais aux arbres : la suite a prolongé certaines de ces petites choses d’enfance. J’ai découvert l’univers circassien assez tard, comme un monde où l’on peut aussi crapahuter, et je suis partie faire une école de cirque sans rien connaître du spectacle et du métier que c’était. J’y ai appris à faire du trapèze, mais je n’aimais pas ça et j’ai cessé d’en faire dès ma sortie. C’était plutôt la situation de contrainte qu’il proposait qui m’intéressait : j’ai continué à travailler sur les notions de haut/bas ou de risque. J’ai fini par comprendre que le cœur de mon travail était d’étudier cette simple situation d’être suspendue au-dessus du vide, pendue à bout de bras à quelque chose. Le spectacle emblématique de ce tournant est Horizon (2013) : un solo très épuré sur une courbe, sans son et sans lumière.
Quel chemin t’emmène du trapèze à la ligne de suspension ?
À la sortie de l’école, avec Mélissa Von Vépy (Cie Moglice-Von Verx), nous avons fabriqué nos propres supports de suspension, avec des barres qui n’étaient pas les barres classiques d’un trapèze. Nous avions fondé la possibilité de ne pas subir l’élément déjà existant, tel qu’il est. Plus tard, j’ai fait une performance avec le peintre Guillaume Bruère : je le voyais travailler sur une grande feuille de cinq mètres et ça m’a donné envie de cheminer moi-même sur des lignes immenses, ce que j’ai pu faire à Reims sur quarante mètres de long. J’ai compris que je pouvais choisir des dimensions et des espaces de suspension différents : la barre de L’Oiseau-Lignes est un chemin qui se brise au fur et à mesure, celle d’Horizon est un tout petit espace très contraint. Le mot « trapèze » m’enferme car il désigne un objet précis, alors qu’en parlant de lignes je m’ouvre à un monde beaucoup plus large.
Que provoque la suspension ?
C’est comme se poser une question, sans qu’une réponse ne nous fasse redescendre : la suspension touche à l’intranquillité. Elle nous met dans un puissant état d’acuité pour s’ouvrir à tout ce qui a lieu, de la plus infime sensation à l’intérieur du bras à tel changement de lumière, de souffle ou de température. C’est un moment qui dissout toute forme de langage et de pensée, comme lorsqu’on se découvre agir dans l’urgence. Ma pratique fait aussi mal aux mains, ce qui donne envie de descendre et alimente la peur de ne pas aller assez loin dans la suspension ou celle de brutaliser son corps. Accepter l’intranquillité, ce n’est ni fuir ni résister mais observer la sensation qu’on est en train de traverser, en étant libre de continuer ou de descendre. Quelque chose se clarifie, on voit mieux ce qui a lieu. J’ai beaucoup travaillé autour de pratiques de l’attention et d’arts martiaux : durant la suspension, je suis simplement attentive à ce qui se passe, j’observe mes inspirations et expirations, ce qui tient, ce qui lâche, et toute notion de figure (acrobatique) m’est devenue étrangère.
Que signifie retirer la figure ?
J’ai retiré la nécessité de jouer l’artiste-créatrice : je n’ai plus le souci de satisfaire l’attente du public qui veut que je fasse une figure. Je réfute l’idée d’un artiste qui produise des œuvres ex nihilo, tel un dieu créateur, qui est un imaginaire très masculin. Il y a un autre rapport au monde, enfoui et dévalorisé, qui consiste à cueillir ce qui existe déjà : épouser le mouvement de la création présente autour de nous, en prendre soin et la nourrir. Je veux jouer le jeu du vivant.
Quelles sont tes sources d’inspiration ?
J’ai vécu dans des endroits assez éloignés des lieux culturels et j’ai fait grandir ma pratique avec des livres. J’ai interrogé Étienne Klein sur la gravité, David Le Breton sur la douleur dans le travail et récemment Camille Froidevaux-Metterie sur le corps des femmes. Les ouvrages de Vinciane Despret, Marielle Macé ou Emanuele Coccia m’ouvrent des portes vers de nouvelles questions et positionnements.