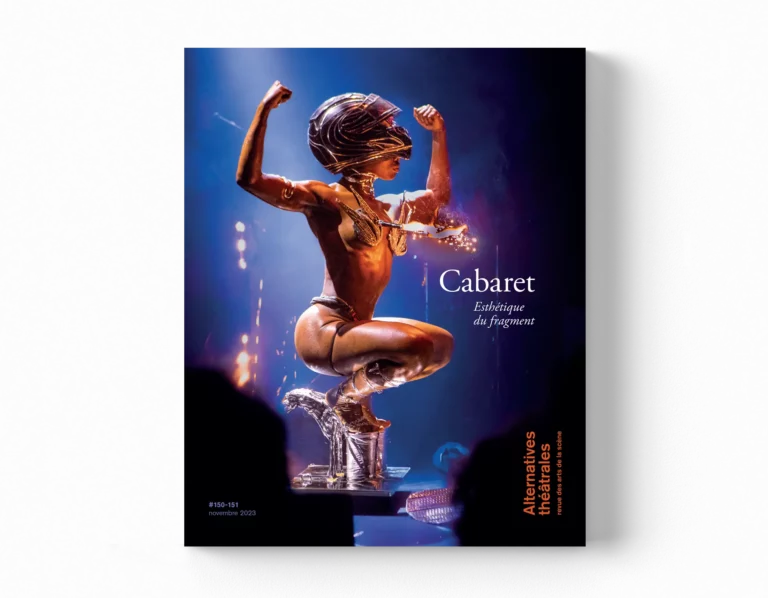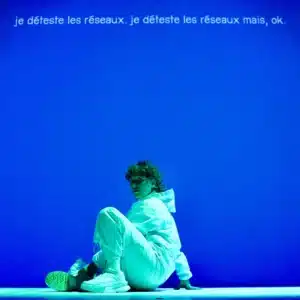Sara Selma Dolores et Bastien Poncelet sont performers de cabaret en Belgique, en France. Avec Charivari, leur création commune, iels investissent les rites carnavalesques du Moyen Âge, dans une dynamique de « requeerisation des folklores ».
Leur Charivari fait territoire et phosphore à travers des ateliers, des happenings en rue, ou en espaces institutionnels (Centrale La Louvière, Halles de Schaerbeek). Pour Alternatives théâtrales, nous discutons étymologie du cabaret et morales contemporaines.
Sara Selma Dolores : Tout d’abord, je veux revenir au sens premier, à l’origine du mot cabaret : « Petite chambre, terme attesté au picard wallon, restaurant bon marché. » Le cabaret, c’est avant tout un lieu de communion : ce sont des corps ensemble, des corps ouvriers, serrés dans des odeurs d’oignons, de poudre bon marché. Le cabaret est aussi lié à la pratique de la boisson, d’aller dans la nuit, d’être ivre ; c’est historiquement un lieu d’interdits, tu y vas quand tu as une gueule cassée et que tu as besoin d’oublier quelque chose. Le cabaret, c’est clairement un autre rapport qu’au théâtre. Il n’y a pas de quatrième mur, pas de distance. Nous avons en face de nous des spectateur·ice·s non captif·v·es, qui boivent une bière et ont droit à l’inattention.
Qu’est-ce qui te plaît le plus dans le travail de cabarettiste ?
Sara Selma Dolores : Le rapport à l’imperfection. Au cabaret, ce sont des tentatives qui avortent. Je vois le « faux », et derrière ce faux, le vrai performer qui transpire. Je vois que tout est faux, et parce que c’est faux, ça m’excite ; cela donne la possibilité d’un accident avec le public. J’adore.
C’est quoi « vos trucs » pour créer du lien avec la salle ? Y a‑t-il une limite que vous ne franchissez jamais ?
Bastien Poncelet : Le cabaret fonctionne au présent, comme un miroir de la société ; dans mes numéros, je vais titiller ce qui traverse l’époque, des questions d’actualité, liées à l’identité notamment. Mais très vite, je me pose la question de la limite : qu’est-ce que j’ai le droit de dire ou pas ? Et cela dépend vraiment de qui est en face de moi, et de comment cette personne va recevoir ce que je viens de déposer sur scène. En cinq ans, je sens qu’il y a des sujets abordés ou des actions qui ne sont plus acceptés par le public : comme mon numéro « La Claque » (sur une musique de bagarre), où je gifle quelqu’un dans le public à un moment donné de la chorégraphie. Même s’il y a toujours eu un accord tacite avec la personne sélectionnée dans le public, quelque chose qui se joue dans le regard, je n’ai plus le droit de le faire, car cela soulève la question du consentement.