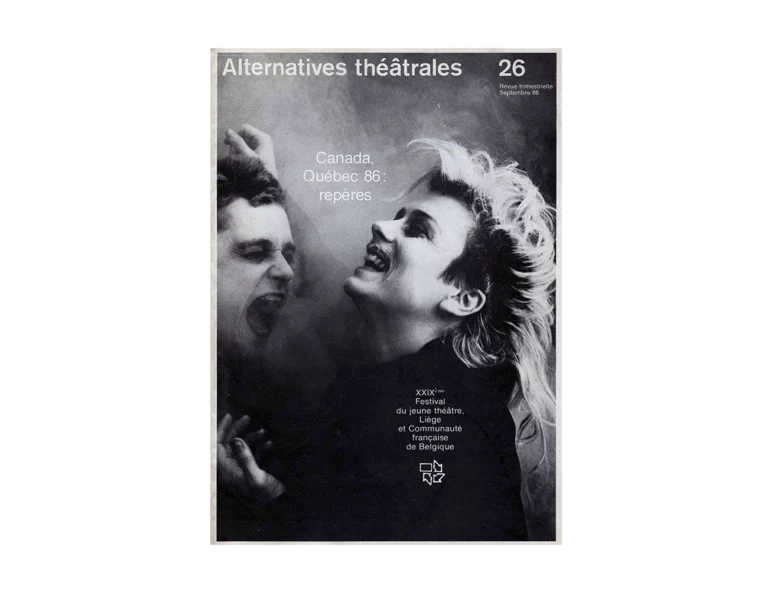Bernard Debroux : Pourrais-tu expliquer l’histoire de cette écriture et de ce texte. Comment est-il arrivé sur la table de travail du Théâtre varia ; comment as-tu été amené à le monter, quels types de relations y‑a-t-il avec l’auteur Paul Emond qui n’est pas un écrivain de théâtre. Comment se fait-il qu’il ait écrit cette pièce
Philippe Sireuil : L’histoire de cette pièce commence avant même que l’idée n’en jaillisse. Elle s’inscrit dans mon souhait de générer une écriture dramatique autochtone contemporaine en conviant l’écrivain sur la scène d’où la tradition bourgeoise l’en avait chassé. Molière, Shakespeare ou Brecht étaient au centre du théâtre. Tchekhov, via Olga Knipper ou Stanislavsky, aussi. En France, aujourd’hui, des gens comme Michel Deutsch, Bernard-Marie Koltès, Bruno Bayen ou Michel Vittoz, sont en contact étroit avec le plateau. Il en est de même ici avec Michèle Fabien. Ecrire une pièce, ce n’est pas seulement maîtriser un art littéraire, c’est aussi appréhender le rythme si particulier de la narration dramatique, le corps et l’imaginaire de l’acteur, la nécessaire autonomie de la scène. Et ceci ne peut se faire qu’au travers d’une pratique du théâtre. Les expériences antérieures, l’une insatisfaisante avec Roland Hourez et Le terrain vague, l’autre plus productive avec Jean Louvet et L’homme qui avait le soleil dans sa poche, m’ont, à dire vrai, montré que le premier à convaincre de cette évidence est souvent l’écrivain lui-même. La pièce est née d’un aveu. Paul Emond m’avait un jour confié sa fascination, mélange d’effroi et d’intérêt, devant la façon avec laquelle, d’après lui, je m’emparais des textes que je mettais en scène. Je connaissais son œuvre romanesque ; elle m’intriguait. J’ai pensé qu’il fallait nous offrir le moyen de mieux nous connaître, un terrain où se rencontrer, et je lui ai proposé l’écriture d’une pièce. Il a d’abord refusé, par crainte non pas d’être vampirisé, mais bien plutôt d’être confronté au dialogue, à la situation dramatique, bref, au théâtre qu’il ne connaissait jusqu’alors qu’en tant que spectateur assidu et souvent morfondu. Le désir fut finalement plus grand que la peur et il accepta.
Le projet était le suivant : il écrivait une pièce et je m’engageais à l’inscrire à l’affiche du Théâtre varia si nous jugions tous deux le résultat satisfaisant. Aucune autre condition, si ce n’est celle d’établir une distribution de moyenne importance afin d’en rendre économiquement la création aisée. Je lui laissais le choix de la thématique, à un souhait près : que le texte traite de l’angoisse. La demande était aussi simple et vague que cela. Quelques mois plus tard, Paul me donnait un premier jet : un manuscrit d’une vingtaine de pages intitulé Une dernière comédie. Le texte était déjà riche des germes qui allaient éclore par la suite, mais il allait falloir les faire pousser. Paul se remit au travail. Vint ensuite une deuxième esquisse, baptisée Les illuminés. Puis une troisième. À la quatrième, la pièce trouva son titre actuel, Les pupilles du tigre. Neuf étapes en tout furent nécessaires pour parvenir à l’état du texte lu en mars 85 successivement à Liège, Bruxelles et Paris.
« Ils ne savent pas combien l’exigence est extrême » : c’est une des répliques de la pièce. Avec le recul, je la juge prémonitoire. Les lectures faites avaient révélé des manques, d’autres hypothèses (elles avaient été programmées pour ça). Le report du spectacle, initialement prévu en septembre 85, nous permettait de nouvelles audaces, et après avoir laissé le texte en repos quelques semaines, Paul reprit sa plume et rédigea alors une dernière version sensiblement remaniée : celle que nous répétons aujourd’hui.
Ecrire dans la solitude du cabinet de travail, c’est commettre un geste d’une extrême impudeur. Le faire à découvert, alors que l’écriture est un chantier, sous le regard complice mais constant d’un ou de plusieurs lecteurs, c’est plus impudique encore. Paul Emond a pourtant suscité et souhaité cette position inconfortable : celle de voir son travail remis en cause au fur et à mesure qu’il progressait, d’abord par les notes critiques et commentaires que Jean-Marie Piemme et moi-même lui adressions, ensuite par les propositions de tel ou tel acteur. C’est un écrivain d’une rare intelligence, faite d’une humilité attentive et d’une puissante subjectivité littéraire. Jamais il ne s’est départi de son écriture — personne ne souhaitait qu’il le ft — jamais non plus il ne s’est fait sourd aux échos que nous lui transmettions. Aujourd’hui encore, les répétitions étant entamées, il se montre très à l’écoute des questions que pose le travail de la scène — de l’idéologique absolu au pragmatisme le plus plat. Le paradoxe est qu’il le soit plus que les écrivains avec qui j’avais travaillé précédemment et qui, eux, étaient coutumiers du fait théâtral. C’est une première pièce, rappelons-le. Je puis d’ores et déjà dire que d’autres suivront.
B.D.: Quand on lit la pièce, en tout cas dans l’état où je l’ai reçue qui est pratiquement le dernier état avant les répétitions, on est frappé d’être en présence d’une fable relativement précise. On n’y est plus habitué. Les auteurs contemporains ont de plus en plus quitté la fable ; ils travaillent par fragments juxtaposés au sein d’un fatras imaginaire très vaste, où le spectateur éprouve des difficultés à se retrouver et où l’acteur s’épuise parfois sans résultats à habiter et faire vivre le texte. lci, il existe une fable avec une histoire assez précise, une narration, un exposé progressif de la psychologie des personnages, de ce qui les habite, une action, presque un suspense, et un dénouement. En même temps, on se trouve — et c’est là me semble-t-il que les problèmes doivent se poser au metteur en scène — devant un texte extrêmement riche, à lectures multiples.
Il est d’abord métaphorique : on nous raconte l’histoire du théâtre, elle est sans cesse présente, en référence. Il s’agit par ailleurs d’un texte à dimension philosophique, sorte de réflexion sur le sens de l’existence aujourd’hui pour des personnages vivant dans un monde en train de disparaître ; ces indications sont données dès le départ par dix lignes définissant l’espace et le lieu. Enfin, il y a les références au quotidien, au politique, à l’histoire (« Il est minuit, docteur Mengele »). Pour jouer un tel texte, il suffit au départ de suivre la fable. Mais, pour la nourrir, il faut opérer des choix.
Lesquels as-tu suivis ?
L’écriture de Paul Emond me semble être, dans ce sens, un fameux défi. Si, comme tu l’as dit, il est un écrivain averti de la chose théâtrale, il est aussi un écrivain doué d’une très forte subjectivité, se déployant dans un univers d’écriture très construite, saturée de sens et de forme. Confronté au théâtre, on se rend compte que l’auteur à dû réaliser tout un travail de concrétisation. Les percées dans l’imaginaire sont toujours articulées sur des faits de spectacle qu’on imagine pouvoir être exploités.
Le samedi 13 septembre à 17 h, sera organisée au Théâtre de la place une rencontreldébat sur le thème : écrire pour un théâtre aujourd’hui, en présence de Paul Emond, de Jean-Marie Piemme, de Philippe Sireuil et des comédiens du spectacle