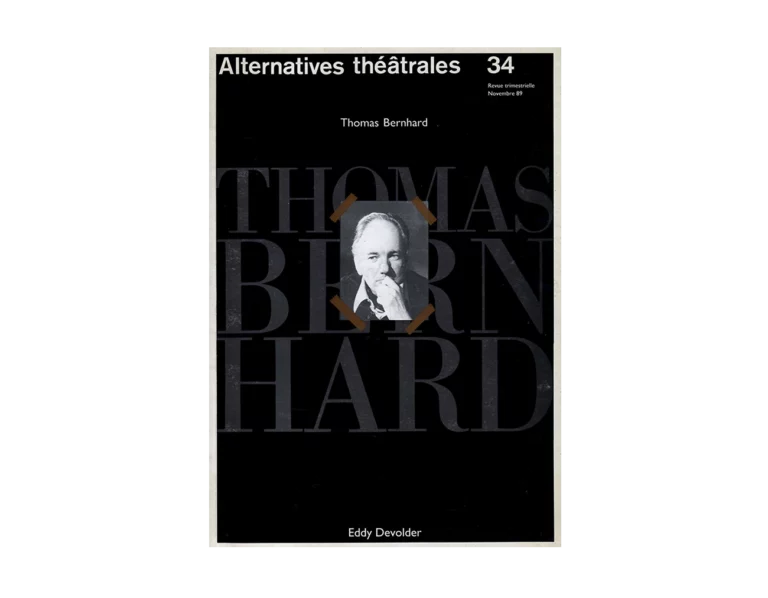TOUT le théâtre de Thomas Bernhard représente Thomas Bernhard et chaque pièce est un résumé de cette représentation.
Livrés sans ponctuation comme des traits de pensée, les textes sont écrits en colonne, à l’image de poèmes ; les tirades livrées au souffle, au rythme de l’acteur, définissent les limites de son interprétation. Pour le reste, le comédien est une marionnette, l’exécutant d’une musique, d’un ton, car tout est question de ton, tout ne tient qu’à un fil dans ce théâtre où le premier acteur, le premier sujet, le premier interprète est la verbalisation. C’est un théâtre du langage mis à nu. Un théâtre des êtres déconstruits par ce qu’ils disent. Plus ils parlent, plus ils se dépouillent. Le langage défait ce que nous sommes. Il a raison par-delà les êtres.
Entre les différents personnages, c’est toujours une épreuve de force qui oscille entre la vie et la mort, l’art et la maladie. En dépit de l’apparente banalité des propos, l’atmosphère est d’emblée lourde et les questions tombent toujours autour de la fatalité, du destin, du pouvoir de transformation avec lequel les personnages sont aux prises.
« Au but » ne déroge pas à cette forme.
A la veille de partir en villégiature annuelle à Katwijk, une mère et sa fille vont applaudir au théâtre le succès d’un jeune auteur. C’est ainsi que la mère invite ce dernier à les accompagner quelques jours au bord de la mer.
Rapidement, la mère se reproche son étourderie, avoue sa répulsion pour le théâtre, lancée dans un monologue où ressurgissent les éléments d’un passé qui donnent son épaisseur à l’histoire. La fille, présente depuis le début, fait pâle figure comme si elle n’était que l’instrument ou le fantomatique faire-valoir d’une mère vis-à-vis de laquelle elle se montre entièrement soumise et inféodée, formant ainsi un couple asservi à la monotonie de la répétition stérile, au ressassement.
Depuis longtemps, leur histoire est écrite, jouée. Depuis longtemps, elles sont condamnées, à moins qu’un changement n’intervienne. D’où l’invitation lancée à l’auteur de théâtre, lequel incarne l’épreuve, le loup dans la bergerie, l’homme qui menace l’équilibre fragile sur lequel repose la relation mère/fille. Avec lui, la menace entre dans la danse ; sa présence au sein de la pièce de théâtre, lui qui par principe ne devrait pas se montrer, risque de faire basculer la trame de l’histoire qu’il a amorcée malgré lui. « Au but » pourrait bien être synonyme de « Le festin d’un vampire ».
Le titre évoque une cible, un objectif à atteindre. (Une fois le but atteint, affirme la mère, tout se renverse. Le monde bascule. C’est littéralement la révolution par opposition à la répétition). La révolution, c’est-à-dire une interruption et une fin : du point de vue de la temporalité mais aussi du point de vue de la perception de l’espace. L’une des origines prêtées au mot « but » remonterait à la langue des francs et signifierait originellement le « billot » sur lequel le condamné à mort se voyait trancher la tête.
Tant qu’à jouer avec les mots, la Hollande où l’action se déroule, ce n’est pas seulement le pays creux, caverneux, c’est aussi le pays qui fait tourner la tête.
L’action se déroule à Katwijk, littéralement le hameau ou le bourg du chat, station balnéaire située à environ 20 km de la ville universitaire de Leiden et à plus ou moins 40 km d’Amsterdam et de Rotterdam.
Quatre personnages se partagent les rôles.
Peu d’accessoires dans le théâtre de Bernhard. Ici, une malle ; elle contient d’une certaine façon toute l’histoire de la mère. C’est sa boîte à Pandore. C’est aussi le seul objet qu’elle a apporté à la communauté le jour de son mariage. Elle l’a héritée cette malle de son grand-père, lequel était clown. Au moment de l’héritage, cette même malle contenait également une couverture de cheval (à l’image de la couverture de cheval dont s’entourait tous les matins le grand-père de Thomas Bernhard lorsque celui-ci se rendait à son bureau pour y écrire).
Ce bagage tressé, renvoie également au berceau de Richard, son fils mort à deux ans et demi. Tout se passe ici, comme si les éléments en osier recueillaient les choses mortes.
A l’analyse, le texte de la pièce se lit comme un faisceau de références. Deux exemples parmi tant d’autres : l’un renvoyant à l’œuvre, l’autre à la biographie. 1. La mère témoigne d’une répulsion pour le théâtre analogue au général dans « La société de chasse ». 2. L’auteur mis en scène est, à l’instar de Bernhard, né à Heerlem et mis en nourrice à Rotterdam. De même que Bernhard, l’auteur joue du violon. Les exemples abondent au point que la pièce n’est rien qu’une abondance d’exemples liés entr’eux par la trame de l’histoire.
Chaque tirade répond à une autre tirade de l’œuvre, moins comme un clin d’œil ou un écho, plutôt comme une suite de signaux de lumière, de fanaux, d’une œuvre à l’autre pour former une conjonction à l’image des étoiles au ciel.
Les personnages
La mère : il s’agit d’un être abusif, possessif. Sortie de rien, analphabète, elle avoue être née dans une auberge.
Les auberges ne sont pas sans jouer une certaine importance. C’est d’abord le lieu où son grand-père, meurt. C’est enfin dans une auberge qu’elle rencontre son futur mari. Analphabète au moment où elle le rencontre, elle apprend rapidement à écrire, à lire, à calculer. Elle devient une femme d’addition et de soustraction, une femme de chiffres et de précision, une femme de calculs, — à plusieurs reprises elle l’affirme — de sorte que cette insistance permet de supposer que d’avance elle connaît le déroulement des choses.
Les chiffres : Bernhard accorde une extrême importance à la valeur et au symbolisme des nombres. Ici, la pièce fonctionne selon une bipolarité. Le chiffre deux est le chiffre de « Au but », non seulement, la pièce est composée de deux parties, de deux temps, mais les choses procèdent par couple : la mère et son mari d’abord, la mère et la fille ensuite. Lorsqu’elle épouse l’homme qu’elle rencontre dans l’auberge, celui-ci l’a doublement attendrie en évoquant la fonderie qu’il possède et la mort de ses parents entre Bologne et Florence.
Cet homme est doublement propriétaire : il gère une fonderie en ville à laquelle il s’identifie. Cette fonderie est le lieu de fusion par le feu. Il possède également une maison au bord de la mer bercée par le flux et le reflux, laquelle deviendra le domaine de la mère. De la même manière, la Hollande peut être mise en opposition avec l’Italie. La mère aura également deux enfants : un garçon, l’enfant du père et une fille qui sera son enfant. De cette configuration première, de ce mariage, que peut-on dire sinon que c’est le mariage de l’eau et du feu dont émane d’abord un sentiment de sécurité, le temps pour la mère d’asseoir son pouvoir. Une fois mariée, elle prend l’ascendant sur son mari d’autant plus vite qu’il s’agit d’un être défaitiste, apparemment résigné, sans raffinement, qui ne lit que les contes d’Andersen et, comble d’ironie pour un fondeur, lit uniquement « La petite fille aux allumettes ». Cet homme, elle ne cessera de le tracasser, de le harceler. En fait, elle ne partage rien avec lui ; elle empoisonne son existence au même titre qu’elle à empoisonné le chien qu’il désirait. Lui répond toujours : « Tout est bien qui finit bien ». Cet homme n’est qu’une fonderie aux yeux de la mère ; une fonderie anarchiste qui rêve de faire sauter le palais royal alors que ce n’est rien d’autre qu’une fonderie sur le point de cesser son activité. D’ailleurs la mort l’environne : tout ce qui touche au mari touche à la mort. Il voulait un fils : il naît vieux et meurt à deux ans et demi. C’est, dit la mère, une erreur de calcul ; ce fils dont elle désire la mort.
Longtemps caché, ce fils décède dès l’instant où elle s’apprête à le montrer.
La mort de Richard ainsi appelé par hommage à Wagner, annule les visites au cimetière que chaque semaine le mari rend sur la tombe de sa famille.
Après la mort de l’enfant, elle se refuse à lui, se cloître dans sa chambre, à la porte de laquelle il vient tambouriner.
Quand elle le sait condamné à mourir, elle le laisse à nouveau entrer dans cette chambre parce que ses visites, avoue la mère, sont désormais stériles.
La pluie. Il pleuvait à seau lorsque Richard meurt. Il pleut aussi chaque fois qu’elle va à Katwijk, là où elle cachait Richard au regard des autres.
La récurrence ici : depuis 33 ans, elle fait le voyage à Katwijk le même jour, non seulement elle répète ici un rite mais 33 répète le même chiffre.
La fille : elle a trente-sept ans. Dans la bouche de la mère, il s’agirait d’une fille quelque peu retardée, demeurée, traitée par mépris, de « fille de ton père ». Cependant elle a promis, à son mari, sur son lit de mort, que son enfant n’aurait pas à avoir peur. En fait, elle lui est complètement inféodée. Sans moi, dit la mère, tu es incapable de vivre : sans moi, tu mourrais,c’est sur cette base que se forme leur couple. « Tu es une enfant pure, dit la mère, je suis impure ». Par ailleurs, elle dit encore : « J’ai enchaîné mon enfant à moi et inversément. Nous tirons sur nos chaînes ». Mais elle dit aussi : « Nous sommes l’œuvre de mon mari ». Lorsqu’elle était jeune, cette fille voulait devenir chanteuse d’opéra mais ses cordes vocales ont cédé. Tout se passe en fait, comme si désormais, la vie de cette fille s’était arrêtée. Elle est toujours la même, même visage impassible, elle rit toujours de la même manière. En fait, elle accuse le monde dans lequel ils vivent. « Tu marches bruyamment, dit la mère », maladroitement dans des lieux délabrés. Lorsque tu marches tout est sur le point de s’écrouler.
Malgré son intention de ne la lui donner qu’à Katwijk, la fille reçoit avant de partir une bague, symbole du cercle refermé sur lui-même comme si l’histoire ici était sur le point de s’achever, de s’annuler.
La mère affirme qu’elle à invité l’auteur par fidélité pour sa fille. Il apparaît en effet que de temps à autre, elles invitent un inconnu, en général un artiste, comme s’il s’agissait par cette invitation de mettre leurs relations à l’épreuve, mettant ainsi en péril leurs relations duelles. Mais voilà, la mère avoue ne plus rien vouloir de nouveau. Elle ne veut plus que la répétition, insinuant ainsi qu’elle abandonne la partie.
Elle est arrivée « au but » au moment où la répétition s’apprête à changer et devenir révolution.
L’auteur : il est né en Hollande, âgé de trente ans à peine, il habite Rotterdam.
Ses parents voulaient qu’il soit architecte, mais à l’image de Bernhard, il suit le chemin opposé, l’autre chemin. C’est l’opposé qui l’intéresse, la littérature dramatique. Cependant, affirme-t-il, l’écriture dramatique est quelque chose de semblable à l’architecture. Pour montrer son indépendance visà-vis de son entourage qui voulait l’enfermer dans une camisole dont il s’est délivré, précipitant la chute de ses proches, il part à Paris, où il apprend le français. Cependant, une fois qu’il connaît tous les ressorts de la langue française, il s’aperçoit que la ville est invivable. Il part alors pour Londres, puis revient à Rotterdam.
Mais il y a beaucoup plus. Cet auteur, qui a écrit la pièce « Sauve qui peut », (qui est le leit-motiv lancé au moment du naufrage), est en quelque sorte le double de la mère. En effet, elle se reconnaît entièrement dans la pièce qu’il a écrite,mais en même temps, il est lui à l’opposé de la mort. À Katwijk où elle l’invite,il est aussi arrivé au but, prétend la mère. Le flux et le reflux (cette dualité encore) qui symbolisent le succès des applaudissements, est aussi le flux et le reflux qui entament l’histoire de la mère. En effet, d’une certaine manière, avant de rencontrer son mari qui lui mime le flux et le reflux, elle n’avait pas d’histoire au sens .où elle ne savait pas écrire.
Ce flux et ce reflux de la mère que symboblisent les applaudissements, commencent l’histoire de l’auteur, là où l’histoire de la mère se termine. En quelque sorte, elle lui cède le témoin, le relais puisqu’aussi bien elle entrevoit la perspective que son histoire à elle, son histoire au présent, devienne désormais une histoire écrite par l’auteur. « Au but » est aussi l’histoire d’une délégation de pouvoirs.
Pour continuer à jouer sur la dualité, il y a deux pièces dont il est question dans « Au but » : « Sauve qui peut », mais aussi « La cruche cassée » qui emporte l’unanimité de tous les personnages. Cette comédie de Kleist, auteur par ailleurs de « Sur le théâtre de marionnettes », raconte l’histoire d’un homme qui, subrepticement, la nuit s’introduit dans la chambre d’une jeune fille, où sur le point d’être surpris, il s’enfuit en cassant une cruche en porcelaine. Cette cruche cassée inspirée du tableau de Greuze deviendra la pièce à conviction du procès qui sera alors instruit par le juge Adam (par référence au premier homme).
Les preuves avancées qui devraient accabler le fiancé finissent par se retourner et démontrer la culpabilité du juge luimême. Outre le caractère circulaire de cette pièce, Bernhard l’a choisie également pour souligner combien personne n’a le droit d’occuper la place du juge quand bien même il y a tout le temps quelqu’un pour s’en arroger le pouvoir.
La pièce : il faut bien se convaincre que tous les personnages, la mère monologante aussi bien que le père mort, l’enfant mort, la fille sont des émanations, des avatars d’un seul et même personnage : Thomas Bernhard.
La pièce pourrait être une conversation avec lui, un entretien qui résume sa manière de voir, de penser ses grandes idées, un compendium, un abrégé de lui-même. « Au but », c’est Bernhard sur scène. C’est l’homme de la fusion, l’auteur de théâtre parce qu’il fond tous les éléments qu’il possède. Et en ce sens, l’auteur de théâtre de « Au but » est également le pendant du père, propriétaire de la fonderie, ce lieu où le minerai brut entre en fusion. L’auteur décrit comme anarchiste est celui qui boutera le feu à toute l’histoire racontée par « Au but ». C’est l’incendiaire par excellence, le provocateur incessant.
Au but
de Thomas Bernhard
Mise en scène : Elvire Brison
Avec : Catherine Bady, Marie-Christine Bayens, Jacques De Bock
Scénographie : Jean-Pierre Scouflaire
Musique : Jean-Louis Poliart
Coproduction Théâtre du Sygne et Centre dramatique hennuyer
Création à Mons le 7 novembre 89