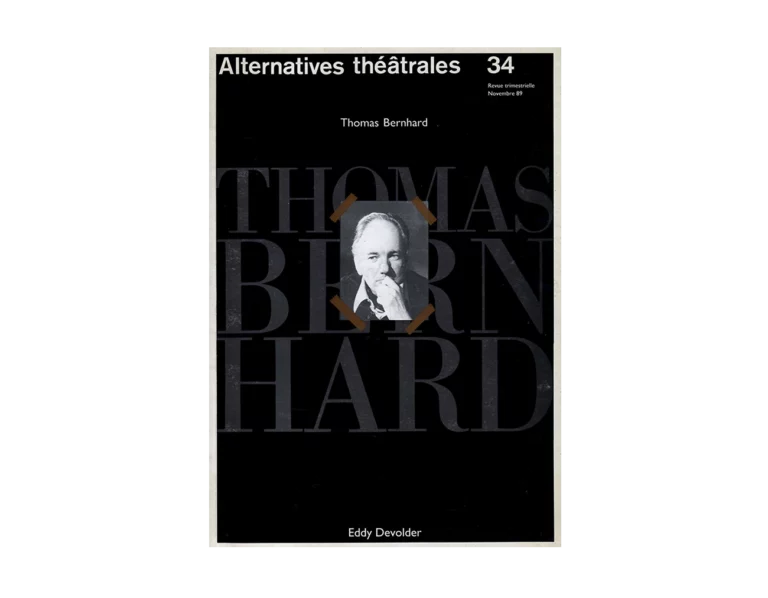SANS Claus Peymann, la production théâtrale de Bernhard n’aurait sans doute pas été aussi abondante. Sur 17 pièces écrites, il participe à la mise en scène (en première) d’au moins 10 d’entr’elles.

Tout commence lorsque, celui-ci impressionné par la lecture de « Gel », décide aux environs des années 1966, de le rencontrer, n’hésitant pas à faire le siège de la ferme d’Ohlsdorf. De cette rencontre, naîtra une exceptionnelle complicité qui se matérialise par l’écriture d’abord d’« Une fête pour Boris » (1970) représentée au Schauspielhaus à Hambourg, pièce pour laquelle Bernhard recevra le prix Grillparzer. La proclamation en sera cocasse puisque le jury ne reconnaît pas l’auteur assis au dixième rang (Bernhard en donne un compte-rendu féroce dans la dernière partie du « Neveu de Wittgenstein »).
La collaboration se poursuit en 1972 : « L’ignorant et le fou » est monté à l’occasion du festival de Salzbourg avec en vedette l’acteur Bruno Ganz.
En 1974, au Burgtheater à Vienne, il met en scène « La société de chasse » avec une première apparition de Bernhard Minetti dans le rôle du général.
Lorsque Peymann devient directeur du théâtre de Stuttgart, il y monte « Le président » (1975), « Minetti » (1976), « Kant » (1978), « Avant la retraite » (1979), « Les apparences sont trompeuses » (1983), etc…
En 1986, Peymann prend ses fonctions de directeur au Burgtheater à Vienne. Un an plus tard, Bernhard publie dans « Die Zeit » une « dramolette » « Claus Peymann et Hermann Beil sur le Sulzwiesee », hommage bouffon d’un homme qui connaît toujours le cadre pour lequel il écrit, qui souvent connaît les acteurs qui jouent les différents rôles et jusqu’au décorateur Karl Ernst Hermann, lequel avoue Peymann, a dans chaque cas dressé des garde-fous, tirant la pièce vers le réalisme.

C’est dire que de texte en texte, Bernhard lance chaque fois un défi, possédant d’avance les données de la mise en scène (le visage, l’attitude des comédiens, etc…), anticipant l’interprétation qui en sera donnée ; c’est dire aussi combien cette écriture possède un caractère privé, dès l’instant où il connaît tout le monde ; c’est dire combien partant de cette connaissance, il peut se permettre de ruser, d’essayer de les piéger ou au contraire d’accentuer certains de leurs tics.

En contrepartie, tous ont appris à lire Bernhard et ont compris son caractère éminement contemporain et en même temps la continuité historique que cette écriture entretient de Goldoni à Tchekhov ou Beckett.
Tous savent qu’il s’agit chaque fois chez lui d’«une danse de mort » d’une tragico-comédie tragi-comique, d’un louvoiement, d’un serpentement, d’une mise en bascule permanente que le moindre penchant avoué risque de désaxer.