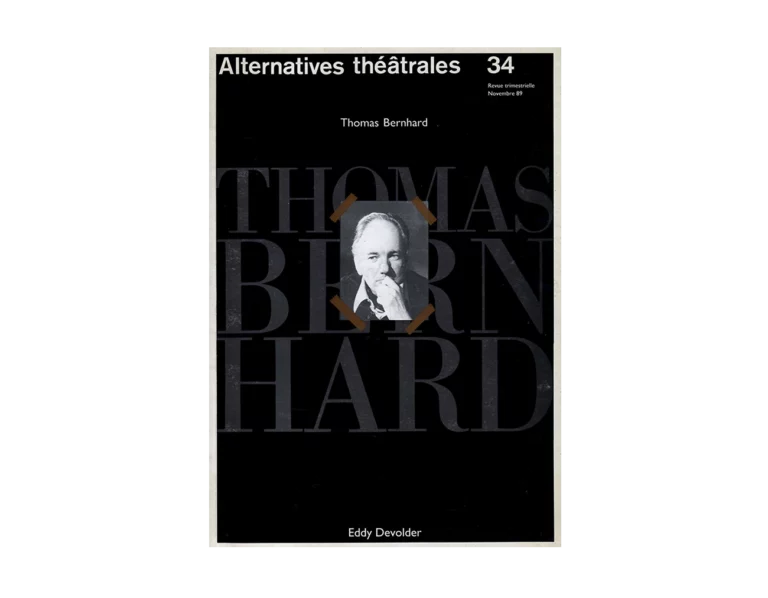Conversations avec
le monde
Jamais, Thomas Bernhard ne répondait aux lettres qu’il recevait et que le plus souvent, à l’instar d’Eric Satie, il ne décachetait même pas.
C’est dire la gageure qu’il y avait à le rencontrer, rendez-vous reportés, postposés, renvoyés aux calendes grecques, comme s’il voulait mettre à l’épreuve le désir de celui qui prétendait le rencontrer. S’obstiner à vouloir s’entretenir avec lui tenait d’autant plus du morceau de bravoure que Thomas Bernhard jouait à appâter son interlocuteur comme s’il voulait le détromper de ses intentions premières. D’ailleurs, il n’aimait guère s’abandonner à la parole et se refusait à la confidence. Parler avec lui tenait souvent du flirt avec la platitude des conversations à ras de terre évoquant tout et rien. C’est ce qui justifie le titre de ces entretiens avec Thomas Bernhard livrés ici à titre de citation : conversations avec le monde.
Nous remercions le journal Le Monde qui nous à aimablement autorisés à reproduire ici ces entretiens.
Thomas Bernhard : Certains prétendent que je vis dans une tour d’ivoire. Le mot lui-même est une ineptie. Avec un simple transistor, vous pouvez être au même moment au milieu des neiges éternelles et au centre du monde. Le repos, l’anonymat, ce n’est plus à la campagne qu’on les trouve aujourd’hui, mais dans les grandes villes. Les champs ont cédé la place à des quartiers et les tournesols à des plaques de rues. A part cela, les villes sont l’équivalent de ce qu’étaient jadis les campagnes, des lieux où il ne se passe jamais rien et où, à moins d’être enquêteur professionnel, la vie, si tant est qu’elle existe encore, est devenue totalement invisible.
Lorsque j’ai décidé, après des années de vagabondages, de m’installer à la campagne, c’était sur le conseil de mon médecin. « Si vous ne changez pas de vie, m’avait-il menacé, vous êtes foutu. » Aussi fascinant que soit le mot « foutu », j’ai opté pour le calme. Mais je n’ai pas tardé à m’apercevoir de mon erreur. À la campagne, tout le monde se connaît et on est confronté chaque jour, qu’on le veuille ou non, avec le destin, sous la forme d’histoires d’accouchements et d’agonies. Ici les industries sont nombreuses et l’on se heurte à chaque pas aux estropiés, victimes des machines. En définitive, c’est un terrain fort enrichissant pour un écrivain.
Jean-Louis De Rambures : Pourquoi avez-vous une telle allergie aux interviews ?
T.B.: Essayez de vous imaginer ligoté à un arbre, pieds et poings liés tandis que l’on tire sur vous à la mitraillette. Croyez-vous que vous seriez détendu ?
Je pars du principe qu’une conversation entre inconnus est impossible. Que des gens qui se voient constamment puissent échanger des propos, je veux bien l’admettre. Disons un mari et une femme, pour se passer une recette de cuisine. Mais toute autre forme de conversation a, pour moi, un caractère emphatique ou crispé. À fortiori, lorsque celle-ci se déroule entre des individus qui se voient pour la première fois. C’est un peu comme avec un orchestre qui commence à répéter. Il faut des mois pour trouver le ton juste. Enfin, lorsqu’on est en mesure de se comprendre, la conversation devient à nouveau inutile.
J.L.R.: En un certain sens, on ne peut que vous donner raison. Votre raisonnement est même d’une effrayante logique.
T.B.: En un certain sens, tout le monde a raison. C’est là le drame. Je n’aime pas du tout l’expression « en un certain sens » qui procure l’illusion de sécurité. Muni de ce petit mot, vous pénétrez dans une crevasse et croyez que vous allez pouvoir en ressortir comme par l’issue de secours d’un cinéma, seulement voilà : le propre des crevasses est précisément qu’on n’en ressort plus.
J.L.R.: Passons à votre œuvre. Pourquoi avez-vous délaissé, depuis 1975, le roman pour l’autobiographie ?
T.B.: Je n’ai jamais écrit de roman mais simplement des textes plus ou moins longs, en prose, que je me garderai de qualifier de romans, car j’ignore ce que signifie ce mot. Je n’ai jamais non plus voulu faire une œuvre autobiographique car j’ai une véritable aversion pour tout ce qui est autobiographique. Il se trouve qu’à un certain moment de mon existence j’ai éprouvé une curiosité pour mon enfance. Je me suis dit : « Je n’ai plus tellement d’années à vivre. Pourquoi ne pas essayer de fixer sur le papier ma vie jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Non pas telle qu’elle fut dans la réalité — l’objectivité n’existe pas — mais telle que je la vois aujourd’hui. » Je me suis mis au travail avec l’idée d’écrire un tout petit volume. Un deuxième a vu le jour. Puis encore un… Jusqu’au moment où j’ai commencé à m’ennuyer. Car, après tout, l’enfance, c’est toujours la même chose. Après le cinquième volume, j’ai décidé de tirer un trait définitif. Pour chacun de mes livres, je suis ainsi partagé entre la passion et la haine pour le sujet que j’ai choisi. Lorsque le deuxième sentiment l’a finalement emporté, je prends chaque fois la résolution de ne plus jamais me mêler des choses de l’esprit et de m’adonner, au contraire, à des choses purement matérielles, d’essayer de retrouver la sérénité, par exemple, en fendant du bois ou en badigeonnant un mur. Mon rêve serait que le mur ne s’arrête jamais afin que ma sérénité soit, elle aussi, éternelle. Mais au bout d’un laps de temps plus ou moins long, je me remets à me haïr pour mon improductivité et, en désespoir de cause, je me réfugie une fois de plus dans le cerveau.
Parfois je me dis que mon instabilité est due à une hérédité trop hétéroclite. Parmi mes ancêtres, il y avait des paysans, des philosophes, des ouvriers, des écrivains, des génies et des imbéciles, des petits bourgeois médiocres et même des criminels. Tous ces individus coexistent en moi et ne cessent de se battre. Tantôt sous la protection du gardien d’oies, tantôt du voleur ou de l’assassin. Comme il faut bien choisir et que tout choix implique un rejet, ce manège finit par me faire sombrer à deux doigts de la folie. Si je ne me suis pas encore suicidé, le matin, en me rasant devant mon miroir, je crois bien que c’est uniquement par lâcheté.
La lâcheté, la vanité et la curiosité sont, au demeurant, les trois impulsions fondamentales grâce auxquelles la vie continue malgré tout, alors qu’elle aurait toutes les raisons de s’arrêter. C’est du moins ainsi que je ressens aujourd’hui les choses. Car il se peut très bien que je pense demain tout autrement.
J.L.R.: Vous répétez dans chacun de vos livres que toute activité humaine est vaine car elle est condamnée, en définitive, à l’anéantissement. Et pourtant vous continuez à écrire.
T.B.: Ce qui me pousse à écrire, c’est tout simplement le goût du jeu. Vous avez d’abord le plaisir qui consiste à miser sur une carte en sachant que l’on peut chaque fois tout gagner ou tout perdre. Le risque de l’échec me paraît un stimulant essentiel. A cela s’ajoute cet autre plaisir que l’on éprouve à rechercher la méthode la plus appropriée pour venir à bout de la confrontation avec les mots et les phrases. Quant au thème proprement dit, je le considère comme tout à fait secondaire car il suffit, en fait, de puiser dans ce qui nous entoure. Tous les êtres, c’est ma conviction, portent en eux de façon rigoureusement égale le poids de l’humanité entière. Seule diffère la manière dont ils en viennent à bout. Pour en revenir à la manière dont je fais mes livres, je dirai que c’est une question de rythme qui a beaucoup à voir avec la musique. Oui, on ne peut comprendre ce que j’écris si l’on ne se met pas dans la tête que ce qui compte avant tout, c’est la composante musicale, et que ce que je raconte ne vient qu’en second lieu. Décrire les choses ou des événements, le premier venu est capable de le faire. Le problème est dans la manière dont on le fait. Les critiques, en Allemagne, n’ont malheureusement aucune oreille pour la musique, qui est pourtant essentielle pour un écrivain. En ce qui me concerne, l’élément musical me procure une satisfaction aussi grande que si je jouais du violoncelle, et même plus grande puisqu’au plaisir de la musique s’ajoute celui de la pensée qu’il s’agit d’exprimer.
J.L.R.: L’écrivain impuissant (je pense en particulier au héros de « La Plâtrière ») est un personnage qui revient souvent dans votre œuvre. S’agit-il d’un problème personnel ?
T.B.: Lorsque j’ai réussi à atteindre ma vitesse de croisière, rien ne peut plus me distraire. Pendant que je travaillais, à Bruxelles, au manuscrit du roman « Perturbations », a eu lieu l’incendie du grand magasin Innovation. Cela se passait tout près de ma fenêtre, grande ouverte. J’ai vu le ciel s’assombrir, puis se transformer en une boule de feu. Tout en écrivant, je m’étonnais de ne pas entendre les sirènes des pompiers. Lorsqu’elles ont enfin retenti, tout était consumé. Mais avant de parvenir à ce stade, mon travail passe par une période où le moindre incident, même la visite du facteur, peut tout remettre en question. Dans ces moments-là, le meilleur système pour combattre l’angoisse, c’est de ne pas avoir de système, ou encore de prendre l’avion et d’aller s’installer ailleurs. Peu importe où, pourvu que le paysage ne soit pas trop beau. Lorsque je n’ai pas encore commencé à écrire, la beauté d’un lieu peut à la rigueur être enrichissante, dans la mesure où elle me met en colère. Mais pour la création, si des lieux quelconques où même franchement laids me sont favorables, la beauté de villes comme Rome, Florence, Taormina ou Salzbourg est pour moi mortelle.
J.L.R.: Vous qualifiez Salzbourg, dans « L’origine » de « maladie mortelle sous le joug de laquelle des habitants tombent à leur naissance ». N’y a‑t-il pas là un peu d’exagération ?
T.B.: Plus une ville est belle en apparence, plus il est consternant de découvrir le véritable visage qu’elle cache sous sa façade. Entrez dans n’importe quel restaurant de Salzbourg. À première vue, vous aurez l’impression d’être au milieu de braves gens, Ecoutez les propos de vos voisins de table, vous découvrirez qu’ils ne rêvent que d’extermination et de chambres à gaz. Je vais vous raconter une merveilleuse anecdote. Peu après la parution de « L’origine », le critique Jean Améry m’a pris un jour à partie : Tu ne peux parler de Salzbourg comme tu le fais. Tu oublies que c’est une des plus belles villes du monde. Quelques semaines plus tard, je venais précisément de lire son compte rendu de mon livre dans le Merkur, et j’étais encore sous le coup de la colère car il n’avait absolument rien compris, lorsque j’entends une annonce à la télévision : Améry s’était suicidé la veille et cela, justement à Salzbourg. Ce n’était pas une coïncidence. Hier encore, trois individus se sont jetés dans la Salzach. On a dit que c’était à cause du fœhn. Mais moi je sais qu’il y a quelque chose dans cette ville qui pèse physiquement sur les êtres et finit par les détruire.
J.L.R.: Il semble tout de même que vous ayez un don particulier pour découvrir partout des monstres.
T.B.: Tous les êtres sont des monstres à partir du moment où vous soulevez leur carapace. Je me connais d’ailleurs suffisamment pour prêter aux autres mes propres sentiments. Le monstrueux, certes, me fascine, mais, croyez-moi, je n’invente jamais. Si la réalité vous paraît moins frappante que ma fiction, cela tient uniquement à ce que les faits s’y présentent en ordre dispersé. Dans un livre, il faut absolument éviter les temps morts. Le secret consiste à raccourcir impitoyablement la réalité. Peut-être est-ce là. en définitive, ce qu’on a l’habitude d’appeler imagination.
J.L.R.: On entend souvent nier, en R.F.A., l’existence d’une littérature spécifiquement autrichienne. Comment vous situez-vous à cet égard ?
T.B.: La question ne se pose même pas. Prenez la prononciation, la musique de la langue. Vous avez déjà une différence fondamentale. Ma manière d’écrire serait inconcevable chez un écrivain venant d’Allemagne et j’ai d’ailleurs une allergie véritable à l’égard des Allemands. N’oubliez pas non plus le poids de l’histoire. Le passé de l’empire des Habsbourg est incrusté dans notre chair. Chez moi, c’est peut-être plus visible que chez les autres. Cela se manifeste sous la forme d’un véritable amour-haine pour l’Autriche, qui constitue finalement la clef de tout ce que j’écris.