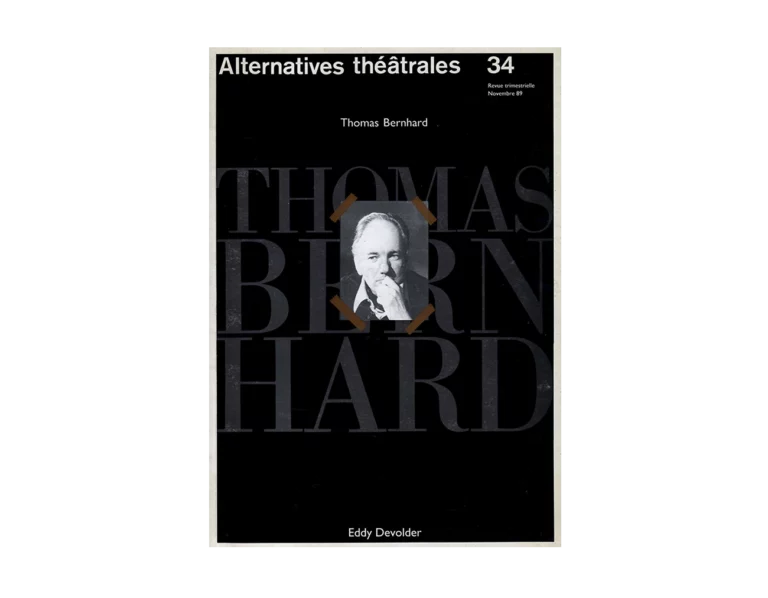EN 1962, lorsque Thomas Bernhard écrit « Kulterer », ce texte qui plus tard sera réécrit sous forme de scénario, il termine de mettre en place un procédé qui rapidement deviendra un élément majeur de son écriture : la distorsion, le gauchissement, allant jusqu’à la déréalisation totale des personnages, des lieux, gonflant l’événement anodin, l’anecdote, le fait divers, les propulsant au rang de situation épique ou au contraire grotesque.

Il détourne de la même manière que les ramolissements de Pol Bury infléchissent ou dévoient des monuments ou des portraits de personnalités.
Dans la prison où il est incarcéré, Kulterer, s’obstine à jouer un rôle de personnage anonyme, absolument soumis à la règle de la centrale qu’il s’apprête à quitter pour y avoir purgé sa peine.
Non seulement, le personnage qui donne son titre à ce court récit existe bel et bien mais il joue un rôle important en tant qu’animateur de la jeune littérature d’avant-garde de l’époque.
Ecrivain, Hubert Fabian Kulterer s’occupe également d’une revue littéraire « Erôffnungen » au point qu’il pourrait s’agir d’une dédicace s’il n’avait écrit ou taillé un texte sur mesure comme il en écrira à la mesure de Claus Peymann ou de Minetti.
A la mesure ou à la démesure puisque le procédé devient un procédé d’aliénation. Le personnage qui l’inspire devient tout autre, entre dans le champ de l’écriture de Bernhard. C’est l’altération totale, à moins qu’il ne s’agisse d’un procédé d’identification, d’aliénation.
Le côté épique de l’œuvre de Bernhard a rarement été souligné ; cet art de gonfler, de grossir un événement, jusqu’à ce que cela devienne trop gros.
L’acteur Minetti, jouant dans la pièce qui porte son nom, c’est trop gros, le narcissisme et l’autosuffisance de l’apologie s’effondrent. L’écriture de Bernhard, c’est le procès du narcissisme, une réflexion sur soi, toujours remise en question et battue en brêche.
Devant le miroir de l’écriture, c’est la clownerie ou le jeu avec la folie et la mort.
La répétition et le glissement subtil du tragique dans le comique jusqu’au grotesque, et inversément.
N’est-ce pas Marx qui disait que : « toute chose se répète toujours par deux fois, une fois de manière tragique et une fois de manière comique ».
Ici, les deux vont de pair : il n’y a en fait chez Bernhard jamais aucune forme arrêtée. Seule la mort arrête, alors que la vie est mouvement et particulièrement mouvement de vrille, de torsion, de distorsion, d’épuisement. De la torsion à l’exemple des fruits que l’on presse ou des serpillères que l’on essore jusqu’à la dernière goutte.
Ecrire est toujours pour Bernhard un processus d’épuisement et de destruction. La distorsion est le favori. Elle amène la grimace, le sourire dans la grimace, le rictus, le rire dans le cri.
C’est pourquoi la répétition n’est jamais infinie, elle se déroule entre un point et un autre. La figure emblématique de l’écriture de Bernhard ce n’est pas la spirale mais la torsade, l’expiation de la ligne droite.