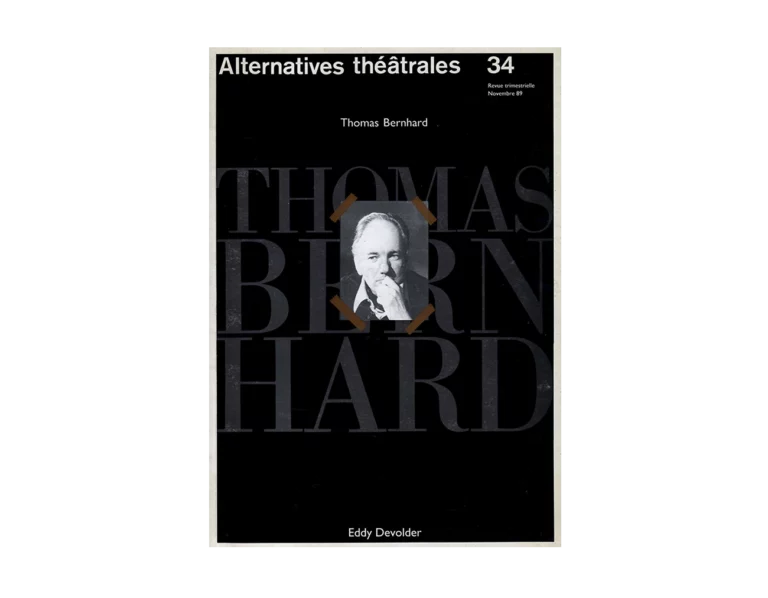QUEL que soit le point de vue adopté, de front ou de biais, sous l’angle de la partition, de l’instrument, de l’interprétation ou de l’ouïe, l’organe de perception, la musique est synonyme de mort. Pour le reste, elle n’a qu’une simple valeur de prétexte, d’apprentissage, de jeu dangereux ou d’initiation.
Dans le réduit à chaussures de l’internat où jeune adolescent, il exerce son talent, il ne vise pas à parfaire sa virtuosité, à s’adonner à la musique pour elle-même. La musique n’est jamais qu’un alibi, elle lui procure l’isolement nécessaire à sa méditation sur le suicide dans un cabinet noir, où règne l’odeur prégnante du cuir et des pieds puants. Là, il pense à se pendre, dans cette prison qu’est l’internat décrit dans « L’origine ».
Musique en huis-clos dans une boîte noire, elle ne délivre pas de l’enfermement, ne propose aucune voie de salut, mais permet seulement d’explorer les limites. Plus tard, lorsqu’à 16 ou 17 ans, il prendra des cours de chant chez Maria Keldorfer et recevra des cours d’esthétique musicale, la musique se rangera du côté de l’échapée, lui permettra à un moment de fuir l’école et de retrouver un instant la solitude.
Lorsqu’il quitte l’école, devient apprenti magasinier, le chant soudain, paraît lui proposer une vague alternative, lointaine possibilité de devenir chanteur lyrique. Mais une fois de plus la mort menace.
Lorsqu’il décide de vivre, soudain la musique se présente comme une voie de salut, comme un art.
Pourtant, même s’il a pu un instant hésiter et tergiverser, c’est vers l’écriture qu’il se tourne et plus précisément vers la poésie sous l’influence de Thomas Sears Eliot, Ezra Pound. Le temps de publier trois recueils, il s’aperçoit que la poésie conduit à une impasse. C’est l’époque aussi où il fréquente assidument Gerhard Lampesberg, disciple d’Anton Von Webern, émule de la concision et des motifs très courts, à l’aube de la musique sérielle d’une part et de la musique répétitive d’autre part.
Ces recherches ont sans aucun doute influencé l’écriture de Bernhard pour qui la langue est rythme sonore et le récit, structure, architecture et combinatoire. Cette vision mathématique de la narration est régie par la rigueur, le goût de l’écriture, le sens de la variation qui active là répétition et donne à l’écriture ce caractère impérieux de pressante nécessité, de « Drang », d’urgente pression qui dans le ressassement délivre, à travers des tournures et des phrases ressassées, d’un poids, dévoilant le secret qui pèse sur l’histoire.
Chaque récit de Bernhard, que ce soit dans le théâtre ou dans ses autres écrits — il ne voyait aucune différence dans ce qu’il écrivait — a pour ambition de faire sauter les sceaux qui oblitèrent un silence pesant. Son écriture dit l’inouï et ce n’est pas par hasard s’il traite si souvent de l’ouïe !
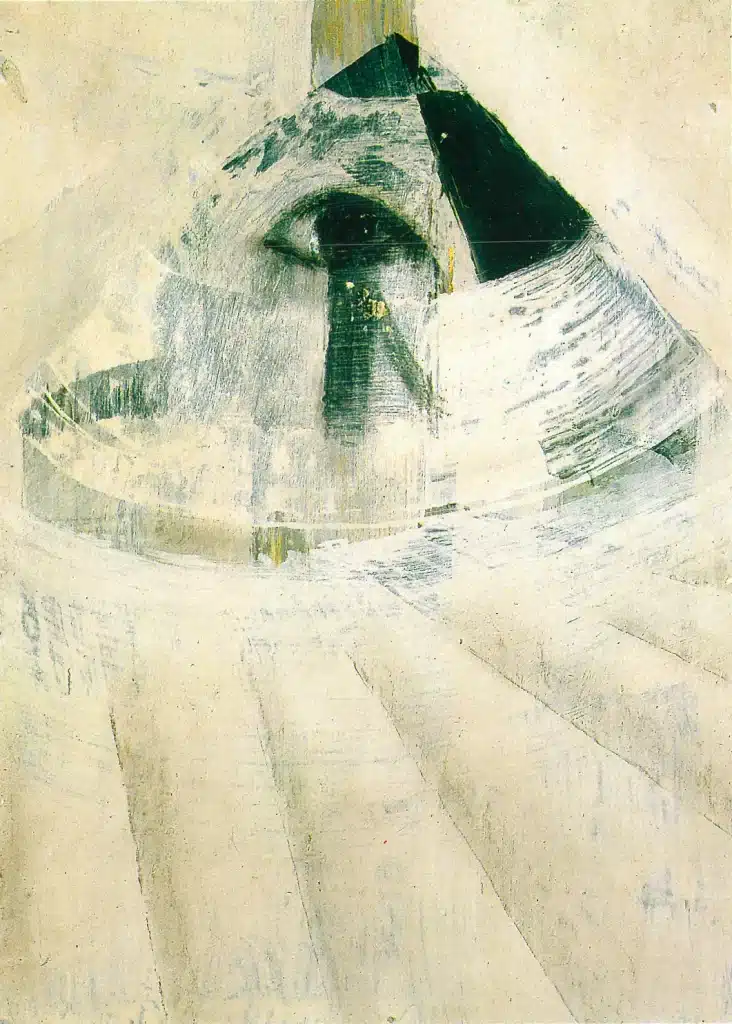
Dans « La Platrière », le héros est confronté à son impuissance face à la rédaction de son livre sur l’ouïe, résultat de plusieurs longues années de recherche et que les cris de sa femme, handicapée d’abord, le murmure de l’eau ensuite, viennent perturber.
Il y a par ailleurs dans la lecture, un effet de sourdine qui joue et d’emballement continu. Quelques pages suffisent à susciter un bourdonnement musical, entraînant, au point qu’il désoriente et déséquilibre très vite le lecteur.
Comme si la lecture de chaque livre demandait de se laisser absorber par le récit et de se laisser entraîner par le Maelstrôm de la langue, de ses circonvolutions, de ses péripéties musicales.
Les traductions françaises ne facilitent pas cet abandon, ce qui ajoute à la complexité de Bernhard, de devoir lire son allemand en français.