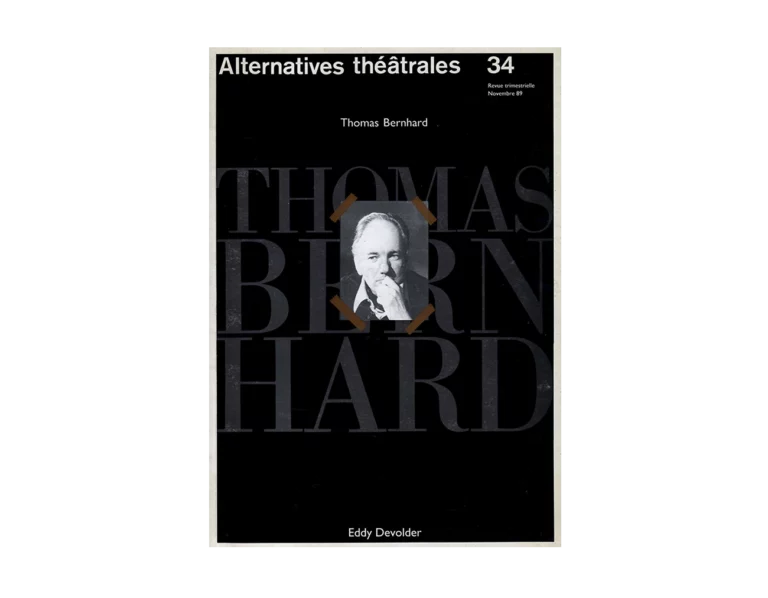L’ECHANGE : c’est un peu de sa propre mort qui se trouve sauvée dans l’échange, un peu de sa mort troquée contre une dette, cette dette qui se nomme amitié.
L’amitié est une des rares valeurs à laquelle Thomas Bernhard semble accorder un prix. Pour le reste, pas d’amour chez lui, pas de tendresse, sauf les quelques rares mentions qu’il fait à « la tante », l’être vital, qui habitait avec lui.
L’amitié ici est celle qui lie l’auteur au neveu de Wittgenstein, personnage inspiré de Paul Wittgenstein, frère de Ludwig.
Paul Wittgenstein est entré dans l’histoire de la musique parce que, amputé du bras droit au lendemain de la guerre 14 – 18, il commanda aux compositeurs les plus célèbres de son époque des concertos pour la main gauche. Les troubles mentaux qui l’affectèrent à la fin de sa vie contribuent à façonner le personnage du neveu de Wittgenstein.
En 1967, Thomas Bernhard est hospitalisé. On lui extrait alors du thorax une tumeur grosse comme un poing. À la même époque, Paul Wittgenstein réside dans la section réservée aux malades mentaux du Steinhof attenant au département où l’auteur séjourne. Cette amitié entre l’auteur et Paul nous est présentée comme une lutte pour la survie. Il s’avère d’ailleurs que les deux personnages à un moment donné de leur existence sont complémentaires. L’un est aux prises avec son corps, l’autre avec un mal qui ronge son esprit.
Tout se passe comme s’ils étaient habités l’un et l’autre par un être malade. L’auteur luttant avec ses forces psychiques contre la maladie, le neveu de Wittgenstein s’employant à défier la folie avec ses forces physiques.
Paul nourrit une passion intransigeante pour la musique et le sport automobile. Cependant, dit Bernhard, il jette les trésors de son esprit par la fenêtre. En fait, il témoigne par là d’une prodigalité à l’excès nuisible à son génie. En effet, il est présenté comme un génie qui ne produit rien alors que lui, le narrateur, écrit. Tous les deux, en fait, sont artistes et tous les deux se battent pour recouvrer un état de santé.
Tout se passe comme si le mal les avait aimantés puis repoussés. Dans leur malheur et leur convalescence, ils se battent pour se toucher, se retrouver.
Cependant, cette amitié est aussi l’histoire d’un déclin, d’une agonie qui commence avec le sarcasme, l’ironie. Les petits esclandres d’un personnage par ailleurs somptueux, grand seigneur, austère, arbitre des élégances en matière de musique.
Paul passa la première moitié de sa vie à gaspiller sa fortune et la seconde, une fois sa richesse dilapidée, à mener une vie identique mais sans argent, ce qui ne put que créer l’exaspération de la famille.
Et rapidement, ses excentricités seront décrites comme folie.
Alors, Paul, soudain, a besoin de toucher : ses longues étreintes, les moments de silence à écouter la musique.
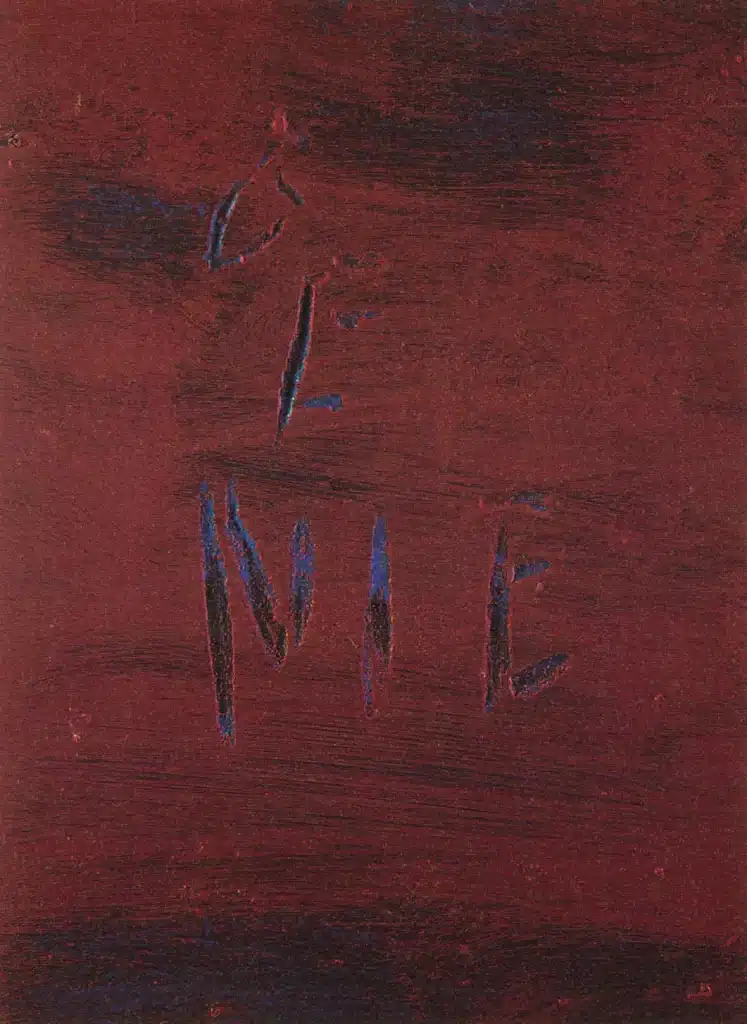
L’amitié, chez Bernhard, c’est peut-être une fraternité qui s’étale sur une période de temps déterminée qui connaît un commencement et une fin ; c’est une fraternité qui peut se permettre le luxe d’échapper à la logique fatale du destin. Ici, les événements, les rencontres procèdent par étapes jusqu’au moment où Wittgenstein s’est mis à décliner physiquement. Alors, le narrateur fuit, nourrissant toutes ses réflexions autour de la mort.
Le déclin de l’ami rejette le narrateur.
L’amitié peut se permettre le luxe d’une liberté étrangère au frère.
C’est une relation qui ne porte pas a priori l’empreinte du baiser de la mort.
« Il n’est pas aberrant de penser, écrit Bernhard, qu’il a fallu que mon ami meure pour me rendre plus supportable ma vie, ou mieux, mon existence, si ce n’est pendant de longues périodes pour me la rendre simplement possible ». C’est cette liberté que permet l’amitié, cette liberté qui est aussi celle par laquelle la création commence.