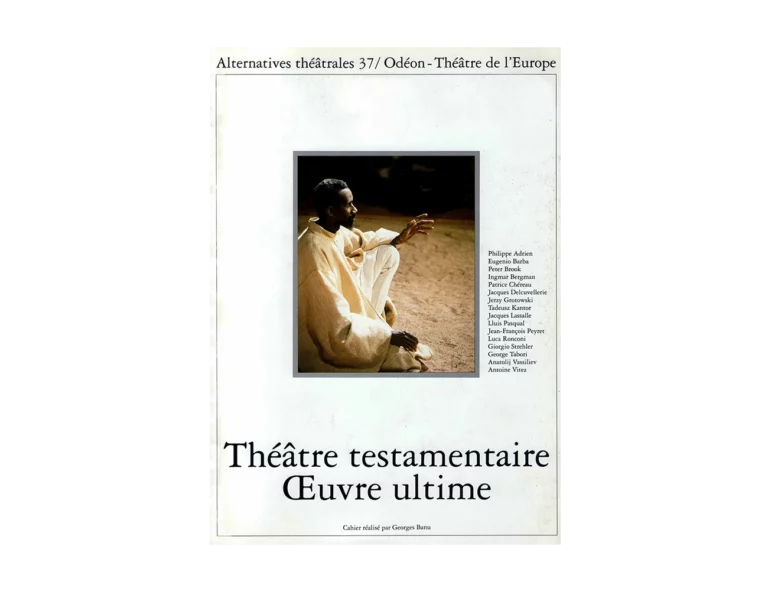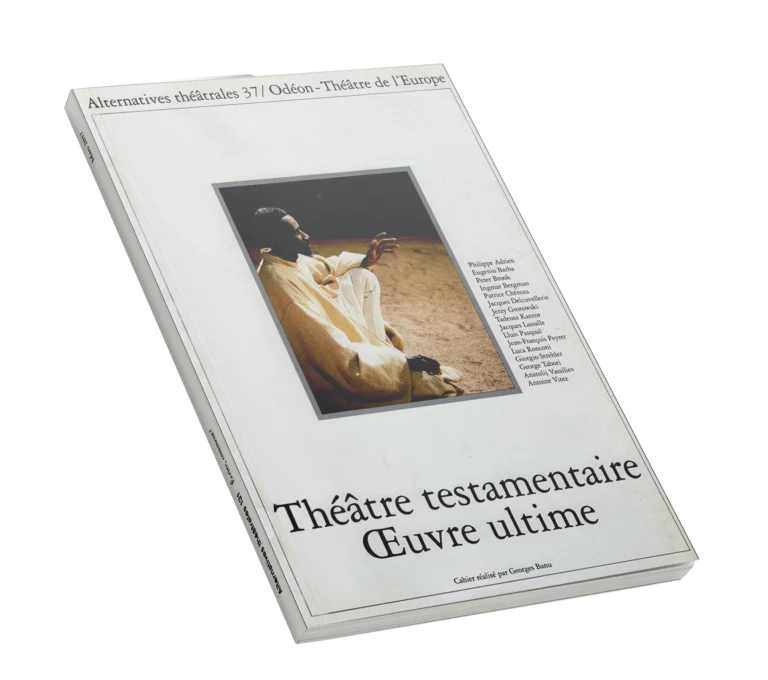« ÉPILOGUE DRAMATIQUE » — le sous-titre de QUAND NOUS NOUS RÉVEILLERONS D’ENTRE LES MORTS (1899) est explicite. Pourtant, on le sait, Ibsen envisageait de donner encore d’autres œuvres. Le destin l’a voulu autrement : frappé d’une attaque d’apoplexie, paralysé, l’auteur est resté muet jusqu’à sa mort en 1906. L’épilogue qui devait clore un cycle est devenu celui de l’œuvre tout entière.
En 1877, lorsqu’il termine LES PILIERS DE LA SOCIÉTÉ, Ibsen est à un tournant. Après les véritables sommes que sont BRAND et PEER GYNT, il entreprend, à travers une série de textes plus brefs, de réaliser ce qui fut toujours son projet : dire, sinon le monde, du moins un monde, celui qui fut le sien. Or, ce monde est désormais en proie au doute : les certitudes s’effondrent, des fissures y apparaissent. Pour en rendre compte, un art du fragment s’impose : il faut procéder par découpes, par tranches de vie. Ibsen adopte une esthétique naturaliste ; en douze œuvres, couvrant une période de vingt-deux ans, il en fera éclater toutes les contradictions. Tiraillé entre les exigences de la vraisemblance et celles de l’exemplarité, le cycle avance jusqu’à cet épilogue qui marque à la fois la fin d’une esthétique et celle d’un siècle. D’un monde miné, pourrait-on dire.
Le cycle devient ainsi l’impossible somme. L’effet de réel y est sans cesse battu en brèche par l’envahissement des symboles ; métaphores et références aux fonds culturels les plus divers sont mobilisées pour nous aider à lire un monde qui, irrémédiablement, se dérobe au sens. D’où l’aspect chaotique, hétéroclite, des dernières œuvres, et plus particulièrement de QUAND NOUS NOUS RÉVEILLERONS D’ENTRE LES MORTS.
Ibsen y met en scène un sculpteur, un poète qui lui ressemble comme un frère. Et c’est l’échec du poète, de celui dont c’est précisément la fonction de dire le monde, qui va nous être montré : une avalanche l’emportera, et le monde avec lui. Ce monde qui ainsi se meurt, c’est celui d’Ibsen, celui du XIXe siècle finissant. Mais ce monde-là, ne l’oublions pas, est celui qui naquit quelque cent cinquante ans plus tôt, dans l’optimisme des Lumières. Epilogue d’un cycle, épilogue d’une œuvre, QUAND NOUS NOUS RÉVEILLERONS D’ENTRE LES MORTS est aussi celui d’un genre, le drame bourgeois, inauguré par Diderot et dont le drame naturaliste est le dernier avatar. Le pessimisme radical d’Ibsen n’en devient que plus saisissant.
Rubek, le sculpteur-poète, a trahi, nous dit Ibsen. A son art, il a sacrifié sa vie, son amour pour celle qui fut son modèle et son inspiratrice. Et cette trahison l’a rendu stérile comme artiste. Le monde et l’art paraissent inconciliables, et pourtant, après Ibsen, après Rubek, quelque chose subsiste : leur œuvre qui, même inachevée, témoignera de leur ambition. LE JOUR DE LA RÉSURRECTION, la grande œuvre de Rubek, celle qui l’a rendu célèbre, est l’œuvre de toute une vie ; elle n’a cessé d’évoluer, de subir des transformations. Véritable work in progress à la manière de celle de James Joyce, elle préfigure les esthétiques du siècle à venir. Et le cycle ibsénien, par l’éclatement de sa forme, ouvre la voie au drame moderne. Alors, QUAND NOUS NOUS RÉVEILLERONS D’ENTRE LES MORTS pourrait bien, en dernière instance, être aussi un prologue.
Comme dans les derniers quatuors de Beethoven
Une porte se ferme. Le maître constructeur termine sa dernière œuvre ; nous sommes en 1899. Cette fois, il devait s’agir d’une autobiographie ; c’est devenu une pièce. Evidemment. Mais le cercle se rétrécit encore, le poids s’alourdit : d’abord, avec audace ou ironie, il l’intitule LE JOUR DE LA RÉSURRECTION, puis QUAND LES MORTS SE RÉVEILLENT, puis, le miroir enfin tourné à l’angle juste, il écrit QUAND NOUS NOUS RÉVEILLERONS D’ENTRE LES MORTS. À la fin, il supprime également le sous-titre : une pièce, et la plume d’acier trace les mots épilogue dramatique.
Quel genre d’épilogue ? Quatre personnes dans un espace disloqué. Il veut s’extraire des murs de la bourgeoisie. S’en libérera-t-il jamais ? Son écriture va droit au but, sans préparatifs cette fois-ci, et en chemin, lentement il se dépouille de son brillant costume psychologicoréaliste. Le poids des accessoires disparaît, tu te retrouves sur la montagne nue, tu ne peux que monter ou descendre. Pax vobiscum. La porte se referme.
Etrange pièce. Dense, serrée dans sa construction. Les figures se reflètent les unes les autres dans des résonances sans cesse renouvelées, comme dans les derniers quatuors de Beethoven. La passion du maître constructeur est toujours vivante, il s’élance, extatique et exalté, sa tendresse est ancienne. Et l’humour qu’il n’a jamais su réprimer est toujours là, par éclairs rapides. Il rassemble fermement ses personnages, les exposant violemment à la lumière. Là, nous nous agitons, nous épuisant à atteindre Dieu, tout en nous accrochant à l’amour de la vie, en une tension constante entre l’individu et la communauté. L’air est froid et mordant, et partout il y a ce goût bleu des amandes amères.
La porte se referme, et un nouveau siècle s’ouvre. Il ne s’y est jamais aventuré avec sa plume, le maître-constructeur. Mais les ondes se propagent.
Kjetil Bang-Hansen
Ce texte est publié ici avec l’accord du T.N.S.
Kjetil Bang-Hansen a mis en scène QUAND NOUS NOUS RÉVEILLERONS D’ENTRE LES MORTS au TNS en novembre 1990. Le texte français était de Terje Sinding.