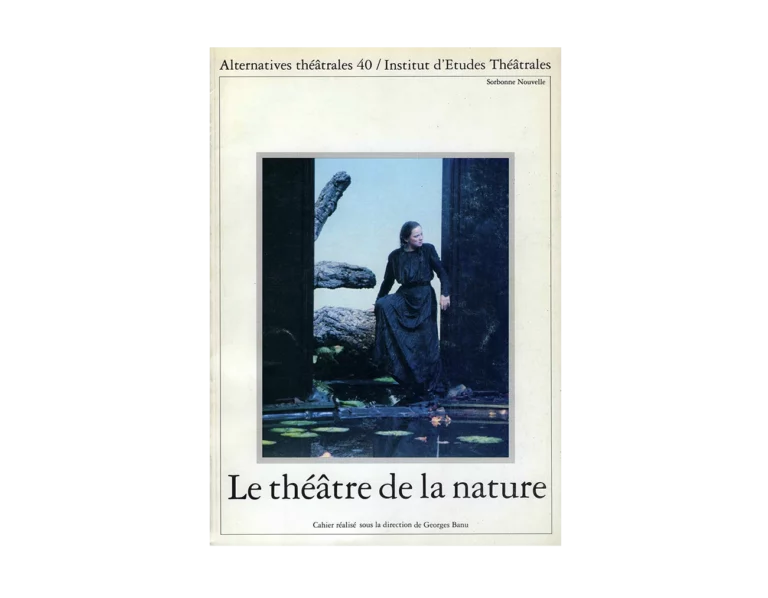LA dernière pièce de Shakespeare se prêta ces temps-ci à toutes les métamorphoses : ce fut tout d’abord la version dépouillée de Peter Brook aux Bouffes du Nord qui mit le texte à nu, puis l’opéra de Berio à la Bastille UN RE IN ASCOLTO, adaptation pour la musique de LA TEMPÊTE ; Peter Greenaway réalisa ensuite l’illustration cinématographique de l’argument. Karine Saporta enfin, qui avait créé certains des moments chorégraphiés de PROSPERO’S BOOK, fit danser le livre. Ce qui rapproche intimement les créations de Berio, Greenaway et Saporta est cette commune exigence d’un spectacle total, qui fasse revivre les formes expressives multiples de l’opéra.
Dans l’île de tous les bruits, de toutes les lumières et visions, chacun des sens est sollicité ; Prospéro communique avec les puissances naturelles et spirituelles : la nature côtoie ainsi l’univers culturel des œuvres humaines, s’ouvre aux forces magiques et surnaturelles du monde, à ses frémissements telluriques et célestes. Prospéro, homme des passages, annule les antagonismes entre la matière et l’esprit ; Greenaway, puis Saporta choisissent de tisser des analogies entre les arts : la danse répond aux images, les images à la musique, la musique aux architectures savantes pour représenter la traversée des univers. La réalité se combine dans la maille des arts.
La nature a déjà été visitée lorsqu’on la représente : ce sont des stéréotypes culturels qui constituent finalement l’unité des éléments scéniques. L’œuvre de Shakespeare contient le secret des images de mémoire partagée, l’origine du spectacle est d’ordre livresque : déjà la nature a‑t-elle été imitée lors de la création artistique de l’époque élisabéthaine, et l’on rappelle les œuvres de l’esprit humain pour .civiliser la nature qui n’existe pas autrement. Les arts sont les dépositaires de la mémoire, et l’on ressuscite le texte du seizième siècle par la voie des analogies et des correspondances artistiques.
De même les titres indiquentils souvent le lieu d’où l’on verra l’œuvre : le point de vue est pour Berio et Greenaway celui de Prospéro, pour Saporta celui de Miranda. Dans les deux cas, le spectacle total requiert une vision unique et centralisatrice qui fait du personnage principal l’égal ou le double du créateur : le Prospéro de Greenaway écrit le cours de son imagination, engendre personnages et décors dans l’immédiateté de l’inspiration. Plus de différence entre paroles écrites, dites ou représentées, qui s’enchâssent comme des visions intérieures : les protagonistes restent d’ailleurs silencieux jusqu’à la scène du pardon de Prospéro : seule la voix de Gielguld pour tramer Les complots, révéler les secrets, instruire les amours. L’on convie les spectateurs à la genèse de l’œuvre, dans l’antichambre de l’écrit : les images mentales d’un Shakespeare — Prospéro — Greenaway développent le thème de la force de l’imagination créatrice. Les personnages issus de l’univers du cinéaste ont la consistance artificielle et fantômatique des images de synthèse ; les figures cireuses et mécaniques des personnages surgis de la chorégraphie de Saporta se dédoublent sans fin, jusqu’à perdre toute individualité.
Il n’est qu’un esprit actif, celui du créateur qui retrouve la force vivante des mots de Shakespeare ; Prospéro ou Miranda ressemblent alors à ces visionnaires pour qui le monde existe dès lors qu’il est parlé. Plus de différence entre les ordres naturels, culturels ou surnaturels qui tissent les liens d’une même réalité supérieure ; l’image jaillit brusquement du mot, et l’on représente les hors-scène de la pièce élisabéthaine, comme l’on montrerait un instant les coulisses d’un spectacle : le mariage de Claribel à Tunis, les douleurs d’enfantement de la sorcière Sycorax, les différents aspects de Miranda au cours des âges, etc.
Ces allégories — peintures des choses et des idées — contiennent les origines culturelles du monde dans le film de Greenaway, et Le secret des livres a permis leur conservation : c’est d’ailleurs la première fois que le réalisateur s’attache à un texte classique, ponctué de pages issues de vingt-quatre ouvrages qui disent l’état des connaissances à l’époque de Shakespeare : livre de l’eau, des animaux ou des plantes, des jardins, livre de l’amour, des jeux ou des mouvements, traité d’astrologie, d’anatomie ou de cosmologie constituent de possibles visions du monde, emblèmes de la pensée humaine.
Karine Saporta prétend elle aussi à la liberté, lorsqu’elle parcourt les phrases de l’auteur élisabéthain afin de ressusciter les images qui vivent derrière les mots, liberté que la danse aurait atteinte en étant traditionnellement tenue à l’écart du langage articulé, et qui permettrait paradoxalement de ravir les textes des grands dramaturges : les mots sont ici volés par le corps, selon le précepte du maître de ballet Noverre qui engageait à danser les œuvres du répertoire dramatique au siècle des lumières :
«Les chefs d’œuvre des Racine, des Corneille, des Voltaire, des Crébillon ne peuvent-ils pas encore servir de modèle à la danse dans le genre noble ? Je vois le peuple dansant se récrier à cette proposition, je l’entends qui me traite d’insensé ; mettre des tragédies et des comédies en danse ? quelle folie ! Y‑a-t-il de la possibilité ? oui, sans doute ; resserrez l’action de L’AVARE ; retranchez de cette pièce tout dialogue tranquille ; rapprochez les incidents ; réunissez tous les tableaux épars de ces drames et vous réussirez. (…) Mais ces pièces, dira-t-on, étaient généralement connues ; elles servaient, pour ainsi dire, de programmes aux spectateurs, qui, les ayant gravées dans la mémoire, suivaient l’acteur sans peine et le devinaient même avant qu’il ne s’exprimât. N’aurons-nous pas les mêmes avantages, lorsque nous mettrons en danse les drames les plus estimés de notre théâtre ? »1
L’on traite uniquement la « crête des mots » dans cette chorégraphie soucieuse de poésie dans l’espace, où la nature est porteuse des traces des efforts de civilisation ; une seule vision transforme un paysage, le naturel est idée mythique et pensée humaine. Pas d’île dans le spectacle de Karine Saporta si ce n’est la scène, pas de grotte de Prospéro mais une enfilade de niches empruntées aux maîtres de la peinture pré-raphaélite. Pas plus de scène de naufrage ; mais l’effet pour la chose, l’impression pour l’événement. Danseurs balancés au gré de guindes dans l’espace, bruits intenses, lumières orageuses et mots qui claquent. La nature est ici « organisation rythmique de pliages et de pulsations »2 rendue par Le corps des danseurs, la lumière et la musique.
Peu d’images référentielles du monde, mais des vestiges : dans l’univers de Saporta, le plus ancien est déjà culturel. Ruines d’une culture de la splendeur qui a cessé d’être, ou armatures de la société contemporaine, colonnes de marbre dont on aperçoit la structure. Si la nature est représentée, ce n’est pas au travers d’une imitation systématique du réel, mais dans une désignation de ses effets ; dans le travail du temps sur les créations architecturales, dans l’érosion. Le naturel n’est plus l’origine, mais l’après de la culture. Les légendes contenues dans les ruines perpétuent le cycle naturel. De la sorte, toute présence à la scène est aussitôt menacée de disparition : les voix des chanteurs s’effacent en coulisse, le corps du nain-Caliban est happé à nouveau par les jupes des femmes, la vision du palais est plusieurs fois obstruée à l’avant-scène par une enfilade de niches empruntées aux églises baroques. Les images que les sens croient deviner s’abîment. Règne de l’artifice et de l’illusion déconstruits aussitôt que permis.
Certes l’on assiste à la notation du monde dans une compilation d’objets plus directement mimétiques de la nature : les moissonneurs du texte de Shakespeare imposent une longue scène dans des meules de blé piquées de coquelicots… et de roses. Mais ces éléments de décor tournent avec les scènes, composent finalement des visions contradictoires ayant la valeur rhétorique de l’alliance d’images ; les roses recouvrent les colonnes de marbre fissurées, jonchent la patinoire sur laquelle les L’île de Peter Greenaway est elle aussi factice ; sorte d’inversion critique du mythe de l’île déserte que ce travelling qui brouille toute conception de l’espace pour le spectateur : bibliothèque laurentienne danseurs évoluent à la fin du spectacle ; il pleut ou il neige à l’intérieur du palais vénitien, parfois envahi de nappes épaisses de fumées ou de brouillard.
Les conjugaisons effectuées par la nature restent de l’ordre de l’énigme ; l’homme civilisé — l’homme dompteur — échaffaude des systèmes mécaniques qu’il désirerait logiques pour comprendre l’univers : les danseurs portés par la musique esquissent le compte de la nature ; le pas est l’instrument rythmique de la mesure du monde. de Florence, basilique Saint-Marc, Pyramide de Sestius à Rome surgissent d’un florilège de l’architecture italienne, pierres de Mantoue ou de Cordoue, colonnes et phares surveillant une mer domestiquée dans des bains romains… Tous ces lieux — compilation terrible de visions — se confrontent et s’assemblent dans la mémoire imaginative du démiurge Prospéro.
Cette profusion, comme une question quant à la valeur du réel : dans cet univers cinématographique, la réalité est essentiellement magique. C’est-à-dire opaque et vivante. L’image révélée n’est que le masque d’une autre réalité, plus profonde peut-être ; la caméra tourne sans fin les pages des apparences qui se superposent et s’annulent dans une vertigineuse vitesse. Le naturel pourtant se manifeste : l’organisation mathématique désirée par l’homme pour dompter l’inconnu se fissure souvent : décors de carton pâte, qui vacillent au moindre souffle de la nature. Le combat du culturel contre le naturel — représentatif de toute civilisation humaine — serait essentiellement question de vélocité. Ou de regard : l’espace naturel filmé s’organise en fonction d’un ordre préétabli par le créateur ; Prospéro, Shakespeare et Greenaway énoncent, écrivent ou cadrent un ordre logique du monde.
Il est toutefois un surgissement inattendu de la nature, dans l’univers de Greenaway : ce sont les éléments — l’eau, le feu, la terre et l’air — qui signifient la possible révolte de l’ordre naturel contre le culturel : ce sont Ariel et Caliban, esprits constitués de l’étoffe de ces éléments primordiaux, qui transgressent les lois de l’espace et des hommes, frondeurs inconscients des limites imposées aux états humains.
Les quatre éléments sont ici les « hormones de l’imagination » (décrites par Gaston Bachelard sous le concept d’imagination matérielle) transformant le réel en une organisation supérieure et mystérieuse. Ce sont eux quiremettent la nature en marche, la métamorphosent en de nouvelles images. En outre, chacun de ces éléments représente dans PROSPERO’S BOOK un ensemble particulier de conditions données à la vie, et cela dans une conception évolutive où le déroulement du cycle commence avec le premier élément (l’eau, la tempête), pour finir avec le dernier (la terre, le retour à Naples) en passant par les éléments intermédiaires (le feu, l’air Ariel). Cette référence aux philosophes de la Grèce antique développe la conception d’un ordre quaternaire de la nature et des âges de la vie humaine : l’eau est hiver, l’air printemps, le feu été, la terre automne. Ce qui construit véritablement la nature et lui impose une géométrie, c’est le cycle, le temps. Le film de Peter Greenaway représente ainsi la nature par la thématique du passage.
Ce qui n’est pas domestiqué, c’est la roue des éléments. De là vient le seul danger encore consenti à la nature. Danger qui gagne aussi bien les œuvres de la nature que celles de la culture dans l’esthétique de Greenaway : bibliothèques dévastées par des pluies de feuilles, palais ouverts sur des abîmes de la terre ou des cieux, champs de blé brûlés par le soleil se soumettent également aux principes actifs de l’univers.
Cette vision cosmique de la nature est l’autre visage du thème de la création, engagé par la présence d’un Prospéro imaginant l’ensemble des visions représentées : car le cosmos est l’archétype idéal de toute situation créatrice et de toute création, comme le rappelle Mircea Eliade. Le double thème de la cosmologie et de la création clôt l’œuvre cinématographique sur elle-même : tout cela n’était en définitive que songe et illusion.