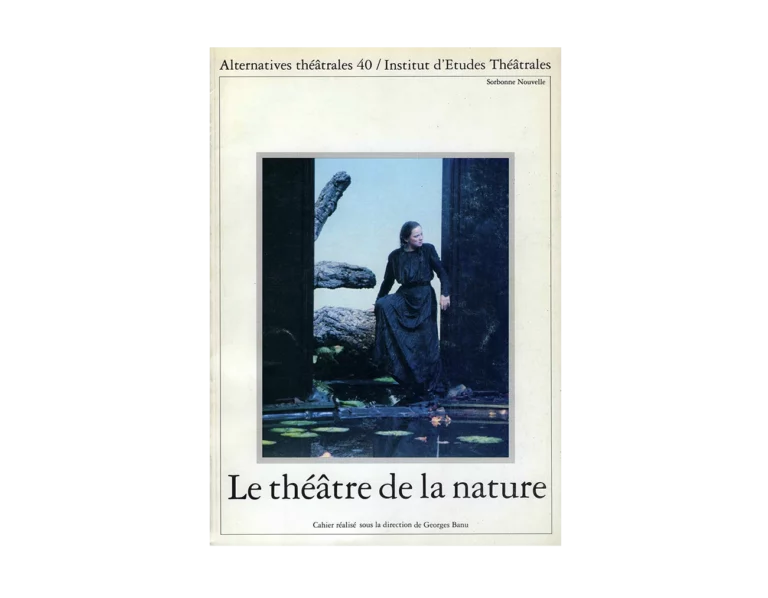DEUX femmes vêtues de robes légères marchent dans un bois. Le sol est couvert de feuilles mortes, on comprend qu’il fait froid.
Les deux femmes tiennent en laisse deux grands chiens.
Paysage de terre, terre humide, fangeuse ; brume. Une femme, en guêpière et bas noirs, court. Elle semble épuisée, sans but. Son visage est masqué à demi par un loup noir aux deux grandes ailes, comme un papillon. On peut voir ses seins au détour d’un mouvement, les muscles de ses épaules et de ses longs bras saillent. Elle continue de courir. Il fait froid. Derrière, on aperçoit des poteaux télégraphiques, on devine la ville.
D’autres images : une femme en robe bleue court dans la pénombre de la forêt en criant : « maman, maman, maman ».
Des hommes âgés, vêtus de lourds manteaux gris, marchent dans la terre, on voit çà et là des taches de neige qui contrastent avec la terre. Impression de fatigue, d’inéluctable.
Une femme erre à travers les arbres de la forêt. Chaque arbre porte un numéro.
Les images se succèdent au gré de la musique : fanfare funèbre, jazz mélancolique et déchirant, morceaux classiques.
C’est LA PLAINTE DE L’IMPÉRATRICE, le premier film de Pina Bausch, film sans histoire, mosaïque d’images, de personnages seuls, en couple, en groupe, à l’intérieur ou à l’extérieur, mais surtout à l’extérieur. Et cet extérieur est froid, enneigé, brumeux. Pina Bausch y jette ses danseurs qui s’étendent sur la neige, dansent lentement sous une pluie diluvienne, sous les flocons, et il y a toujours un paradoxe entre les vêtements d’été (robes de mousseline ou robes du soir extrêmement décolletées) et la rigueur atmosphérique.
Il n’y a aucune trame, aucune explication, des bribes de texte ici et là. Et toujours, comme un leitmotiv, la terre, le vent, l’eau, la neige.
Tous les éléments d’un univers sont donc réunis dans ce film qui est en quelque sorte un carnet d’images où l’on retrouve des scènes de différents spectacles de la chorégraphe. Les interprètes du film sont naturellement les danseurs de la compagnie du Tanztheater de Wuppertal auxquels s’ajoutent des vieillards qui marchent dans la neige et une femme, elle aussi âgée, qui danse seule devant un juke-box dans le couloir glauque d’un petit hôtel et clôt ainsi le film. Il est intéressant de noter qu’à travers tous les éléments de nature, on lit constamment la ville, on la sent proche. Les scènes urbaines sont tournées également en hiver, la lumière est basse et invite au suicide. Et l’on comprend l’impact que cet environnement peut avoir sur la créatrice et son groupe.
Mais, curieusement, cette poésie des éléments, cette écriture de la douleur que Pina Bausch entreprend en filmant la terre, l’eau, la neige, émeuvent moins. Peut-être les anachronismes cruels de ces femmes aux robes légères, perdues dans les intempéries, ne parviennentils pas à gommer le réalisme de l’outil cinématographique. Il n’y a pas de transfiguration et au fil des images, la neige reste neige et la terre reste terre. La répétition rend les scènes moins poignantes malgré l’énergie pathétique et l’investissement physique des danseurs.
La terre : LE SACRE DU PRINTEMPS, 1980
C’est pourtant la transfiguration qui est à la base du travail théâtral de Pina Bausch et le choix des éléments naturels sera fondamental dans ses spectacles. Presque tous les éléments répertoriés dans LA PLAINTE DE L’IMPÉRATRICE s’y retrouvent. Transportés dans le théâtre. Et cette subversion de la matière a un impact poétique exceptionnel.
Créé en 1975, LE SACRE DU PRINTEMPS sur la musique d’Igor Stravinsky, est réellement un spectacle emblématique. C’est le dernier spectacle « dansé » de la chorégraphe et on y trouve les bases de son travail futur.
La scène est recouverte d’une épaisse couche de terre brune. C’est là le seul élément de décor. Sur cette terre sera célébré un rite sacrificiel durant lequel une victime désignée par le groupe sera immolée. C’est un rite orgiaque à la fertilité où l’emphase est mise sur le personnage de la femme mais aussi sur le conflit entre les sexes.
Le pouvoir d’évocation de ce dispositif scénique est grand. Il y a d’abord le choc de cette masse de terre compacte, qui s’offre dans sa sensualité, qui dégage une odeur réellement perceptible. Puis, au fil du spectacle, l’élément scénographique va se métamorphoser tout en restant naturellement le même, car cette terre paisible va devenir un véritable champ de bataille, piétiné par la furie des danseurs, lieu de violence. Il y a interaction entre cet élément — maternel au début puis progressivement dévasté — et les corps mêmes des danseurs qui au fur et à mesure vont être maculés, enveloppés par cette terre, comme si l’élément exerçait sur eux un irrésistible pouvoir (à la fin du spectacle, une des danseuses tombe plusieurs fois face contre terre, littéralement happée par la terre).
La terre comme champ de bataille mais aussi la terre comme ventre, comme refuge. L’effet de contraste est puissant. Cette terre qui entrave les danseurs, qui les alourdit dans leurs mouvements, les tire constamment vers le bas et augmente leur épuisement, cette terre où ils s’affrontent et où la cruauté se déchaîne, c’est justement l’élément qui les recueille, qui amortit les chutes, permet le déploiement d’une énergie hors du commun sans qu’il y ait danger physique pour les interprètes. Les danseurs y sont collés, qu’ils soient debout ou couchés. Mais l’attraction ici est bien l’horizontalité. C’est un parti-pris radical, un refus de l’esthétique romantique du tutu, des pointes et des entrechats, esthétique qui accentue la verticalité et cherche dans la danse la dimension aérienne.
On retrouvera la terre dans un autre spectacle : AUS DEM GEBIRGE HAT MAN EIN GESCHREI GEHÔRT (Sur la montagne, on a entendu un cri), créé en 1984. Là aussi, la scène est recouverte de terre. Mais c’est une surface moins dense, comme un champ à peine fauché. SUR LA MONTAGNE est un spectacle mélancolique, dépouillé et la terre est comme une lande désolée où les danseurs évoluent souvent dans des atmosphères de brouillard suggérées par les éclairages.
C’est un véritable gazon anglais qui recouvre la scène dans 1980. Il n’y a ni cadre de scène ni coulisses. On peut voir les danseurs se préparer le long des murs du théâtre avant d’entrer en scène.
Pina Bausch a donc conçu une « aire de jeu ». Sur cette surface plane, odorante, qu’on arrose de temps en temps, la chorégraphe égrène un chapelet de situations qui sont tantôt les stéréotypes des rapports mondains, tantôt des parodies de l’enfance, de la jeunesse, de la vieillesse. Elle analyse tous les rapports entre le début et la fin. Et les rites de la garden-party, les vêtements aux étoffes précieuses, les chaussures à hauts talons, la cérémonie du thé, tout cela prend un caractère dérisoire et tragique. On rit beaucoup lors du spectacle, mais c’est un spectacle de deuil. Pina Bausch nous plonge dans une réalité implacable : elle éclaire très souvent la salle, fait descendre ses danseurs en longues processions dans le public. Elle élargit sans cesse le champ d’action des interprètes et le gazon devient ainsi un espace infini.
On assiste à une ritualisation des gestes quotidiens qui sont immédiatement détournés, vidés de leur sens. Comme dans la plupart de ses spectacles, Pina Bausch n’utilise ici que des éléments contemporains. Mais ce faisant, elle s’éloigne du réalisme et les transforme progressivement en mythes modernes. Le théâtre devient un lieu de contemplation de la douleur.
À la fin de 1980, nous voyons un groupe d’hommes et de femmes élégamment vêtus prendre congé de leur hôtesse avec des phrases extrêmement conventionnelles (« My best regards to your mother »). Enfin la femme reste seule dans l’immensité de cette pelouse où des actions multiples et fragmentées se sont déroulées pendant presque quatre heures.
1980 a été créé quelques mois après la mort de Rolf Borzik, compagnon, collaborateur et scénographe de Pina Bausch. Borzik avait une conception métaphysique de l’élément scénique. Il disait que « ce qu’on voit est seulement une petite partie de ce qui est proposé. Il faut regarder au-delà ». Ce gazon anglais, imaginé par eux, c’est elle seule qui le remplit de son désarroi et de sa solitude.
L’eau : ARIEN (Ars)