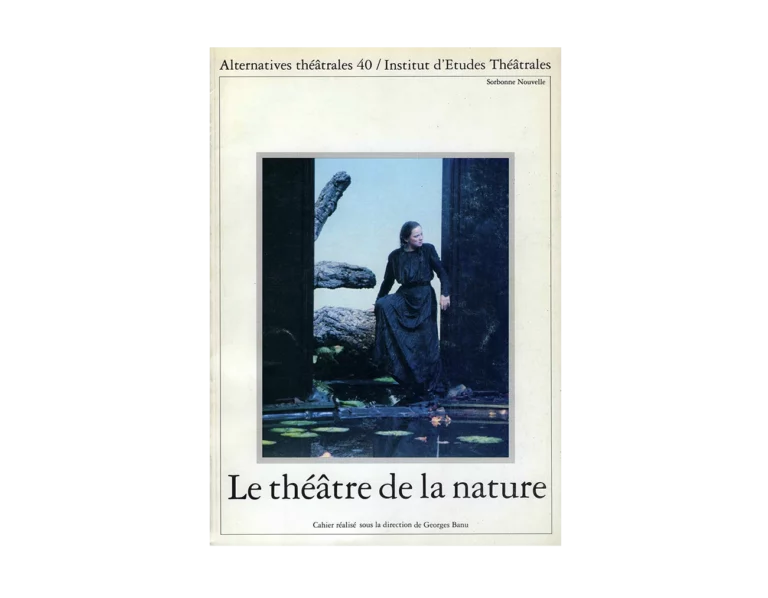Avignon, été 1990.
UNE vingtaine d’acteurs-machinistes s’affairent autour du Livre, énorme volume de six tonnes, tout droit sorti des forges, mi-fer, mi-résine. Ce Livre renferme les pages-décors des principales étapes de l’Histoire de France, non pas l’histoire chronologique des manuels scolaires, mais celle désordonnée de la mémoire collective.
La gratuité du spectacle, la longue attente sous le soleil ardent, la succession des images d’Epinal dépliées au fil des pages, poussent le spectateur à retrouver son regard d’enfant. Chaque double page ouverte illustre une des grandes étapes de notre histoire. L’esthétique de ce théâtre de plein air affiche un burlesque outrancier : Jeanne d’Arc passe l’aspirateur, Louis XIV assiste au spectacle de loin, encadré de deux citronniers en pot. La moitié des pages a déjà été lourdement feuilletée quand les câbles se tendent de nouveau sous les efforts conjugués des artistes arc-boutés aux manivelles. Un nouveau volet de LA VÉRITABLE HISTOIRE DE FRANCE s’entrouvre.
Dans l’interstice des pages s’insinue une lumière étrangement vivante. Les deux espaces plans s’écartent et dans le même temps s’animent d’innombrables flammèches.
Sur cette place publique, au milieu d’une foule festivalière, en un étrange autodafé, le feu s’installe au cœur du Livre. Il envahit les silhouettes métalliques du nouveau décor, lèche les murs et les toits, glisse sur les bulbes des églises. Evocation brute de forge, de l’incendie historique qui détruisit Moscou en 1812, sous les yeux de Napoléon Bonaparte.
L’ouverture rapide du décor n’empêche pas de revivre ses craintes et ses attirances d’enfant pour le feu. Instantanément se retrouve le plaisir secret, oublié des allumettes enflammées sur les parquets de chêne. Rêve d’enfance vite brisé par la raison. Il suffit d’un regard posé sur les becs de gaz pour que la mécanique dévoilée ne déploie plus le feu qu’en une frise dérisoire. Les craintes s’apaisent au souvenir des précédentes déclinaisons d’un feu de comédie. Des flammes peintes et flottantes, à l’auréole embrasée d’un Louis XIV de pacotille, il n’y a vraiment rien à craindre de ce feu apprivoisé. On respire, rassuré.
Brefs instants durant lesquels une des machines folles, dont Royal de Luxe a le secret, s’approche insidieusement du Livre. De sa gueule de tôles surgissent subitement d’énormes flammes. Sans discontinuer, le monstre mécanique crache, par dessus la découpe oxydée des toits, un torrent de feu.
Cette nouvelle confrontation au danger devant nos regards de spectateurs immobiles, nous ramène violemment aux craintes les plus intimes. Dans notre esprit se mêlent la réalité du feu et l’irréalité de l’image théâtrale déclinée en éléments féeriques.
Le brasier du décor, métaphore de tous les feux, révèle nos peurs et les cristallise. Dans le public, les corps se recroquevillent en un puissant moment de crainte collective. La peur raisonnée qui s’obstine à nous rappeler l’absence de danger, et la fascination pour les flammes nous clouent sur place. Simultanément, la peur instinctive nous pousse à nous écarter, à nous sauver. Réalité et fiction se heurtent violemment en un nœud d’émotions contradictoires.
Cette confrontation, cette épreuve du feu consentante et passive trouve son incarnation dans la présence des comédiens qui interprètent les rôles de Napoléon et d’un grognard. Les deux silhouettes plantées en avant-scène, dos au public, affrontent le brasier, spectateurs impuissants, figés. L’image ainsi créée ne s’anime que du seul mouvement des flammes. Ses contorsions, ses sifflements, donnent au feu la dimension d’un personnage mythique. Partant de la terreur qu’inspire le feu meurtrier dans les lieux clos et surpeuplés des salles de spectacle, Royal de Luxe inverse ce sentiment et crée le paradoxe scénique d’un feu créateur, véritable personnage.
Ici, le feu, élément symbolique, exprime pleinement l’ambivalence de son signe. Source de destruction, de mort, une ville miniature brûle sous nos yeux. Source de création, de vie, la scène s’emplit de flammes démesurées et puissantes. Dans cette image décrochée du temps, un nouvel élément vient calmer les peurs, fait basculer la violence dans une douceur ouatée, de petits flocons de neige artificielle volent délicatement, interposent un écran aux mouvements lents entre les spectateurs immobiles et les flammes serpentines.

En associant les contraires, le feu et la neige, le danger et le calme, la mobilité et la fixité, les peurs et les désirs, cette ultime vision des deux pages napoléoniennes inscrit dans les mémoires une image parfaite.
« Toute eau nous est désirable ; et, certes, plus que la mer vierge et bleue, celle-ci fait appel à ce qu’il y a en nous entre la chair et l’âme, notre eau humaine chargée de vertu et d’esprit, le brûlant sang obscur. » Paul Claudel, « Le fleuve »
in CONNAISSANCE DE L’EST