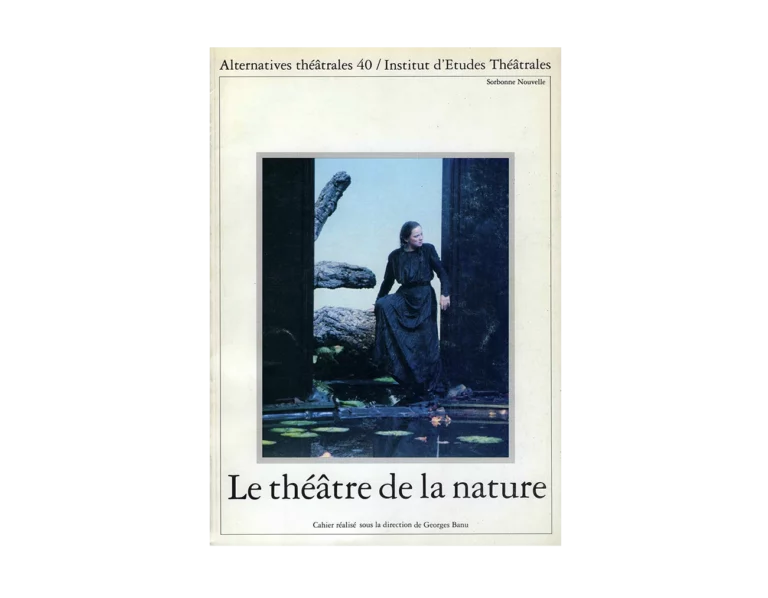La question de la représentation de la nature s’est posée à Brook, comme à d’autres metteurs en scène, plusieurs fois dans sa carrière. Chaque fois il y a répondu à la façon orientale, non pas directement mais par une autre question. Non pas : « Comment représenter la nature qui constitue le décor de ce texte ? », mais : « Que représente cette nature dans le texte ? ». Qu’est la forêt dans TIMON, dans LE SONGE, dans LE MAHABHARATA ? Selon les nuances mises à jour dans les réponses, les modalités de représentation changent et se diversifient. Dans LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ (1968), Brook avait choisi le cirque comme métaphore de la nature. La forêt y est un lieu mystérieux, peuplé de présences invisibles, lieu à la fois redoutable et fascinant, lieu de la magie dont le cube blanc, décor/métaphore du cirque, donnait un équivalent parfait. De nos jours, le cirque recèle cette puissance d’imaginaire, de mystérieux et de contact avec l’invisible que représentait jadis la nature. TIMON présentait un désert beckettien, une sorte de no man’s land. La forêt, dans ce cas, renvoie à l’idée de lieu inhabitable par l’homme. LE MAHABHARATA verra reparaître cet espace désertique en tenant lieu.
Pour LA TEMPÊTE, le lieu naturel est un lieu primitif — lieu où la civilisation n’a pas œuvré — opposé à l’espace investi par l’homme et ses lois. L’île est encore régie par ses propres lois. On retrouve un des couples brookiens : civilisation/sauvagerie. De plus, Brook fait de l’île un être véritable, un personnage qui joue son rôle. Il procédait déjà ainsi dans LA CERISAIE où la maison et son verger constituaient une présence vivante et active. Dans LA TEMPÊTE, la question de la nature se complexifie, englobant aussi la surnature, le surnaturel. Pour Brook, comme on va le voir, ces deux plans ne doivent pas être séparés, et il faut voir l’originalité de sa démarche dans la recherche d’une continuité de l’un à l’autre.
Brook évoque ses options relatives à l’axe de la nature dans sa première mise en scène de LA TEMPÊTE : « Exprimer de manière convaincante un monde surnaturel : cela avait été la vraie difficulté. J’avais eu beau utiliser tous les effets du théâtre visuel, je sentais instinctivement que ce ne pouvait être la bonne direction ». « Dans l’Angleterre de Shakespeare, le lien avec la nature, avec le monde surnaturel, n’avait pas été brisé. Les anciennes croyances survivaient. Le sentiment du merveilleux était toujours là ». La question, traversant de part en part le théâtre de Brook, est de savoir comment représenter à nouveau ce lien vivant et que nous avons perdu. Par ailleurs, LA TEMPÊTE lui est « une énigme », une « fable », « où rien ne peut être pris à la lettre, car si nous restons à la surface de la pièce, sa qualité essentielle nous échappe. Ni dans la mise en image, ni dans l’action, le réalisme ne peut nous aider, puisque cette île n’a pas d’existence, (..….) l’île est tout à la fois le monde et un simple rocher, un lieu d’illusions et de rêves que chacun voit comme il peut, comme il veut. Et pourtant le thème essentiel n’est pas l’illusion théâtrale, n’est pas la scène mais la vie ; les illusions de la vie explorées, avec les touches les plus légères, à travers une vision pleine de compassion de la comédie humaine et tout un réseau de charades et de jeux ». Cette fois-ci, il ne s’est donc pas agi d’utiliser les ressources du théâtre visuel pour exprimer la nature et le surnaturel. Mais la représentation de la nature passe obligatoirement par un choix de décor, et donc, la question du réalisme, du mimétisme et de l’artifice se pose quoi qu’il en soit.
Comme toujours chez Brook, la scène est très peu occupée : c’est un espace vide. Pourtant, à peu d’exceptions près, tout ce que réclame le texte est montré. La nature, omniprésente dans LA TEMPÊTE, est évoquée sans aucun moyen technique sophistiqué, aucun matériau complexe : seuls quelques objets simples la font exister.
La métonymie plutôt que l’illusion réaliste
L’essentiel de la représentation de la nature dans LA TEMPÊTE relève du symbole et la modalité centrale en est la métonymie. La métaphore est utilisée mais s’attache plutôt à la représentation du surnaturel. Si le décor est naturel, il n’est pas réaliste. L’île n’est pas figurée mimétiquement. Un rectangle de bambou délimite deux espaces (intérieur/extérieur) de deux types de sols (terre battue à l’extérieur, sable clair à l’intérieur) et, posé au fond à droite, un gros caillou, le rocher.
Si les bambous désignent les contours de l’île, le formalisme rectangulaire casse la référence réaliste à l’île comme bloc informe ou rond au milieu de la mer. De plus, si l’action ne se déroule pas en dehors des bambous, les personnages évoluent cependant dans cet espace : c’est aussi l’île. La scène entière est l’île. Mais la terre battue pénètre largement dans l’espace du public : l’île c’est donc aussi la scène ex la salle, le théâtre. D’où l’idée du théâtre comme flot dans le monde, où peuvent se jouer les dernières passions primitives et essentielles de l’homme… Le théâtre, édifice construit, est lui-même métaphore de la nature. D’un côté, le thème insulaire s’étend au maximum, de l’autre il se concentre car, de manière imagée, l’île c’est le sable et l’espace délimité. Et, symboliquement, le rocher la désigne. Il se trouve au milieu du sable comme l’île au milieu de la mer : le sable est aussi la mer. Les éléments se trouvent en équation paradoxale (terre=eau : ambivalence élémentaire. On voit d’emblée l’île, mais comme au loin, à l’horizon. Dans les scènes suivantes, le sens du symbole île/rocher perdure quand la dominante est alors Le caillou. Le rectangle, s’il désigne l’île, renvoie encore à ses différentes parties. Le changement de lieu n’induit pas de changement de décor. Constante brookienne. Ainsi Brook propose-t-il au spectateur la partie et le tout, l’élément métonymique et le symbole. Une vision unifiée superpose les différents niveaux de lecture des signes : Brook se rallie à une pensée non dissociée, caractéristique de la pensée « primitive », et de la recherche d’une esthétique naïve. La couleur verte de la cage de scène des Bouffes, également métonymique, n’est pas de même nature ; c’est un signe « Construit ». Il ne s’agit pas de nous la faire prendre pour du feuillage. Signe construit, il n’est pas montré comme tel, car qui ne connaît pas les Bouffes n’en perçoit pas l’ajout… Et c’est de nouveau un signe bivalent car dans la première scène il réfère à la mer entourant le navire. Cette couleur forme un paradigme, décliné dans les costumes des personnages invisibles, les feuilles et les brins d’herbe. Par « touches » elle permet à Brook l’évocation dans l’imaginaire du spectateur plus que la représentation imposée de la nature, vision restrictive ou pour le moins dirigée… Métonymique encore la représentation sonore de la tempête, de la mer et de l’orage. Le gros bambou balancé de droite et de gauche par Ariel entrant en scène figure la mer. Le spectateur le traduit immédiatement malgré la distance de l’image à son référent, aidé en cela par le bruit du roulis et des vagues dû au glissement de billes dans le tube. Fermé et étroit, il dit néanmoins l’étendue de la mer, ce qui confère ici à la métaphore un relief particulier. Brook donne à voir et à entendre le mouvement et le bruit de l’eau. De même que la couleur évoque la nature, le son évoque le phénomène. Un redoublement métonymique se dessine car le son est doublé par la musique, et celle-ci est jouée sur scène. Par cet effet, Brook détruit sans provocation toute possibilité de raccrocher LA TEMPÊTE à un réalisme quelconque. Les feuilles, les brins d’herbes et les feuillages constituent les autres métonymies. La nature entoure, enveloppe Ferdinand perdu sur l’île (I, 2), Brook l’évoque à l’aide de deux feuilles, et l’illusion est parfaite quand, comme s’il écartait de multiples branchages, Ferdinand écarte le bras de l’homme invisible qui les tient. Ces éléments peuvent référer aux feuilles et herbes du monde, n’était leur ambiguïté car Brook brise l’illusion référentielle en les faisant renvoyer au surnaturel qui habite l’île et à la perception de la nature qu’ont les hommes. On ne sait (II, 1), qui de Gonzalo, Antonio ou Sébastian en a la juste perception : elle impose à chacun la perception qu’il en a. De nouveau, la nature évoquée par Brook ne renvoie pas au réel. Elle n’est pas conçue comme une donnée du monde mais comme un élément construit à partir de la perception qu’en ont les hommes. Le thème essentiel, nous dit Brook, est l’illusion, les illusions, non du théâtre mais de la vie. Par ailleurs, ces éléments n’existent pas seuls. Le brin d’herbe n’est pas posé sur scène mais tenu par un personnage. Cet usage de la métonymie manifeste l’esthétique et la démarche brookienne dans sa volonté affirmée d’essentialisation et de concentration issue de l’expérience shakespearienne : « le théâtre, nous dit Brook, est le miroir concentré de la vie ». Mais il n’est pas celui que Stendhal proposait de « promener le long d’un chemin ». La vie ne s’y reflète pas. Elle s’y retrouve en continuité, en contiguïté aussi, avec une qualité différente, plus dense.
Le naturel et le surnaturel sans solution de continuité