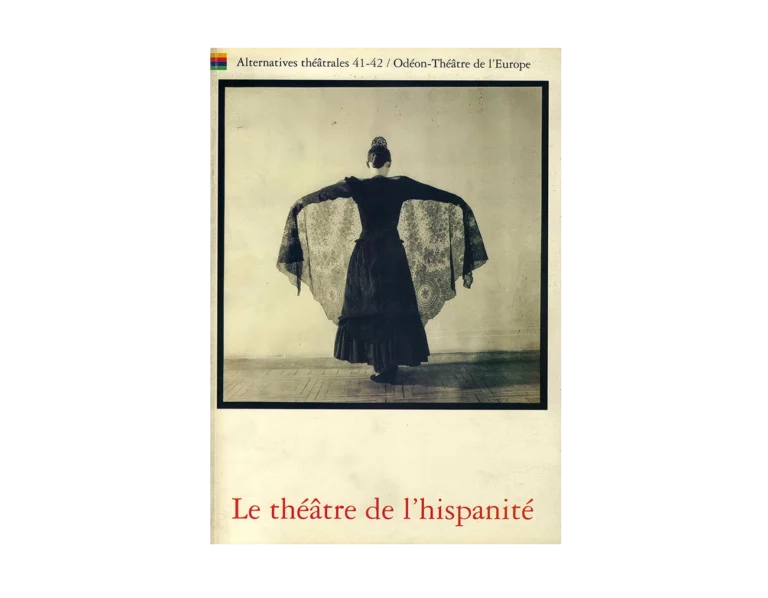EN même temps que les compagnies latino-américaines convergent à Paris et à Nancy pour participer aux festivals internationaux1, faisant connaître avec plus ou moins de bonheur l’état de leur théâtre, commencent à arriver aussi quelques jeunes metteurs en scène, qui avaient débuté dans leurs pays respectifs et qui cherchaient à satisfaire leurs inquiétudes créatrices dans un milieu plus stimulant pour l’expérimentation et, peut-être aussi, d’une plus grande stabilité politique.
Le pèlerinage pour venir étudier le théâtre en France est une pratique ancienne en Amérique latine, mais, pour autant que nous sachions, jamais auparavant il ne s’était produit une insertion dans le milieu professionnel français, comparable à celle qui a commencé à se produire de façon manifeste au début des années soixante, même si certains Latino-Américains étaient arrivés la décade précédente. Voici la liste des principaux metteurs en scène par ordre d’arrivée : Alejandro Jodorowsky (1953), Alberto Rody (1954), Rafael Rodriguez Vigouroux (1957), Jorge Lavelli (1960), Víctor García (1962), Antonio Diaz Florian (1968), Alfredo Rodriguez Arias (1969), Gustavo Gac Artigas (1974), Oscar Castro (1976) et Augusto Boal (1978). Il est important de signaler que les metteurs en scène qui sont arrivés en France à la fin des années cinquante et durant les années soixante sont des exilés volontaires, alors qu’un grand nombre de ceux qui sont arrivés la décennie suivante le font pour des raisons politiques et sont accueillis en tant que réfugiés. Cette distinction n’est pas purement formelle, étant donné que la condition d’exilé politique ou non a eu, dans une certaine mesure, une influence sur l’orientation du travail artistique dans le pays d’adoption.
Ce serait une entreprise trop vaste que d’étudier la contribution de chacun de ces metteurs en scène. C’est pour cette raison que nous n’avons choisi que quatre d’entre eux : Rafael Rodriguez Vigouroux, Alberto Rody, Jorge Lavelli et Víctor García, qui nous semblent être les plus représentatifs de la première vague (les exilés volontaires) et dont l’apport artistique s’est révélé avec éclat dans les années 60 où il prit des allures de véritable mouvement, selon l’avis de certains critiques.
Il faut insister sur les conditions favorables offertes par le milieu théâtral français de cette période et qui rendent possible l’insertion professionnelle des hommes de théâtre étrangers. Ils trouvaient en France des conditions propices pour enrichir leur bagage culturel et théâtral, ainsi que pour créer en pleine liberté et parfois avec des moyens économiques qu’ils auraient obtenu difficilement dans leur pays. Nous pensons surtout à certains spectacles de Lavelli, Rody et Garcia. La mise en scène de GILGAMESH faite par ce dernier nous servira d’exemple. Elle a nécessité une adaptation spéciale de la salle (Théâtre de Chaillot), l’installation d’un dispositif scénique complexe et exigé la participation de douze machinistes, cinq accessoiristes, huit électriciens, quatre habilleuses, en plus, naturellement des quatorze comédiens de la distribution et des autres collaborateurs proches du metteur en scène.
La décentralisation théâtrale, la création des Maisons de la Culture, le Concours des Jeunes Compagnies2, l’Aide à la première pièce, l’Université du Théâtre des Nations sont autant de portes d’accès pour les jeunes metteurs en scène latino-américains, qui sauront en profiter avec plus ou moins de chance. Leur présence multiple et active prend même, pour certains critiques français, un air « d’école » ou de « tendance» ; c’est le cas, par exemple, de Lucien Attoun qui publie en 1969 un long article intitulé « L’École argentine de Paris et LE CONCILE D’AMOUR d’Oscar Panizza »3
Réception critique
Attoun commence son commentaire en se référant, en général, aux tendances qui se manifestent parmi les jeunes metteurs en scène, tâche dont il reconnaît la difficulté en raison de la nature même du théâtre, art éphémère par excellence, étroitement lié à son contexte. Ces tendances prennent corps à partir des critères divergents ou convergents sur la conception du théâtre, la fonction de celui-ci dans la société et, en dernier lieu, le modèle même de société dont il est question.
Parmi les différents courants qui émergent, il y en a un dont la filiation lui paraît la plus évidente. Le paragraphe mérite d’être cité intégralement : « Cependant, il serait possible de trouver une communauté de pensée pour quelques-uns d’entre eux dans une attitude commune vis-à-vis du théâtre qui toutefois ne semble pas vouloir participer d’une conception militante de cet art : les Latino-Américains fortement marqués par leur origine, dont l’empreinte dans le théâtre français se fait de plus en plus voyante, et dont l’École argentine de Paris, est, pour l’instant, le moteur le plus dynamique et déjà le plus copié. Les Latino-Américains de Paris défendent avec constance un théâtre musical, cérémonial, liturgique et parfois thérapeutique !»
Néanmoins, le critique prend soin de bien préciser qu’il ne s’agit pas là d’une tendance monolithique, mais qu’elle possède la diversité que l’on attribue dans le domaine de la peinture à l’École russe de Paris. Les représentants du groupe latino-américain seraient : Garcia, Jorodowsky, Lameda, Lavelli, Rody et Savary, qui auraient un héritage culturel commun : «(…) né du métissage entre l’indien hiératique, aux lignes épurées, précurseur de la stylisation, et l’espagnol, angoissé, tragique et théâtral ».
Attoun fait ensuite un compte rendu de l’itinéraire théâtral de chacun d’entre eux en France, en commençant par le péruvien Rafael Rodriguez, avant-garde du groupe, révélé en 1960 par une version surprenante d’OEDIPE ROI. Pour chaque cas, il s’efforce de montrer les singularités respectives. Parmi les noms déjà cités, il remarque trois Argentins : Garcia, Lavelli et Savary, dont le travail artistique a été particulièrement brillant. Finalement, il esquisse la trajectoire de Lavelli et se concentre spécialement sur LE CONCILE D’AMOUR, sa dernière œuvre représentée, «(…) un des plus beaux spectacles qu’on ait vus en France depuis longtemps. »
L’article de Nicole Zand intitulé « Le besoin de vivre »4, bien qu’il ait été publié l’année précédente, paraît répondre directement à celui d’Attoun : « Ils ne sont ni un ‘clan’, ni un ‘groupe’, ni une ‘école’, ni une ‘famille’, ni un ‘mouvement’, ni une ‘chapelle’, ni une ‘cellule’, ni une ‘loge’. On les appelle ‘les Latino-Américains’ ». Un long épigraphe d’Arrabal où il énonce sa conception du « théâtre panique » (fête, rituel, cérémonie), ouvre ce commentaire de N. Zand. Ces idées d’Arrabal seraient communes aux hommes de théâtre latino-américains qui, en moins de cinq ans, auraient pris possession de Paris : «(…) ce sont eux qui, dans le milieu du théâtre, apparaissent comme les hommes à abattre. ou à imiter ».
Nicole Zand fait elle aussi remarquer que la majorité d’entre eux sont argentins : Lavelli, Copi, Savary, Garcia, avec en plus le péruvien Rafael Rodriguez comme précurseur de ce style « néo-baroque », à travers sa mise en scène de SAINT-GENEST de Rotrou. La pénétration latino-américaine aurait déjà commencé en 1960 avec l’arrivée successive des hommes de théâtre déjà cités. Les points communs : connaissance primaire de Brecht, sans identification avec son didactisme ; assimilation du théâtre d’avant-garde (Beckett, Ionesco, etc…) ; et, surtout, une profonde affinité avec Artaud, parfois connu indirectement. Lieu de rencontre privilégié : l’Université du Théâtre des Nations, où les jeunes gens de théâtre des pays les plus divers avaient l’occasion d’échanger leurs expériences à travers un dialogue exemplaire des cultures, réalisé dans un pays neutre. En somme il s’agissait autant de la connaissance de l’autre que de se connaître soi-même et son contexte originel.
Selon, N. Zand, les années soixante marquent l’apogée de Brecht-Beckett-Ionesco et ouvrent les portes au théâtre de la cruauté, au vertige de la « jubilation baroque ». C’est à ce moment particulièrement propice que se sont produites les premières créations latino-américaines : « Elles apportaient toute une culture différente, un peu magique, un peu vénéneuse, une source nouvelle de mythologies exprimées grâce à l’utilisation de tous les langages : gestes, sons, mouvements des corps, cris, modulation des voix. »
Elle pense que le fait d’être des étrangers et de ne pas maîtriser totalement la langue française a paradoxalement contribué à un traitement différent du langage, mettant plus l’accent sur sa qualité de matière sonore et musicale. Par ailleurs, ne se sentant pas directement impliqués dans le contexte social français : «(…) ils se dépolitisaient, pratiquant délibérément l’art pour l’art ».
Certaines déclarations de Lavelli incluses dans l’article confirment pleinement le précédent jugement ; les Latino-Américains de Paris ont pratiqué le dépassement du réalisme, l’évacuation d’éléments rationnels, l’abolition de l’histoire au bénéfice de l’onirique, du fantastique et du sens de la fête. La déclaration suivante de Lavelli illustre l’objectif essentiel qu’il poursuivait alors avec son travail artistique : « Je voudrais que le spectateur ne se reconnaisse que dans les sentiments extrêmes hors de toute contingence quotidienne, qu’il soit pris dans un kaléidoscope de sentiments, comme dans un rituel. »
Ces deux articles que nous venons de présenter ont un grand intérêt, non seulement à cause de la richesse de l’information sur cette période, mais aussi parce qu’ils essaient, pour la première fois, de donner une vue d’ensemble de la présence de metteurs en scène latino-américains en France et d’expliquer d’une certaine façon le phénomène. Écrits vers la fin des années soixante, ils sont des révélateurs significatifs de l’impact produit ces années-là sur le milieu théâtral par Le travail artistique d’hommes de théâtre venus d’Amérique latine. Les coïncidences d’appréciation des deux critiques, sur les Latino-Américains, sautent aux yeux : ils font un théâtre non réaliste, cérémoniel, musical ; ils refusent une conception militante ou politique du théâtre ; ils sont fortement marqués par leur milieu d’origine ; les Argentins, surtout, se distinguent, par leur plus forte personnalité artistique. Les deux critiques sont convaincus que l’importance acquise par les Latino-Américains sur Le plan théâtral est indiscutable.
Arrabal et les Latino-Américains
Il y a trois aspects que seule N. Zand signale de façon explicite, sans toutefois les développer : la communauté d’idées du groupe avec Arrabal ; la profonde affinité avec Artaud ; et l’importance de l’Université du Théâtre des Nations en tant que centre d’échanges très fécond. À notre avis la communauté d’idées avec Arrabal peut être discutable dans des cas précis comme ceux de Rody et de Rodriguez, mais, en général, il a existé une évidente complicité entre cet auteur espagnol et certains Latino-Américains comme Lavelli, Garcfa, Jodorowsky, Lameda et le franco-argentin Savary, qui va beaucoup plus loin que le commun dénominateur de la langue et de la culture hispanique. En premier lieu, il suffit de signaler la longue liste d’œuvres d’Arrabal qui ont été mises en scène par les Latino-Américains, nombre d’entre elles étant des créations mondiales. J. Lavelli est celui qui en compte Le plus : PIQUENIQUE EN CAMPAGNE (France, 1965), LA PRINCESSE ET LA COMMUNIANTE (France, 1966), L’ARCHITECTE ET L’EMPEREUR D’ASSYRIE (France, 1967 ; Allemagne, 1974), SUR LE FIL (France, 1975) et LA TOUR DE BABEL (France, 1979).
Víctor García, pour sa part, a créé avec le succès que l’on sait LE CIMETIÈRE DES VOITURES (France, 1966 et 1967 ; Brésil, 1969), version spéciale qui incluait aussi LES DEUX BOURREAUX, LA COMMUNION SOLENNELLE et ORAISON. Plus tard il a mis en scène L’ARCHITECTE ET L’EMPEREUR D’ASSYRIE avec l’Old Vic de Londres (1970) et aussi LOS DOS VERDUGOS en espagnol, qui n’a pu être représenté, le 11 février 1969, en Espagne, à cause de l’intervention de la police franquiste.
Le premier texte théâtral mis en scène par Jérôme Savary fut LE LABYRINTHE (France, 1967), où Copi jouait également. Ramén Lameda, qui est resté moins longtemps en France, a également monté un spectacle Arrabal composé de BESTIALITÉ ÉROTIQUE et d’‘UNE TORTUE NOMMÉE DOSTOIEVSKI, (France, 1968). Même Rafael Rodriguez, qui n’a pratiquement pas eu de contact ni d’affinité avec Arrabal fut invité à mettre en scène LE JARDIN DES DÉLICES (Belgique, 1976), expérience qui a positivement modifié sa vision du théâtre d’Arrabal. Le seul qui n’a jamais choisi un texte d’Arrabal est Alberto Rody, bien qu’il se soit montré sensible au théâtre espagnol et ibéroaméricain, comme le prouvent ses mises en scène de Figueiredo, Calderón, Triana et Neruda effectuées en France.
De son côté, Fernando Arrabal est conscient de la dette qu’il a envers les « Latino-Américains de Paris » comme le montre le dernier paragraphe de son texte LE THÉÂTRE COMME CÉRÉMONIE « PANIQUE »5 : « Le jeune théâtre français compte plusieurs prestigieux maîtres de cérémonies : Víctor García, Lavelli et Savary. Tous trois s’imposent à nous par la démesure de leur univers baroque qui illumine un monde délirant, plein d’eau claire et de médiums, un monde où les costumes, les décors et la musique et ses instruments jaillissent d’un même ventre, comme les combinaisons d’un unique kaléidoscope sauvage. L’action saute d’une planète à l’autre, d’un cri à un murmure et les spectateurs, prisonniers d’un enclos pour tentations de Saint Antoine, se métamorphosent en mages, victimes et prestidigitateurs vêtus de désespoir et de félicité. »
La complicité d’Arrabal et des Latino-Américains a pris aussi d’autres formes. La plus explicite est la création du Théâtre Panique, fondé par Arrabal, Topor et Jodorowsky, où figure également Savary parmi les compagnons de route du mouvement, si l’on en croit le livre intitulé LE PANIQUE. Par ailleurs, dans la publication Le Théâtre, cahiers dirigés par Arrabal, apparaissent comme collaborateurs Garcfa, Jodorowsky et Lavelli. Cette coexistence et cette collaboration mutuelle atteint son plus haut dec‑é dans les années 60. Postérieur at le phénomène s’est atténué et chacun a suivi son propre itinéraire, interrompu par une mort prématurée dans le cas de Garcia.
Il y a cependant un aspect essentiel concernant les argentins Lavelli, Rody et Garcia, qui pour des raisons évidentes, ne pouvait être perceptible pour des critiques français comme Nicole Zand ou Lucien Attoun. Il s’agit de l’importance qu’a eue dans la formation théâtrale de ces trois hommes « le mouvement du théâtre indépendant ». Au moins les deux premiers ont reconnu à plusieurs reprises être les enfants directs de ce mouvement profondément novateur qui s’est développé en Argentine à peu près entre 1930 et 1960. Le répertoire était composé de classiques et de contemporains européens et américains, mais il a révélé aussi de nouveaux dramaturges nationaux comme Roberto Arlt, Carlos Gorostiza, Agustfn Cuzzani, Juan Carlos Ferrari et Osvaldo Dragün, entre autres.
Le souci de l’espace