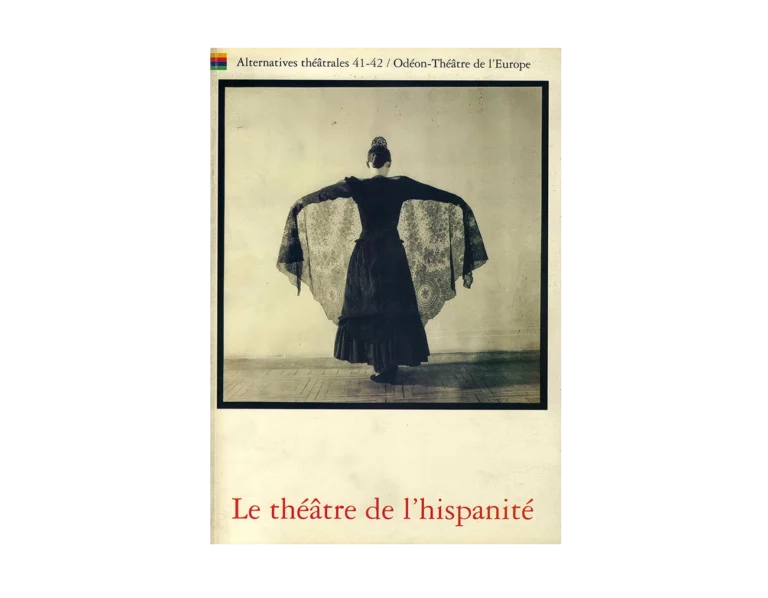En juin 1985, Georges Lavaudant se rendit pour la première fois au Mexique, « presque par hasard ». Il y a fait depuis une quinzaine de séjours. Le spectacle TERRA INCOGNITA a jailli du désir de faire partager « ce rêve amoureux et inattendu », une certaine fascination pour le Mexique, ses paysages et ses visages. Georges Lavaudant écrit :
«On ne s’écarte pas des simples récits d’aventure avec autant de facilité qu’on le souhaiterait.
Ce qui a été vécu pour de vrai prend dans l’imaginaire des proportions inusitées. En ce sens, TERRA INCOGNITA est la somme jamais close de mes nombreux séjours au Mexique. Mais, comme dans l’énoncé des souvenirs, le plus important demeure ce que l’on oublie.
Qu’ai-je donc oublié dont je voudrais à toute force me ressouvenir ? Et dans cet effort, est-ce que je ne commence pas à inventer, à fabuler, à piller ici ou là d’autres récits, dans d’autres aventures ?
Même s’ils se sont mélangés, dilués, trois thèmes reviennent de manière lancinante.
Premièrement : les Indiens. Malgré le génocide, malgré l’’empoisonnement et les massacres actuels, les Indiens demeurent comme des lumières allumées dans la nuit. Ils veillent. Il n’y a pas de jugement, pas de nostalgie. Ils sont là, c’est tout.
Deuxièmement : la musique et la danse. Les salons et les bars, les boléros et les danzônes, les cantinas et les pulqueriäs. Hommage à l’alcool, aux vies, aux voix, aux mouvements, à la pensée des « pieds » qui, dans leurs va-et-vient incompréhensibles, écrivent les plus beaux poèmes d’amour.
Troisièmement : l’aventure. L’amour, le destin, la romance, le désir de disparaître du jour au lendemain, de changer d’identité, de devenir ces héros négatifs, absents, oubliés. »
Bar « Leon » — 23 heures
LE taxi repassa devant le palais de marbre effondré de Bellas Ârtes, vira à gauche dans Alarcon, puis à droite dans Tacuba. L’enseigne du « Leon » clignotait faiblement. De la rue, on entendait la sourde pulsation de la basse. Le patron s’écarta légèrement pour le laisser regagner sa table, massif dans sa chemise trop étroite, il surveillait l’orchestre tenant sa cigarette dans le creux de sa paume, la main derrière le dos comme certains adolescents le font encore par crainte d’être surpris. À la fin du morceau, le Tumbatore abandonna son instrument et vint le rejoindre.
«Qu’est-ce que tu en penses ?». Il pencha la tête sur le côté et enleva les bouts de sparadrap qui entouraient ses phalanges et les colla autour d’un briquet en plastique. Un trio de guitaristes se faufilaient entre les tables proposant des chansons d’amour. Le Tumbatore racontait une nouvelle fois l’histoire du meurtre dans le bar, le pistolet du gangster sur la tempe de l’inspecteur… Le temps d’aller aux toilettes et Pan ! La chose était accomplie. Que barbarida ! Le fils d’un ami, oui le jeune policier. Il redit le corps baignant dans le sañg et les tabourets renversés, l’enquête rapide et astucieuse conclue grâce à la marque de pressing oubliée dans la manche du pardessus de l’assassin. On avait rallumé et ouvert les portes. Un air glacial se faufilait sous leurs cuisses. Il songea que passés ces moments intenses de retrouvailles un peu absurdes, la conversation finissait pas s’enliser dans les mêmes anecdotes, les mêmes ressassements : « Veracruz », le Malecon, les palmiers, les enfants morts d’une maladie mystérieuse (uniquement les garçons), le mariage de sa fille à Guadalajara avec un militaire. Le trompettiste aveugle arrangeait sa cravate et tapotait les boutons de sa veste. Atmosphère familière où rien ne semblait devoir changer et qui, pour peu qu’on l’envisageât sous une humeur légèrement cafardeuse, pouvait rapidement tourner à la catastrophe, au désir de mourir, de s’enfoncer pour de bon dans un alcoolisme définitif. Il jeta un dernier coup d’œil en direction du bassiste bossu qui bavardait au bord de la piste avec la même blonde décolorée et paya sans un mot. Ils traversèrent Le hall inondé de néons et se retrouvèrent dans l’air glacial et piquant de la Calle Brazil.
« Casablanca » — 1 heure 15